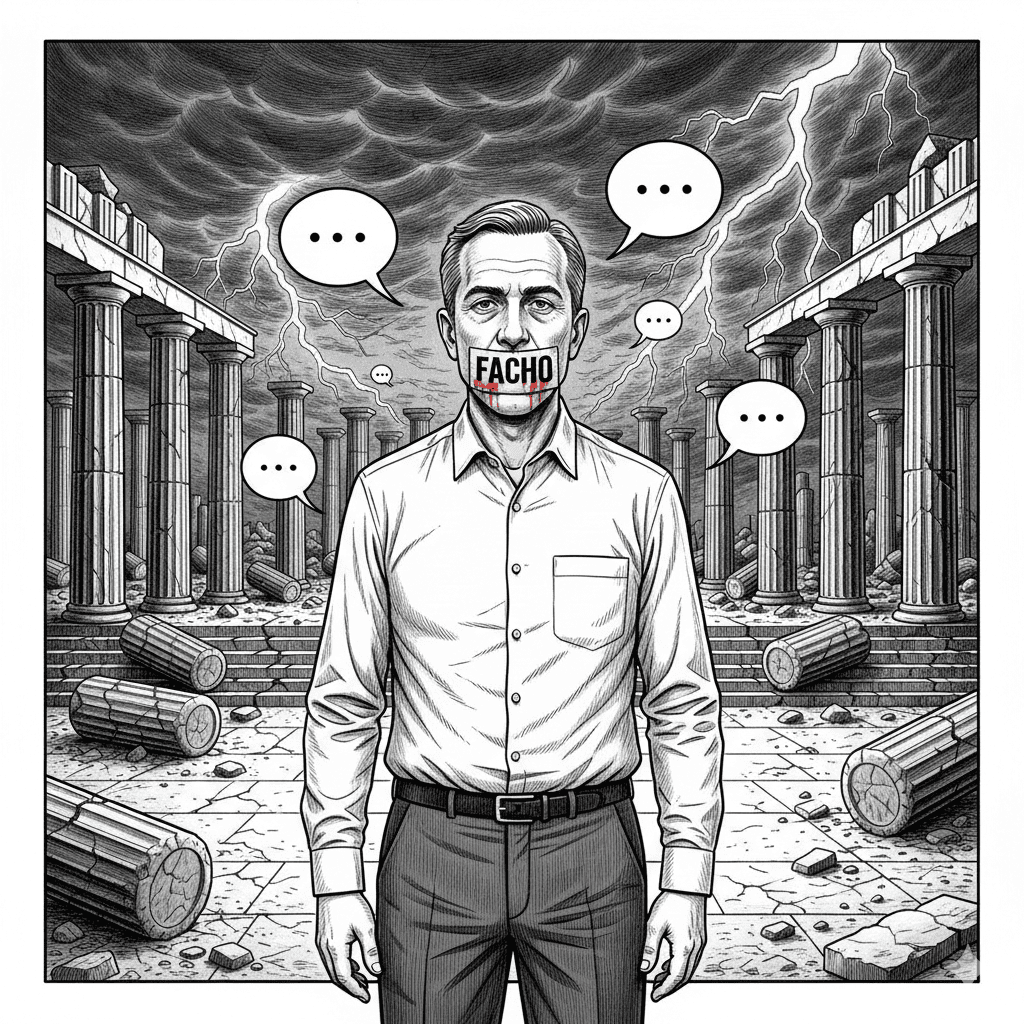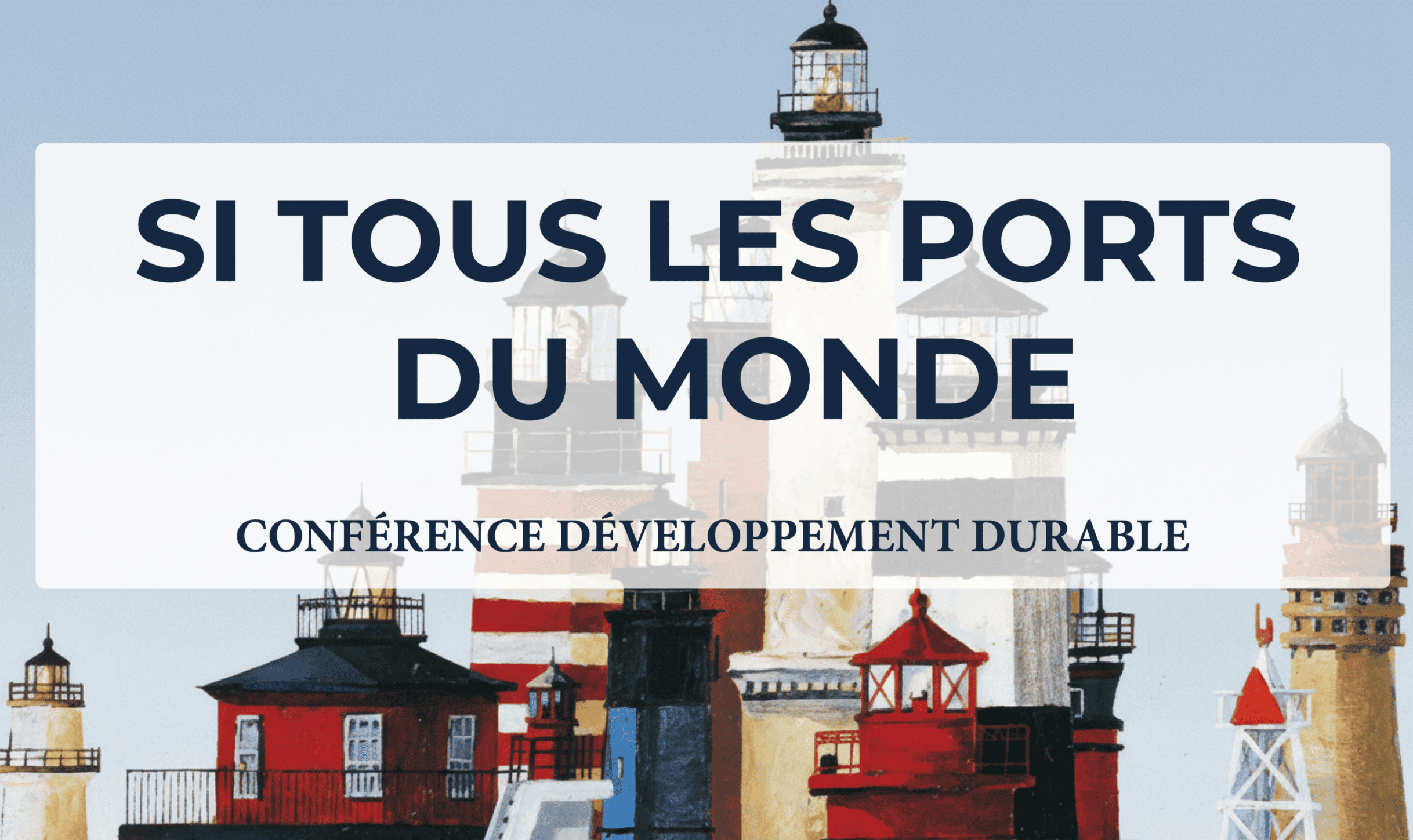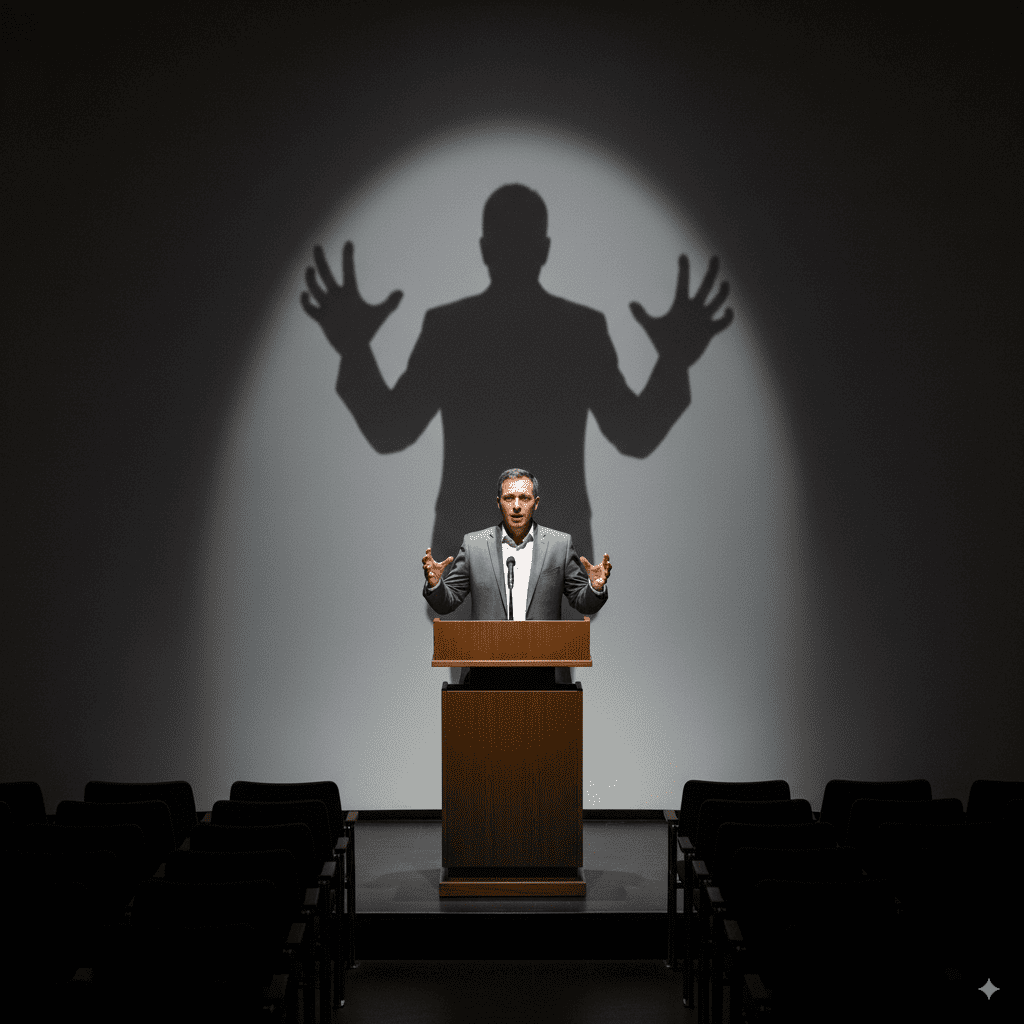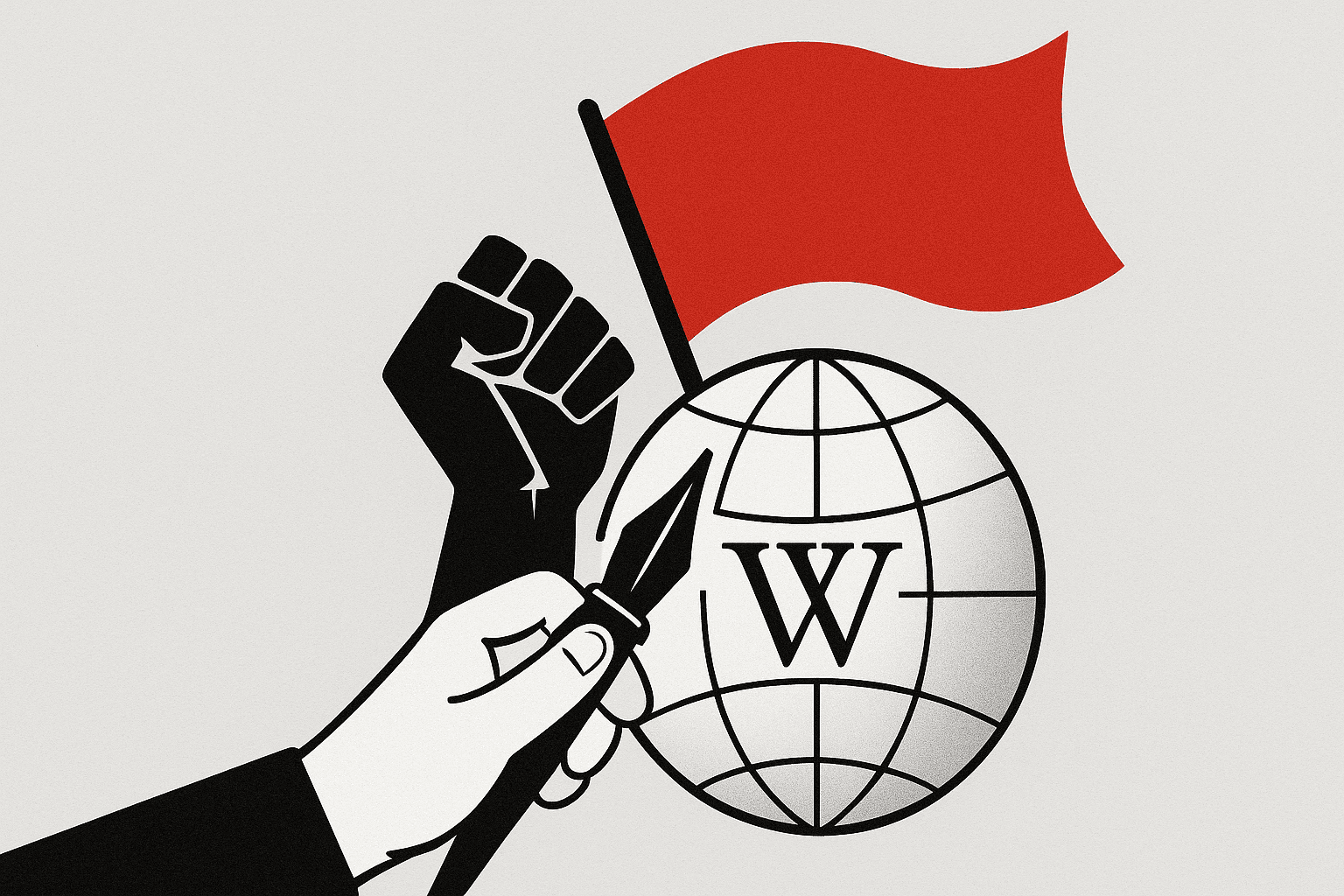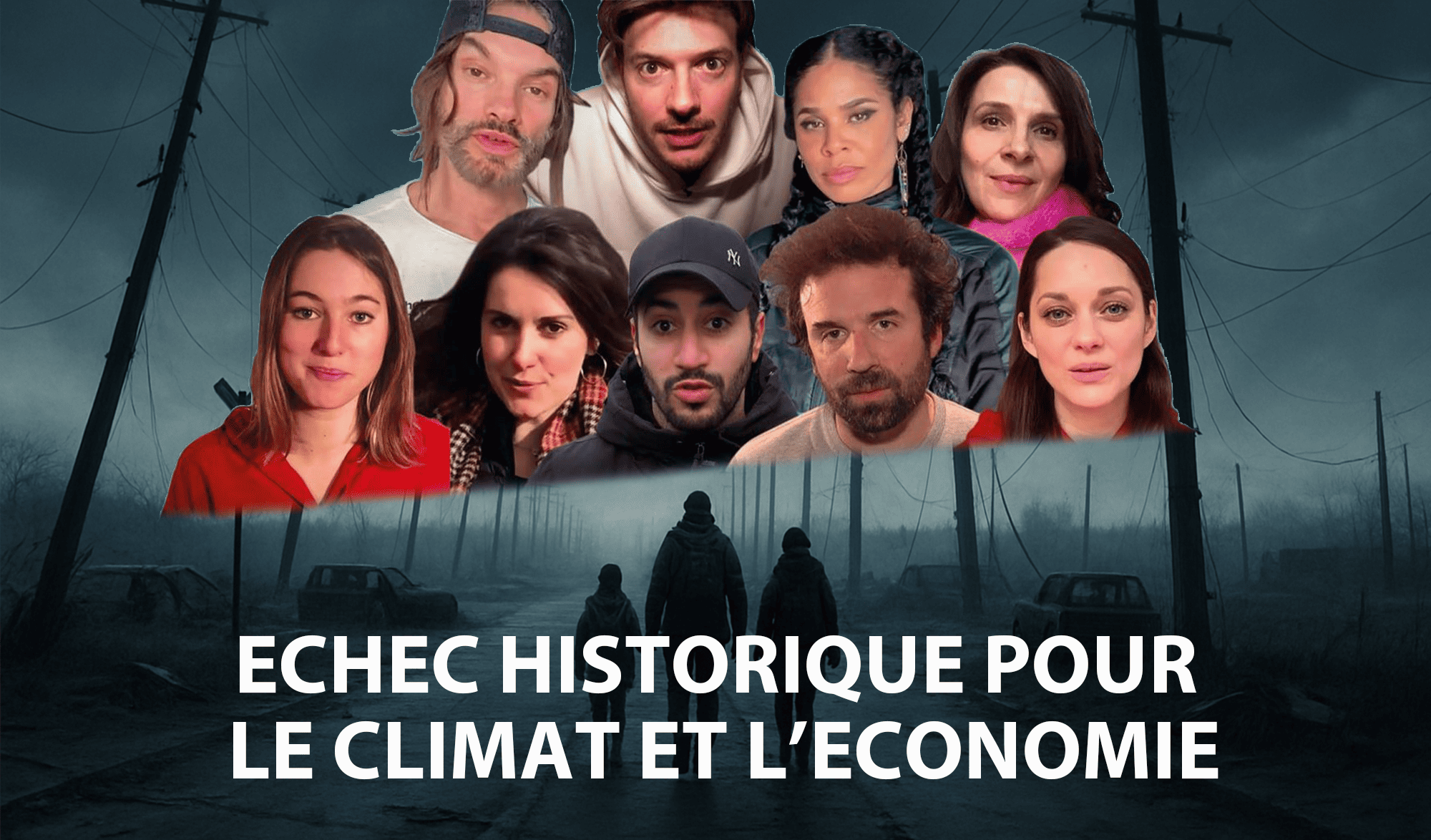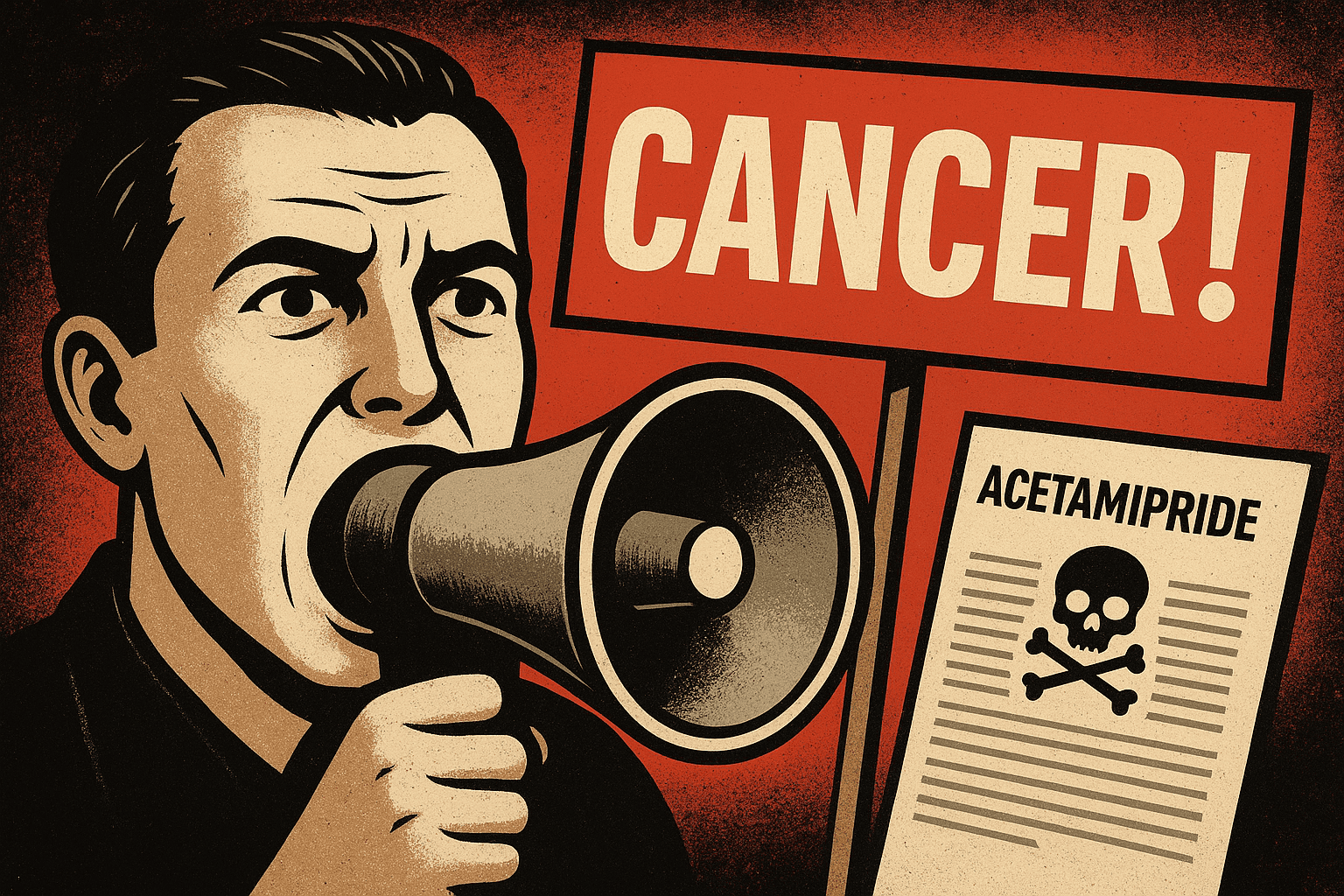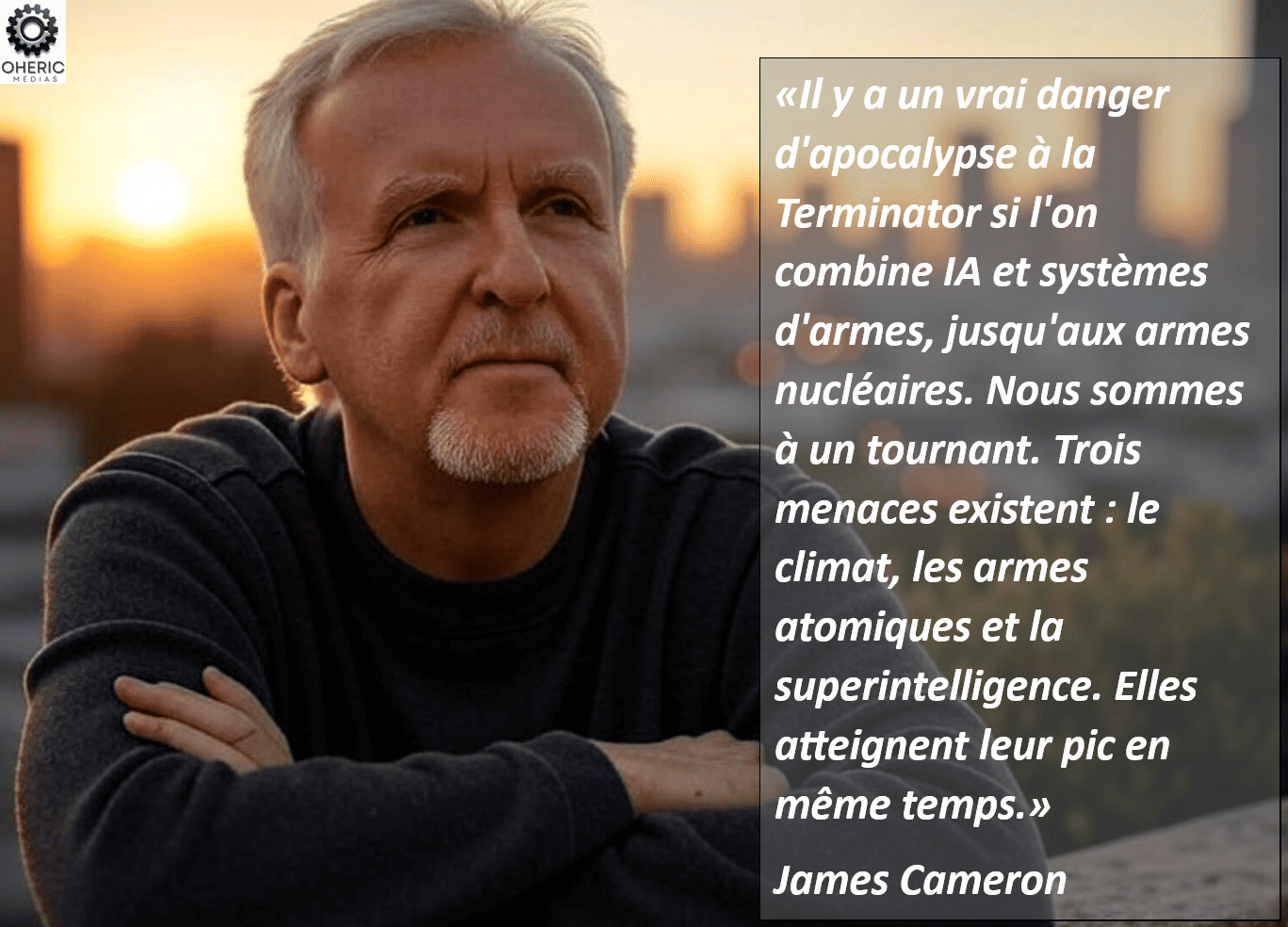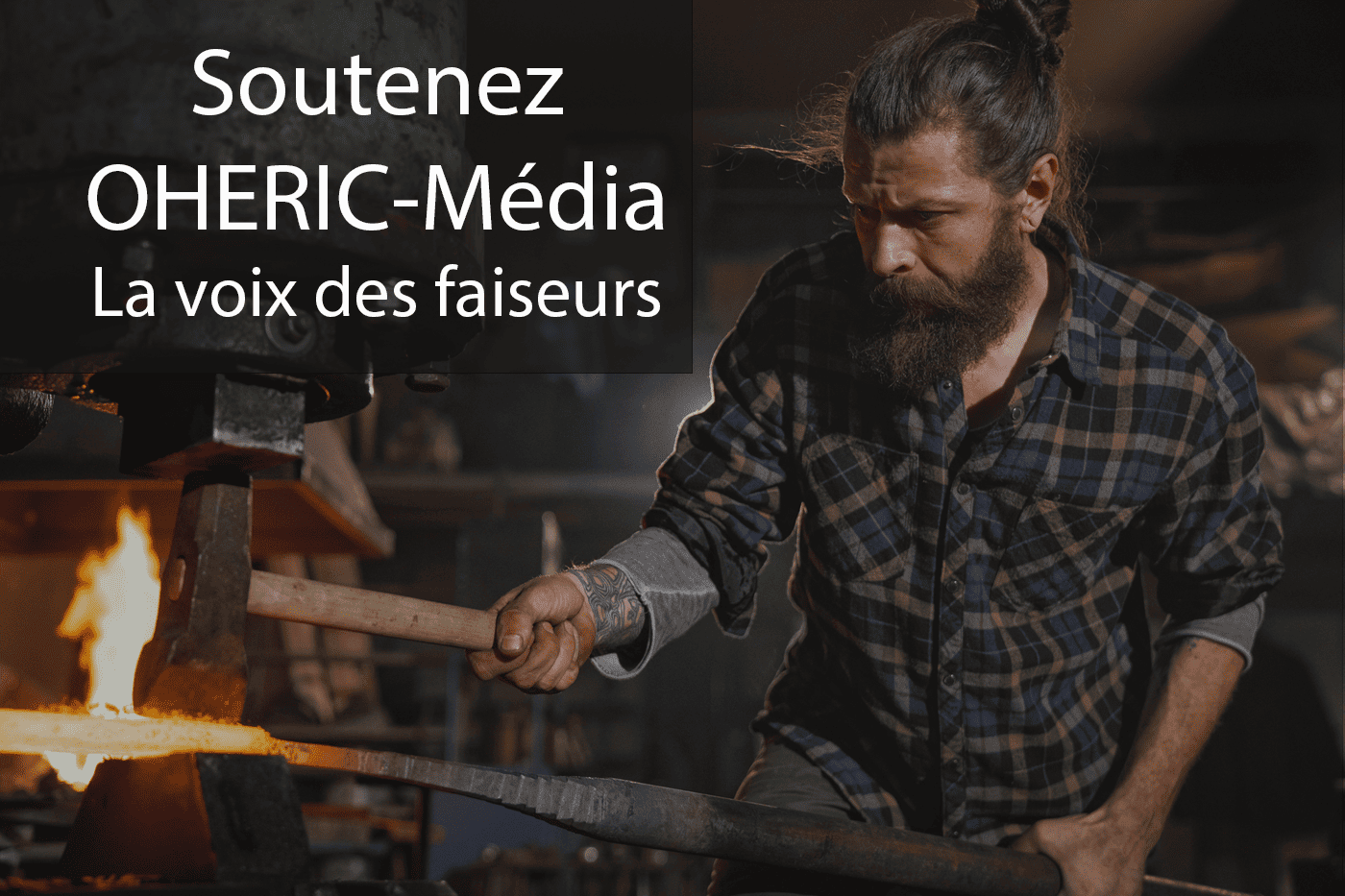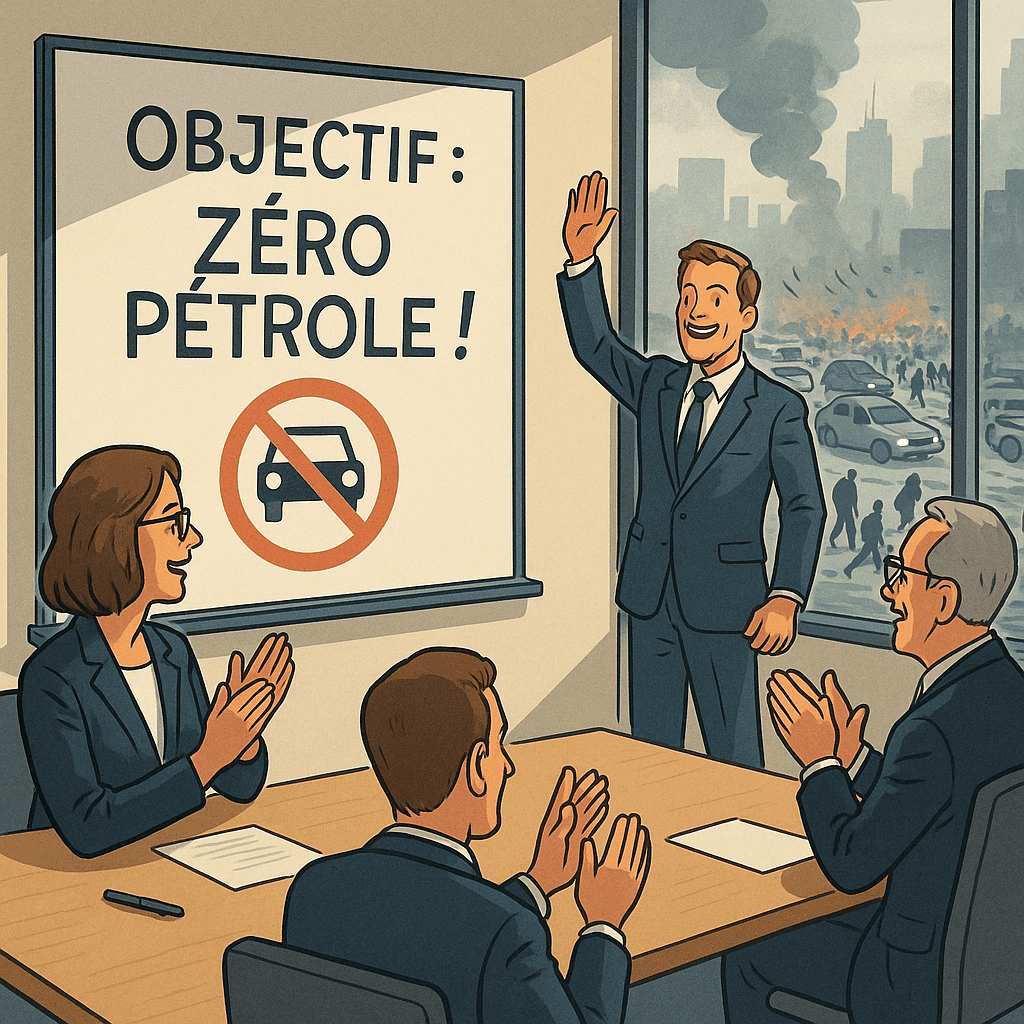Photo d’illustration : GIEE BECO – Bande écologique des Coutiats
 Une experte engagée au service de l’agriculture et de l’environnement |
Ingénieure diplômée de l’ENGEES et de l’INET, Josette Marrant a dédié sa carrière à la gestion durable des ressources naturelles et à la défense des agriculteurs. Ancienne directrice de la Chambre d’Agriculture de la Dordogne, elle a également exercé au sein de la police de l’eau et du Conseil Départemental, enrichissant son expertise sur les politiques agricoles et environnement.
Retraitée, mais toujours active, elle utilise les réseaux sociaux pour porter un regard critique et constructif sur les grands enjeux écologiques, s’imposant comme une « poil à gratter » dont les contributions éclairent les débats et nourrissent le dialogue public.
|
Au fil de votre carrière, comment avez-vous vu évoluer la place accordée à l’expérience de terrain dans les politiques agricoles et environnementales ? Pensez-vous qu’elle est aujourd’hui suffisamment valorisée ?
J’ai travaillé pendant 10 ans, de 1980 à 1990, au début de ma carrière, à mettre en place des projets d’irrigation en Dordogne dans un service connexe à la Chambre d’Agriculture. Nous travaillions main dans la main avec la Direction Départementale de l’Agriculture pour obtenir des financements et nous construisions des argumentaires pour que la Région et le Département nous accompagnent. Notre expertise terrain suffisait pour convaincre. En matière d’accompagnement des agriculteurs, pour mieux gérer l’irrigation, nous nous appuyions sur les services de recherche du CEMAGREF[1] et c’est ainsi que nous avions mis en place des tensiomètres[2] et conçu des fiches pour piloter l’irrigation, quand la déclencher et quelle dose apporter.
En 1992, tout a changé. En Dordogne notamment, s’est mis en place le Syndicat Interdépartemental Dordogne EPIDOR qui a élaboré une charte, à partir de rencontres ouvertes aux associations de protection de l’environnement qui commençaient à se faire entendre. Une charte certes non réglementaire, mais tout de même… Lorsque des projets agricoles ou industriels étaient présentés au Conseil Départemental d’Hygiène, la représentante de la société de protection de l’environnement ramenait toujours le débat à un point de la charte ou un autre. En même temps, la première loi sur l’eau est sortie avec une nomenclature qui précisait si les travaux ou les installations relevaient de l’autorisation ou de la simple déclaration. Initialement, c’était pour simplifier, mais ça n’a fait que compliquer. Les associations ont pris la main et ont cherché à trouver des entrées dans la nomenclature qui conduisaient systématiquement à une demande d’autorisation.
Dès lors, l’expertise de terrain n’a plus rien valu. Elle s’est trouvée en concurrence avec l’avis des associations qui se fondait (et se fonde toujours) la plupart du temps sur des arguments bateau : « Ça risque de polluer les ressources en eau. » « Ça porte atteinte à la biodiversité. » Sans compter les appréciations purement subjectives : « Le maïs, c’est mal. » « L’élevage intensif maltraite les animaux. » Peu importaient les arguments économiques.
Dans toutes les réunions, notamment sur l’eau, car il y en a beaucoup avec la mise en place des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et les plans de gestion (PGE), l’expertise de terrain des représentants de l’agriculture se heurte à la position des associations et des services de la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement).
Vous avez dirigé la Chambre d’Agriculture de la Dordogne pendant 15 ans. Quels enseignements concrets tirez-vous de cette expérience, et comment ces enseignements peuvent-ils enrichir les débats actuels sur la durabilité en agriculture ?
Les chambres d’agriculture sont des organismes mal cernés par les agriculteurs (je pense que le résultat des élections en témoigne), les collectivités territoriales (qui les prennent pour des associations) et le grand public. Ce sont des établissements publics de l’État dirigés par des professionnels élus, soumis au contrôle de l’État, et chargés de la mise en place de politiques publiques. Ils vivent grâce aux ressources issues de l’impôt sur le foncier, des subventions et de la vente de prestations. Ils peuvent également faire remonter des revendications. Partant de là, la marge d’initiative n’est pas énorme. Les conseillers sont au travail pour mettre en place sur le terrain des politiques voulues par le ministère de l’Agriculture ou par les collectivités territoriales, notamment les Régions.
Localement, en Dordogne, nous avons privilégié la constitution de groupes locaux par petites régions pour répondre à des problématiques locales. C’est ainsi que depuis longtemps, l’agritourisme et la vente de produits locaux ont été développés. Nous avons également mis en place un système d’accompagnement de l’installation via un prêt d’honneur, qui a ensuite été généralisé à la Région et répliqué un peu partout.
Les chambres ont aussi pour vocation de faire valoir l’intérêt de l’agriculture dans un grand nombre de structures qui se sont énormément développées, notamment en matière de gestion de l’eau. Cependant, il est très difficile de pouvoir faire valoir nos points de vue, car nous sommes minoritaires. Elles portent aussi des revendications cruciales pour l’agriculture du département. Pour ce qui nous concerne en Dordogne, la reconnaissance des particularités de notre territoire en Zone Intermédiaire est essentielle. Le Préfet est alors l’interlocuteur privilégié, et selon sa personnalité, la collaboration est plus ou moins efficace.
La question du climat a été abordée dès le début des années 2000 avec un programme comme Adaptaclimat[3], afin notamment d’appréhender quelle pourrait être l’évolution des productions dans le contexte de changement climatique.
Les pratiques agricoles ont beaucoup évolué en 40 ans, mais il est difficile de définir simplement cette évolution pour être entendu par le grand public, car chaque production a eu sa propre évolution technique. En élevage, les bâtiments ont considérablement changé pour offrir plus de bien-être animal, plus de confort de travail et moins de pollution, et ce au prix d’investissements considérables.
L’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires a également évolué, avec une diminution du nombre de molécules utilisées. Les tracteurs permettent un travail de précision grâce à l’électronique embarquée. Les auxiliaires de cultures sont beaucoup utilisés en arboriculture. La pratique des couverts végétaux en interculture est largement répandue. En Dordogne, depuis une douzaine d’années, la chambre produit un document annuel sur les innovations, Innov’A.
Changer de pratiques, c’est lourd de conséquences pour l’agriculteur
L’équilibre entre protection environnementale et intérêts des agriculteurs est souvent un défi. Quels outils ou approches pratiques recommandez-vous pour conjuguer ces priorités sur le terrain ?
Je crois que la meilleure façon de le faire est de leur faire confiance un petit peu. Changer de pratiques, c’est lourd de conséquences pour l’agriculteur ; c’est lui faire prendre des risques quand déjà le métier est un métier à risques sanitaires, climatiques et économiques.
Les règles environnementales établies au niveau de l’Europe et déclinées au niveau national ne se fondent que sur les considérations environnementales et s’imposent sans que la profession puisse dire quoi que ce soit. Tel produit est interdit et c’est comme ça. Une mise aux normes de bâtiment d’élevage est décidée et c’est comme ça ! Alors certes, au niveau européen, les discussions ont eu lieu avant la sortie des normes et les représentants de la profession se sont fait entendre, mais souvent ils ont perdu.
Les agriculteurs ont compris que des excès avaient été commis dans la période des Trente Glorieuses où la chimie et les engrais étaient la réponse à l’augmentation de la productivité, sans se soucier du sol. Par ailleurs, il s’agit de produits onéreux et donc les agriculteurs cherchent à en réduire l’utilisation au juste besoin. Ils ont bien accepté de se former aux risques de l’utilisation des produits phytosanitaires et ils ont adopté les mesures nécessaires pour se protéger et protéger le voisinage en adoptant du matériel adéquat.
L’autre difficulté de concilier production et environnement, c’est pour les projets d’aménagements, que ce soit des bâtiments d’élevage, des réserves d’eau ou des méthaniseurs. Depuis les années 90, ça devient très difficile. Les oppositions qui relèvent souvent du « pas de ça près de chez moi » utilisent les arguments à la mode, et celui de la biodiversité est systématiquement brandi.
Il y a toujours sur le site des projets la présence d’une espèce plus ou moins rare dont les opposants vont s’emparer pour réclamer la protection absolue de son biotope
Les dossiers de demande d’autorisation cherchent à répondre à toutes les exigences de la réglementation en procédant à des études d’impact. Mais il y a toujours sur le site des projets la présence d’une espèce plus ou moins rare dont les opposants vont s’emparer pour réclamer la protection absolue de son biotope.
La réglementation impose qu’au nom de la biodiversité, la préservation d’espèces menacées soit impérative pour tout projet. Même les mesures qui consistent à recréer des conditions favorables pour cette espèce ailleurs n’ont pas l’heur de plaire aux défenseurs de la nature. On voit bien quel est l’angle d’attaque auprès des tribunaux pour contester des décisions préfectorales : le pétitionnaire a mal appréhendé la défense de l’espèce menacée.
Or, je constate que les projets qui ont été menés dans les années 80 sans cette batterie de règles ne sont pas du tout contestés et même qu’on leur trouve un intérêt. Par exemple, les réserves d’eau constituent maintenant des réserves de biodiversité. La nature s’est adaptée !
Je pense que ce qui exaspère le plus les agriculteurs, c’est le manque de nuance dans la réglementation. Tout est d’égale importance dans la réglementation environnementale. Et seule une raison impérative d’intérêt public majeur peut permettre de déroger à la préservation de l’espèce menacée. Bien sûr, l’intérêt public n’est jamais validé par les détracteurs ! Selon une étude de la DREAL, lorsqu’un recours est formé contre une dérogation, il conduit à l’annulation de 56 % de cette dernière, cette décision portant sur la raison impérative d’intérêt public majeur dans 79 % des cas.
Les juges ont normalement à opérer une balance entre l’intérêt public majeur et l’état de conservation favorable des espèces dans leurs aires de répartition naturelle (qui est l’objet de la protection et non chaque spécimen). Lorsqu’il s’agit par exemple de travaux dans une rivière, l’aire de répartition des espèces protégées est très grande et donc les espèces ne risquent pas d’être détruites, elles migreront à l’aval. L’intérêt public majeur n’a pas à être justifié en soi, mais bien en rapport avec la gravité que représenterait la disparition de la zone sur laquelle est l’espèce protégée. Or, ce n’est pas toujours comme ça que raisonnent les juges !
La question qui doit être posée est donc : certes, les projets portent atteinte à une zone sur laquelle vivent des espèces protégées, mais quelles sont les autres zones alentour sur lesquelles existent ces espèces et est-ce donc une telle menace à l’existence de ces espèces ? L’espèce est-elle vraiment menacée ?
On pourrait penser que le dialogue très en amont du projet peut contribuer à le faire accepter. En fait, de moins en moins, car on a des postures idéologiques ou des oppositions du type NIMBY[4] (je ne veux pas de ce projet à mes fenêtres !) qui rendent les opposants sourds aux arguments.
Les portes ouvertes des exploitations sont une bonne idée pour montrer la réalité des exploitations à la fois pour les voisins non agriculteurs mais aussi le grand public. Les critiques sont issues de milieux très étrangers à l’agriculture qui gardent des souvenirs nostalgiques de vacances à la campagne chez des grands-parents.
De l’importance des actions concrètes
Vous avez travaillé dans la police de l’eau et la gestion des ressources naturelles. Quelles solutions concrètes avez-vous vues ou initiées qui pourraient servir de modèle pour d’autres régions ?
La période au cours de laquelle j’ai exercé la police de l’eau, c’est de 1991 à 1995. C’était plus facile qu’aujourd’hui. Nous avions la possibilité de voir le préfet et de lui expliquer les enjeux, la situation des ressources en eau et lui démontrer qu’il n’y avait pas péril en la demeure, et il suivait notre préconisation. Depuis le début des années 2000, les fonctionnaires de l’État en DDT[5] sont tétanisés par la crainte de recours contre les arrêtés et fortement mis sous contrainte par les agents des DREAL[6], qui sont d’emblée sceptiques sur les projets. La formation des ingénieurs s’est beaucoup orientée sur les questions environnementales plus que sur les techniques.
Donc, en Dordogne comme ailleurs, nous n’avons pas trouvé de solutions miracles. Nous n’avons obtenu des résultats que lorsque nous avons su nous mobiliser collectivement en construisant des argumentaires tout à fait étayés. La seule victoire a été d’avoir réussi à ne pas se faire imposer un classement en zone vulnérable (lorsque les taux de nitrates dépassent une norme) parce que la DREAL allait au-delà des normes. Cela a été une manifestation agricole menée en régions Aquitaine et Midi-Pyrénées à l’époque qui a permis de se faire entendre.
Sur la question des volumes d’eau attribuables par bassin versant pour les autorisations d’irriguer, là aussi, cela a été l’objet de négociations âpres de la profession agricole des deux régions contre la DREAL, sans obtenir autant que souhaité.
C’est terrible de constater qu’il n’y a que les rapports de force qui portent leurs fruits, ce qu’a bien compris le mouvement des Soulèvements de la Terre, qui mène des actions sur le terrain et dans les médias, s’attachant les appuis de toute une catégorie de prétendus spécialistes des questions environnementales.
Mais est-il encore possible de se mobiliser collectivement sur la bataille de l’eau à l’heure où les convictions priment sur la raison ?
Sur les réseaux sociaux, vous défendez régulièrement les agriculteurs et critiquez certaines subventions agricoles. Que proposez-vous pour encourager une agriculture à la fois économiquement viable et écologiquement responsable ?
Je ne me souviens plus ce que j’ai critiqué. La profession d’agriculteur est soumise à de nombreux aléas climatiques, sanitaires et économiques, et donc les changements voulus par la société constituent un nouveau risque si moins de protection des cultures et moins d’engrais sont utilisés. Il est donc normal que des incitations financières accompagnent ces changements. C’est le rôle des mesures agro-environnementales liées à la PAC. Néanmoins, parfois, on se demande si les contraintes imposées par ces subventions ne sont pas d’une telle lourdeur qu’elles en perdent tout l’intérêt. La crainte des agriculteurs qui en bénéficient, c’est toujours le contrôle : ne pas être totalement dans les clous et en perdre le bénéfice. Mais néanmoins, elles restent essentielles pour le revenu des agriculteurs.
L’accompagnement de la conversion vers le bio a eu un effet très important en matière d’augmentation des surfaces, sauf que le marché n’a pas suivi, et c’est ainsi qu’on assiste à des déconversions.
Je ne sais pas comment ces mesures sont établies, mais il faut qu’elles soient réellement incitatives : que cela ne coûte pas plus de travail et de charges que cela ne procure de gain.
Je ne peux pas m’empêcher de dire que telle affirmation est fausse si elle l’est
Votre franc-parler et votre humour sur Twitter sont appréciés. Pensez-vous que ces qualités sont essentielles pour sensibiliser à des sujets complexes comme l’environnement et l’agriculture ?
Je suis depuis toujours une adepte de la vulgarisation de notions complexes. Je ne peux donc pas m’empêcher de dire que telle affirmation est fausse si elle l’est, et je prends alors le temps de chercher à désarçonner l’interlocuteur, à défaut de le persuader. Je m’enferme parfois dans des débats qui n’ont plus ni queue ni tête, car on me retourne souvent des sophismes qui éloignent du sujet de base. Et oui, parfois, cela m’amène à utiliser l’humour parce que cela devient totalement débile.
Je dois être une adepte des causes perdues, car je suis capable de rester deux jours en discussion avec la même personne.
Vous critiquez la régionalisation des structures consulaires pour leur manque de rentabilité économique. Quelle place donnez-vous à l’échelle locale dans la construction de politiques agricoles pertinentes ?
C’est assez extraordinaire de voir cet engouement pour les structures géantes ! Big is beautiful. Les nouvelles régions sont pour certaines énormes : Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes… Idem pour les communautés de communes avec les « Grand ceci » ou « Grand cela ». L’argument qui a été utilisé, c’était une réduction des coûts de fonctionnement. Mais qui se préoccupe de constater ce qu’il en a été réellement ? Le coût intellectuel pour faire des synthèses de présentation de l’agriculture de ces régions est énorme, aussi bien au niveau de la Région que de la Chambre régionale, et pour quel avantage ? L’exemple en Nouvelle-Aquitaine : quel lien entre l’agriculture creusoise et celle de la Gironde ? Ou entre celle de la Corrèze et celle de la Charente-Maritime ? Déjà au sein d’un département comme la Dordogne, qui est un grand département, les petites régions agricoles sont très différentes, et les problématiques de la viticulture bergeracoise ne sont pas celles des éleveurs de la partie limousine.
On vante le local pour l’alimentation, mais pas pour les politiques d’aménagement.
Je l’ai dit plus haut : ce qui fonctionne en agriculture, c’est la réflexion collective à la bonne échelle, quand elle permet de traiter de sujets complètement partagés. Le territoire français, ce sont des agricultures multiples aux besoins différents, et donc les politiques agricoles les mieux adaptées sont à trouver au sein de petites régions agricoles. Les GIEE[7] mis en place par Stéphane Le Foll ont été une excellente idée. Il s’agit de groupes animés par un technicien agricole, qui échangent sur leurs pratiques, qu’ils soient en bio ou en conventionnel.
Vous encouragez le dialogue et le débat public. Quels sont les principaux freins que vous avez rencontrés dans la confrontation des idées sur des sujets aussi clivants que l’agriculture ou l’environnement ? Et comment y remédier ?
Je ne peux admettre que la cause soit entendue : l’agriculture devrait s’effacer au profit de l’environnement. Certes, le rapport de force ne plaide pas en sa faveur, la société dans son ensemble étant endoctrinée par le discours politique et médiatique : l’agriculture détruit la nature et empoisonne.
Les débats télévisés ou radiophoniques sont souvent sans intérêt (il y a bien certaines exceptions, notamment l’ancienne émission « Le Temps du débat » sur France Culture) dans des formats courts avec des invités médiatiques (la fameuse Emma Haziza ou l’inénarrable Benoît Biteau) et des journalistes qui n’ont pas de connaissances suffisantes pour débusquer les bêtises prononcées. Quant aux émissions d’investigation, elles ne sont montées que pour faire sensation (Élise Lucet ou Hugo Clément). Et puis, Le Monde avec les Stéphane Foucart et Mandard… Nous ne pouvons agir qu’après coup et il faut ramer…
Je loue l’initiative de France Agritwittos, cette association qui est désireuse de faire connaître et comprendre le monde agricole et qui promeut une image positive de l’agriculture française. Faire voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide. Ils sont agriculteurs et sont les mieux placés pour le faire.
En ce qui me concerne, j’aime aller sur les réseaux démonter les arguments des opposants en apportant une information scientifique et technique sur les sujets que je connais bien, notamment la gestion des ressources en eau et l’irrigation. Fournir des schémas de circulation de l’eau dans son cycle complet peut aider à mieux comprendre les enjeux.
Repérer dans les réseaux des personnes qui partagent la même envie, qui prennent le temps de faire des développements sur des sujets complexes, comme Terre à Terre, qui est un prof de biologie, ou Jiembé, mais aussi des juristes en environnement comme Carole Zakine, ou les publications de l’AFIS avec notamment François-Marie Bréon. Mais aussi Gil Rivière-Wekstein.
Je pense que cette petite communauté existe. Nous complétons nos connaissances respectives, relayons les propos des uns et des autres et réussissons à toucher parfois des milliers de personnes. Là aussi, la force d’un collectif qui ne dit pas son nom mais existe pourtant.
Quel est le résultat de notre combat ? Sur la politique de la ressource en eau, peut-être la bascule s’est-elle effectuée, et le stockage n’apparaît plus comme une hérésie technique. Pour les produits de traitement des cultures, c’est plus compliqué, car nous payons le fait que les élus se sont pliés à la pression des lobbies des Verts, et revenir en arrière n’est pas facile.
Mais le combat continue.
Notes
[1] Le Centre d’Etudes du Machinisme Agricole, du génie Rural, des Eaux et Forêts est un institut public de recherche pour l’ingénierie de l’agriculture et de l’environnement.
[2] Le tensiomètre permet de surveiller l’humidité du sol et d’adapter l’irrigation aux besoins des cultures.
[3] Fiche de présentation du projet ADAPTACLIMA.
[4] Le NIMBY, acronyme de « Not In My Backyard » – pas dans mon jardin – désigne l’opposition de riverains à un projet local jugé indésirable, et trouve son origine dans les mouvements citoyens des années 1970 aux États-Unis face à des développements industriels ou infrastructurels.
[5] Direction départementale des territoires.
[6] Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.
[7] Les GIEE, ou Groupements d’intérêt économique et environnemental, sont des collectifs d’agriculteurs reconnus par l’État français pour améliorer les performances économiques, environnementales et sociales de leurs exploitations grâce à des projets agroécologiques, et ont été instaurés par la loi d’avenir pour l’agriculture du 13 octobre 2014 en France.
-
Sébastien Tertrais: Auteur/AutriceVoir toutes les publications Fondateur et rédacteur en chef à OHERIC-Média