Cet article est aussi un podcast
Le constat : un monde qui se fragmente
Il suffit d’observer le monde pour comprendre que quelque chose s’est cassé. Plus personne ne semble vraiment relier les choses. Chacun parle depuis son territoire, son champ, sa spécialité, son confort intellectuel et moral. Nous avons remplacé la pensée globale par une mosaïque de convictions locales, chacune persuadée d’être la seule vraie.
Je le vois depuis des années, à travers mes expériences les plus diverses : la sociologie, le droit, la psychologie, l’économie, l’énergie… Partout, la même logique de cloisonnement. Les institutions ne se parlent plus. Les disciplines s’ignorent. Et les décideurs, souvent très sûrs d’eux, raisonnent à l’intérieur de leur silo comme s’il contenait le monde entier.
Ce n’est pas qu’ils soient mal intentionnés — la plupart sont même persuadés de bien faire. Mais ils confondent cohérence interne et pertinence globale. Leurs certitudes viennent du cercle qui les valide, pas de l’épreuve du réel. Ainsi naissent les politiques absurdes, les débats stériles, les crises mal gérées que nous connaissons aujourd’hui.
La modernité, en cherchant à tout spécialiser, a oublié que la connaissance n’a de sens que reliée. Or aujourd’hui, plus personne ne relie. Le médecin ignore le sociologue, le juge ignore le psychologue, le politique ignore l’ingénieur, et chacun brandit son expertise comme un talisman. Le résultat est là : une société éclatée, où les décisions sont prises par des fragments de savoir déconnectés du reste.
Cette fragmentation rassure : elle simplifie le monde, permet de désigner des coupables, de trancher vite. Mais elle détruit le sens.
Et elle engendre ce que j’appelle le règne des siloïstes — ces individus brillants dans leur périmètre, mais aveugles au-delà.
Je suis de cette génération qui a vu le monde passer de l’analogique au numérique, du local au global, du réel au virtuel. En quarante ans, nous avons tout connecté — sauf nos intelligences. Le résultat, c’est un monde saturé d’informations mais pauvre en compréhension.
Le drame, c’est que cette logique n’est plus seulement une erreur de méthode : elle est devenue une culture. Une manière d’être, de penser, de gouverner. Nous vivons dans des silos mentaux, sociaux, institutionnels. Et plus ces murs sont hauts, plus chacun croit voir clair.
Le siloscope — cette idée que j’avance ici — n’est pas un gadget conceptuel. C’est une nécessité. Il nous faut un instrument pour détecter les cloisonnements de la pensée, mesurer la perte de transversalité, comprendre pourquoi la société s’asphyxie alors qu’elle n’a jamais produit autant d’experts.
Le raisonnement en silo : définition et portée
Penser en silo, c’est réduire le monde à ce qu’on en voit depuis son poste d’observation.
C’est raisonner à l’intérieur d’un cadre fermé, en oubliant que la réalité déborde toujours de toutes parts. Le silo rassure : il protège du vertige de la complexité. Mais il isole. Et à force d’isoler, il finit par déformer.
Le raisonnement en silo est une pathologie moderne. Il se nourrit de trois choses :
- la spécialisation des savoirs,
- la bureaucratisation des décisions,
- et la moralisation du débat public.
Chacun de ces éléments, pris séparément, n’est pas mauvais. Mais ensemble, ils créent un système où l’intelligence collective se morcelle.
Dans les univers administratifs ou politiques, le silo est structurel : chaque service agit selon ses procédures, sans se soucier des effets collatéraux. Dans le monde intellectuel, il est culturel : on valorise la spécialisation au détriment de la transversalité. Et dans la sphère publique, il devient moral : chacun s’enferme dans une position qu’il croit juste, sans plus jamais la confronter au réel.
Ce mode de pensée simplifie tout. Il divise le monde en deux : d’un côté, ceux qui pensent “bien” ; de l’autre, ceux qui “ne comprennent pas”. Il réduit la complexité à une série d’oppositions : progrès ou réaction, victime ou bourreau, inclusif ou excluant. Tout ce qui échappe à ces catégories devient suspect.
C’est là que le raisonnement en silo devient dangereux. Il ne se contente plus de séparer : il juge.
Et comme tout jugement partiel, il finit par créer les conditions mêmes des clivages qu’il prétend combattre.
La société contemporaine vit dans cette illusion : en segmentant les problèmes, elle croit mieux les résoudre. En réalité, elle les démultiplie. Chaque institution produit sa propre interprétation du réel — judiciaire, sociale, médicale, médiatique — et chacune s’étonne ensuite que le résultat global soit incohérent.
Le silo, c’est le contraire du discernement. Là où le discernement relie, nuance et hiérarchise, le silo découpe, isole et absolutise. Il transforme le savoir en certitude, l’expérience en protocole, la réflexion en procédure.
Et parce qu’il donne une impression d’ordre, il attire ceux qui n’ont jamais affronté la complexité du monde. Les esprits jeunes, théoriques ou fragiles s’y réfugient comme dans un cocon idéologique. On y parle la même langue, on y reçoit les mêmes validations, on y évite les contradictions.
Mais le prix à payer est immense : le réel finit toujours par se venger. Les problèmes mal pensés deviennent des crises. Les idées non reliées deviennent des idéologies. Et les institutions, saturées de leurs propres certitudes, se désagrègent lentement de l’intérieur. Le raisonnement en silo, c’est la victoire des logiques simplistes sur la vie.
Interlude philosophique : La foule, la peur et la tentation de la simplicité
Depuis toujours, l’humanité affronte des questions angoissantes : la mort, l’injustice, la souffrance, la peur du lendemain. Mais jamais ces peurs n’ont été autant institutionnalisées.
Nous finançons désormais — souvent sans même nous en rendre compte — des organisations, des causes et des structures entières dont la survie dépend de l’entretien de ces angoisses : la peur du climat, la peur économique, la peur de la guerre, la peur des autres. L’inquiétude est devenue un marché.
Lire aussi Comment l’institutionnalisation de l’assistance fait glisser la Fenêtre d’Overton
Or, la peur appelle la simplification.
Quand l’incertitude nous ronge, nous cherchons des repères clairs, des récits simples, des coupables identifiables. C’est là que prospèrent les Siloïstes — ces penseurs fragmentaires, rassurants par leur réduction du monde à un problème soluble. Ils ne visent pas la vérité, mais la lisibilité.
Et la foule, comme Socrate l’avait déjà compris, se reconnaît en eux : elle s’agrège autour de ceux qui simplifient, non de ceux qui éclairent.
La foule naît de la rencontre des simplificateurs. Elle n’a pas besoin de comprendre, elle veut croire. Et dans un monde saturé de complexité, la croyance est plus confortable que la pensée.
Nous vivons ainsi dans une époque paradoxale : nous n’avons jamais eu autant d’informations, mais nous ne savons plus rien relier.
Nous avons remplacé la sagesse par la donnée, la réflexion par le signal.
Nos débats ressemblent à des assemblages de fragments : des bribes de sciences, de morale, d’émotion — juxtaposées sans hiérarchie ni continuité.
C’est pourquoi la phrase de Thoreau — “Il existe de nos jours des professeurs de philosophie, mais de philosophes, point.” — résonne plus que jamais.
Nous avons trop de théoriciens, trop de commentateurs, trop d’idéologues, et pas assez d’expérimentateurs du réel.
Trop de voix qui enseignent ce qu’il faut penser, pas assez d’âmes qui vivent ce qu’elles pensent.
La philosophie, dans son sens premier, n’était pas un discours mais une pratique. Socrate questionnait, marchait, doutait. Aujourd’hui, on disserte, on certifie, on valide.
Le doute, jadis moteur du savoir, est devenu suspect. Et avec la disparition du doute, s’éteint peu à peu la pensée vivante.
Pourtant, le discernement — cette faculté de voir juste et de relier — naît précisément de l’expérience, de l’erreur, de la confrontation au réel.
La pensée abstraite, si brillante soit-elle, finit toujours par s’épuiser si elle ne plonge pas ses racines dans l’existence.
Corneille l’avait compris : “Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années.”
Mais il n’a jamais dit que la valeur dispensait de l’expérience.
L’âge n’est pas un mérite en soi, mais les épreuves qui le jalonnent forgent une profondeur que la jeunesse, même talentueuse, ne peut encore posséder.
C’est l’expérience seule qui donne cette assise, ce crédit, cette capacité à discerner ce qui brille de ce qui éclaire.
C’est là, peut-être, la clef pour sortir du règne des Siloïstes : réapprendre l’humilité, accepter de ne pas tout comprendre, de ne pas tout juger.
Et faire à nouveau confiance à ceux qui ont affronté le réel, non parce qu’ils détiennent la vérité, mais parce qu’ils ont appris à ne plus la confondre avec la facilité.
Conclusion — Retisser le fil du discernement
Le monde ne manque pas d’intelligence. Il manque d’écoute.
Partout, dans les entreprises, les associations, les territoires, les laboratoires ou les ateliers, il existe des femmes et des hommes d’expérience, capables de relier ce que d’autres ont séparé. Ils ne font pas de bruit. Ils ne cherchent pas à plaire. Ils savent simplement ce qu’ils ont vu, ce qu’ils ont vécu, et ce que cela leur a appris.
Ces voix existent. Elles sont nombreuses. Mais elles ne percent plus le brouhaha médiatique. Le débat public s’est transformé en concours de certitudes, alors qu’il devrait être un exercice de discernement.
Il est temps de redonner la parole à ceux qui ont traversé le réel — ceux qui savent ce qu’il en coûte de décider, de réparer, d’essayer.
Car si la société s’est fragmentée, elle peut aussi se recomposer.
Les passerelles existent déjà : entre les disciplines, entre les générations, entre ceux qui agissent et ceux qui pensent. Il suffit de les réactiver, de les faire circuler à nouveau.
C’est aux médias d’abord qu’il revient de jouer ce rôle : mettre en avant des figures d’expérience, des parcours solides, des voix qui ne cherchent pas la polémique mais la justesse.
Et c’est aux décideurs politiques d’en faire autant : écouter, non pas les plus bruyants, mais les plus cohérents.
L’avenir ne dépend pas de la multiplication des discours, mais de la qualité de ceux qui les portent.
Il ne s’agit plus de créer de nouveaux silos, mais de rouvrir les chemins entre eux.
Nous avons encore dans ce pays une richesse immense : celle des savoirs vécus, des intelligences patinées par le temps, des esprits qui ont su rester droits quand tout vacillait.
C’est à eux, désormais, qu’il faut prêter l’oreille.
Parce que le discernement n’est pas un luxe intellectuel.
C’est la condition même de notre survie commune.
À suivre…
Dans le prochain article, à paraître la semaine prochaine, nous poursuivrons cette réflexion dans l’article : “Le Siloscope — 2nde partie — une métaphore du discernement”, pour comprendre comment cet outil conceptuel peut nous aider à détecter les cloisonnements mentaux et à retrouver une vision globale du monde.
-
Sébastien Tertrais: AuteurVoir toutes les publications Fondateur et rédacteur en chef à OHERIC-Média

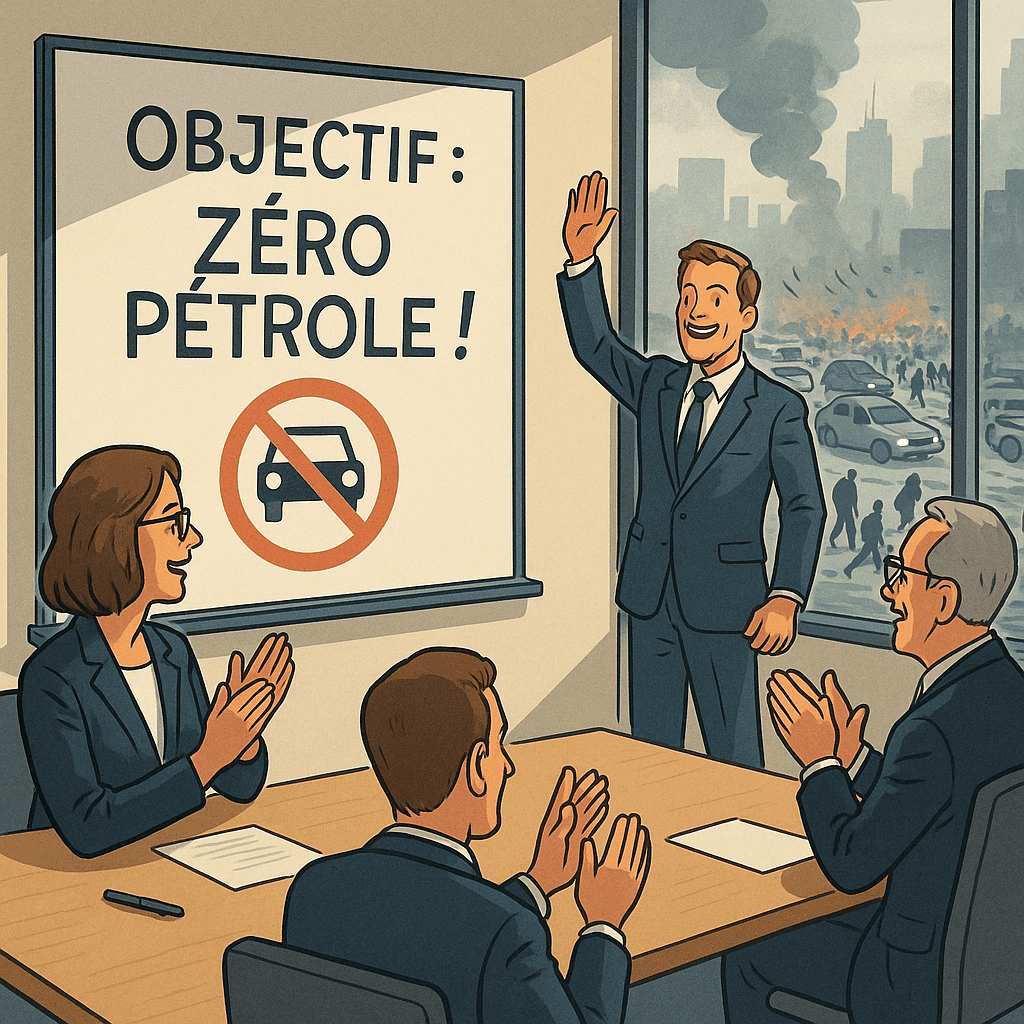


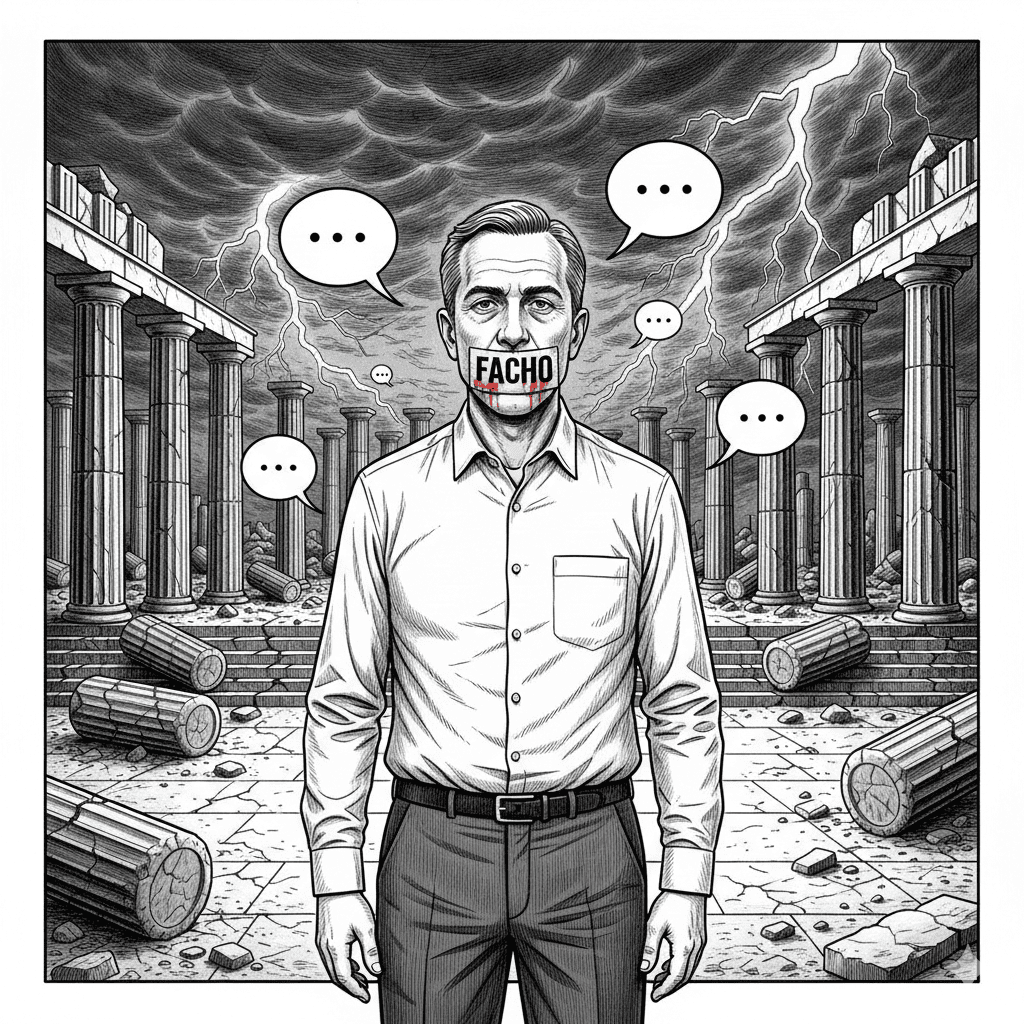
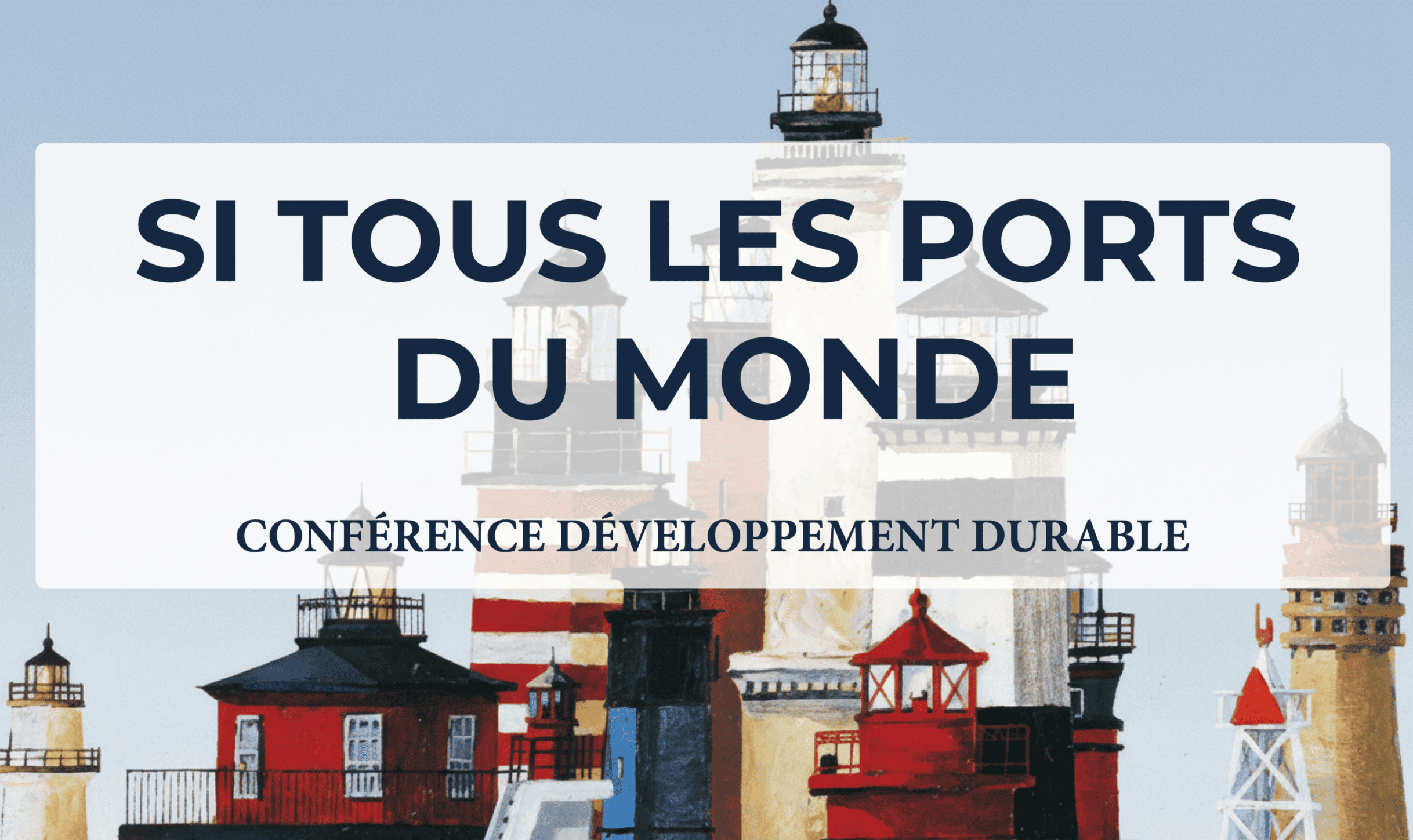
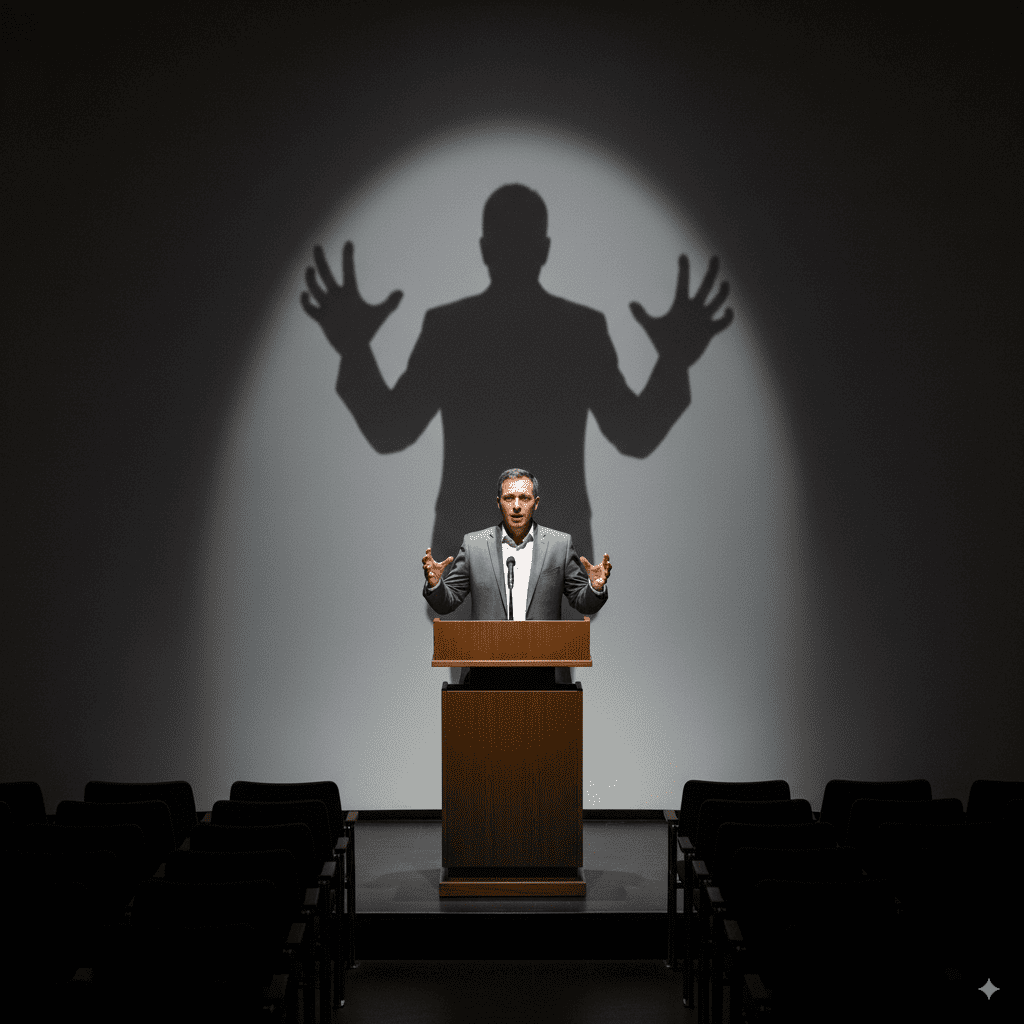
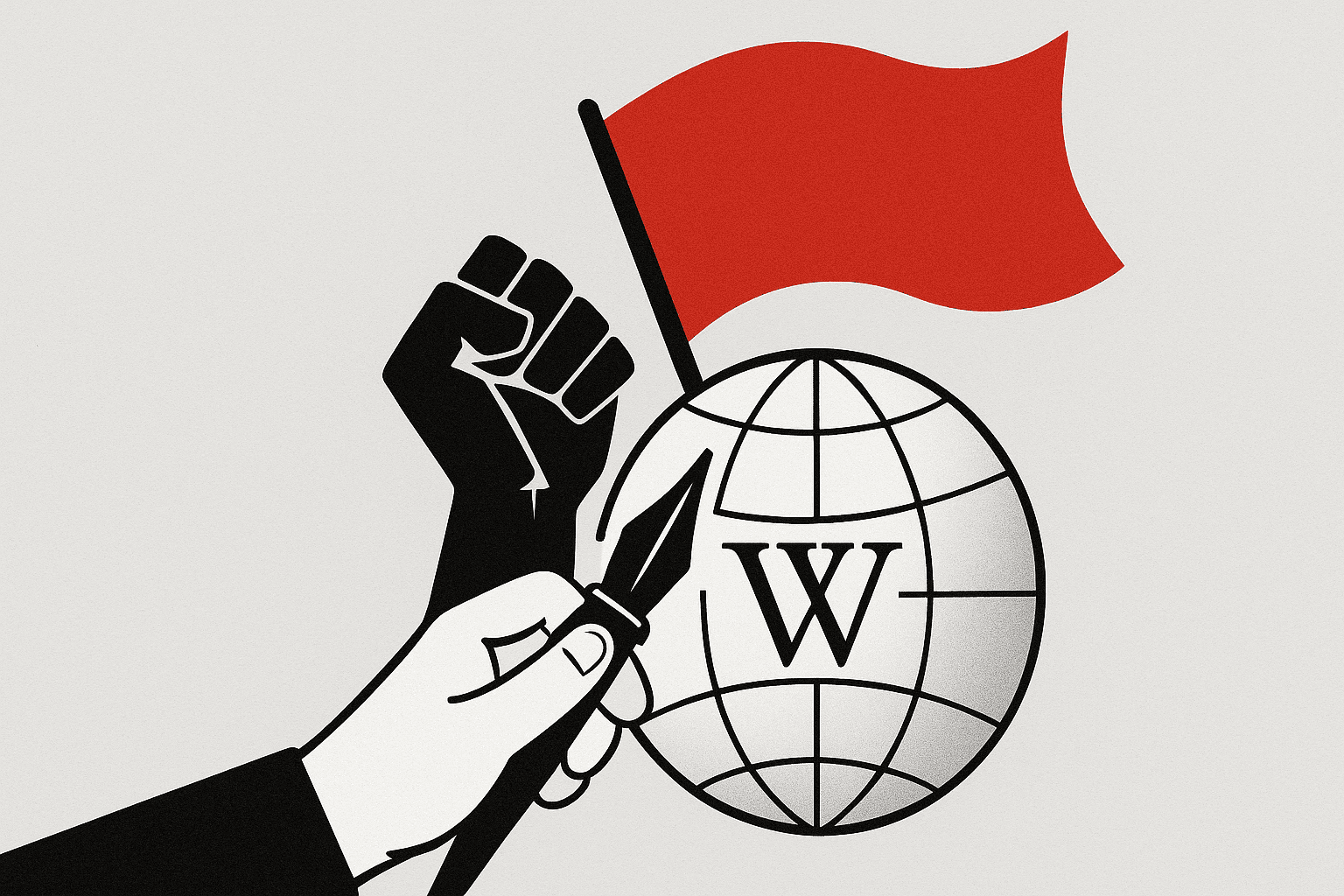


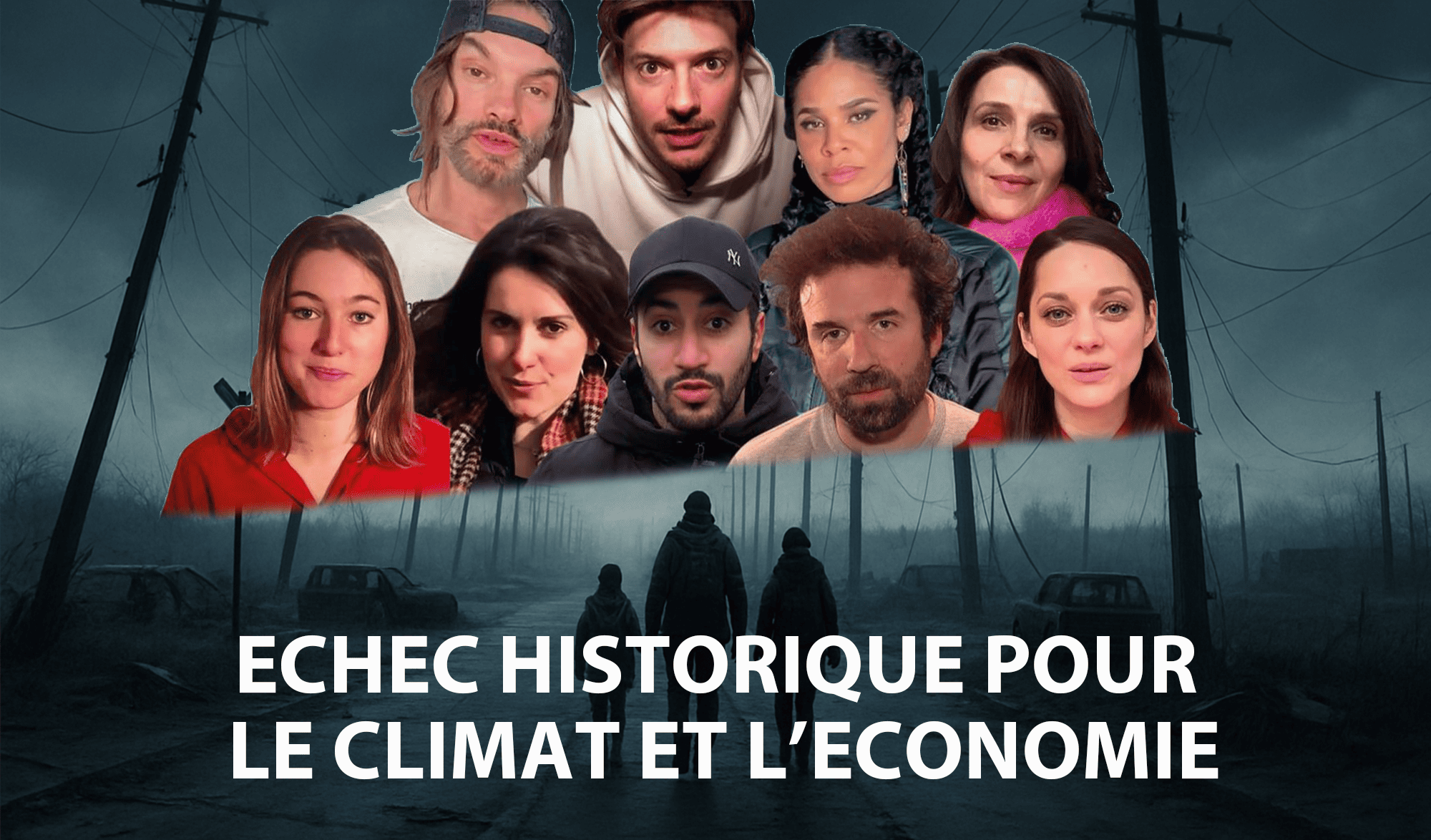


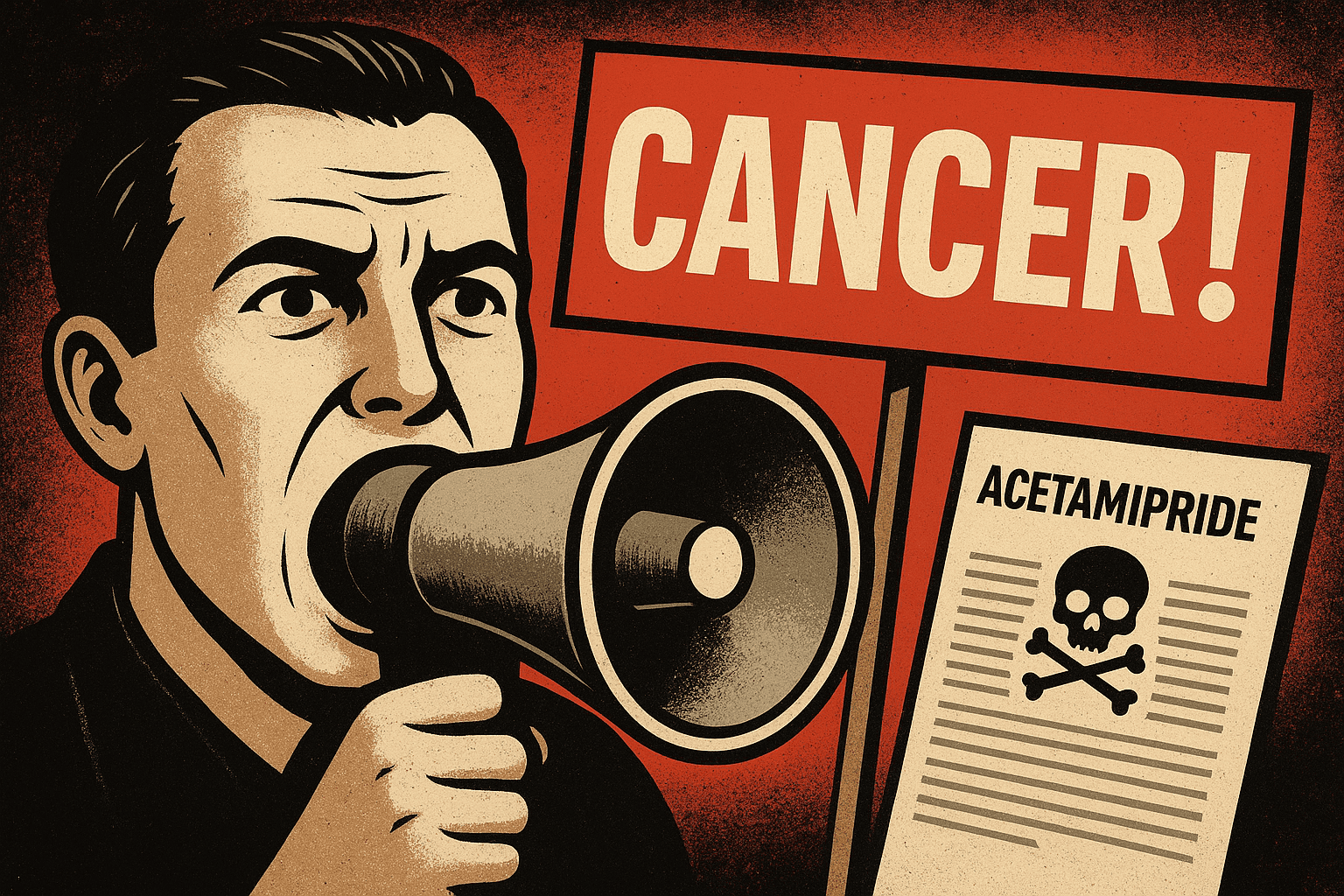

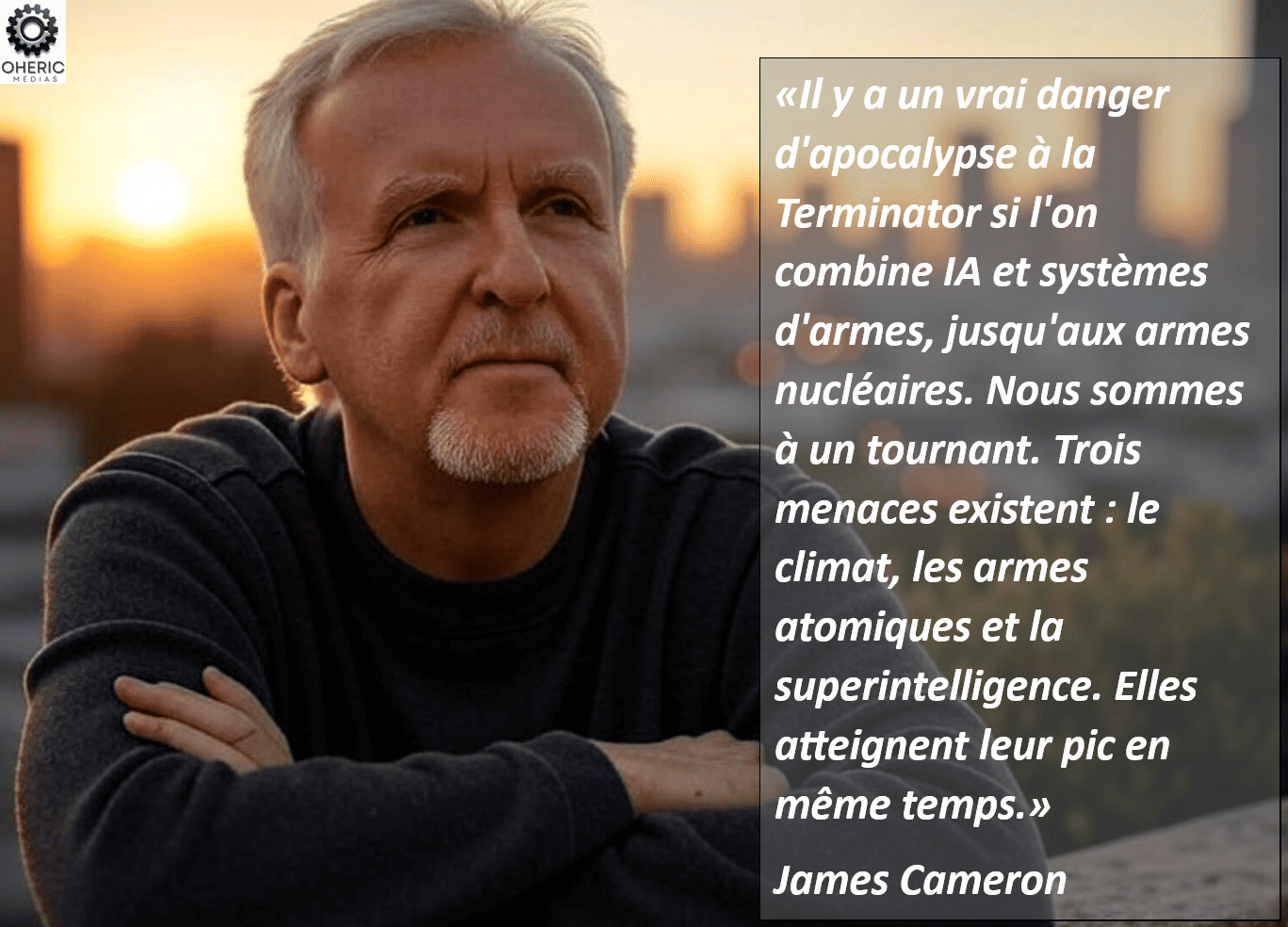
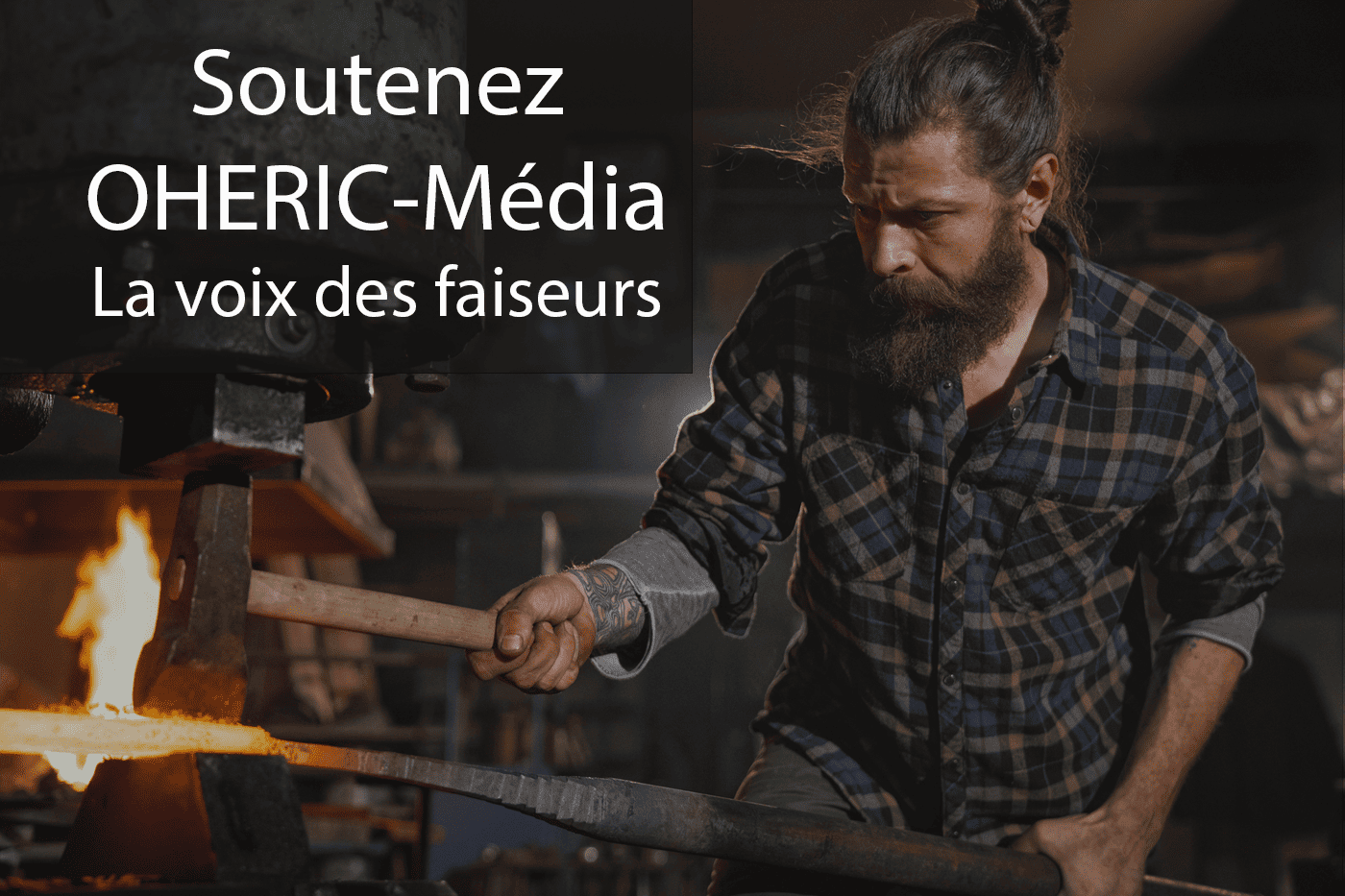

Une réponse
Très optimiste, Sébastien vous êtes.
Je partage votre approche mais, du haut de mes 63 ans, je doute qu’il y ait autant de « sagesse » parmi nos contemporains quelle que soit la génération. Du moins, je ne le constate pas.
Je ne parlerai pas des autres pays, mais en France, j’ai toujours eu l’impression que le « siloïsme » était d’actualité et ce depuis …
Lors de la rédaction d’une thèse pro sur le management, j’ai été amené à différencier 3 modèles de management (c’est en phase avec le sujet si ce n’est que je pars des organisations) : le premier, la base = le pyramidal dont le chef est « rationnel », « charismatique », appuyé par des « experts » face à un public atomisé et sensible à l’affect ; c’est du descendant, du normatif, du silo.
le 3ème et dernier = le réseau, le complexe, celui qui démontre le non-dit et amène le public à réfléchir. Je passe sur le 2ème qui est l’hémisphérique.
Or, mon constat personnel (j’ai été enseignant domaine forestier, économique) puis manager (opérationnel comme fonctionnel), mais aussi papa de 4 enfants, note que le français va au plus simple, préfère majoritairement un pilotage à une « carte mentale ». Et je n’abordai pas les réseaux sociaux comme nous les connaissons actuellement, vecteurs de simplification, « d’efficacité informative » pour la personne qui l’utilise, castrateurs -dans la plupart des cas- de réflexions. De fait, pour une grande partie du commun des mortels, être dans un silo est rassurant, pourquoi en sortir ?
Bien à vous
DK