Pain au levain : l’âme d’un aliment millénaire et l’humilité retrouvée
Le pain, c’est un peu comme l’humanité : il est né de hasards, s’est façonné au gré des civilisations, puis s’est industrialisé jusqu’à en perdre parfois son âme. Et comme nous, il a ses jours de grâce et ses jours de flemme. Dans son incarnation la plus noble, celle issue des levains naturels, il est plus qu’un aliment : c’est une leçon d’humilité.
Aux origines : la rencontre entre céréales et micro-organismes
Il y a environ 30 000 ans, les humains broyaient déjà des grains sauvages pour en faire des galettes plates. Les plus vieilles miettes de pain identifiées — datées entre 14 600 et 11 600 ans avant J.-C. — proviennent du site de Shubayqa, en Jordanie. Pas de baguette croustillante à l’horizon : juste des disques plats cuits sur pierre.
En Égypte antique, vers 2600 av. J.-C., un oubli providentiel — une pâte abandonnée qui fermente au contact de levures sauvages — donne naissance au levain naturel. Ce mélange de bactéries lactiques et de levures indigènes transforme la texture, la saveur et la digestibilité du pain. Les Romains en feront un savoir-faire, les boulangers médiévaux en vivront, et chaque village gardera précieusement son « levain mère » comme un trésor vivant. Aujourd’hui encore, en Italie, on achète une boulangerie avec le levain de la maison, car les habitants sont habitués à son parfum. Il existe même une bibliothèque internationale du levain, elle est située à Saint-Vith en Belgique. Certains ont poussé la passion jusqu’à créer des hôtels pour levain, dans lesquels il est possible de laisser son levain pendant une période d’absence afin qu’il y soit nourri. Comptez 7€ par nuit.
Quand la levure industrielle change la donne
Pendant des millénaires, le levain règne en maître. Puis, au XIXe siècle, Louis Pasteur prouve que la fermentation est le fruit de micro-organismes vivants. La levure de bière est isolée, purifiée, commercialisée. Avantage : rapidité, régularité, moins d’aléas. Après la Seconde Guerre mondiale, la levure industrielle s’impose dans les fournils : on fabrique vite, beaucoup, et sans l’attention constante qu’exige le levain.
Mais cette commodité a un prix : la fermentation rapide laisse le réseau de gluten presque intact. Ces fameuses liaisons disulfures, qui retiennent les gaz et font lever la pâte, ne sont pas assez dégradées. Résultat : pour certaines personnes, digestion plus difficile, inconfort, et, dans le temps, l’explosion des intolérances liées à un gluten « non prédigéré ». Les blés sélectionnés pour la boulange industrielle — riches en gluten fort — n’ont rien arrangé. À l’inverse, le levain naturel, grâce aux protéases, casse ces liaisons : le pain est plus digeste, et notre métabolisme y est adapté.
C’est un peu technique, alors pour mieux comprendre, rien de tel que la démonstration faite par Thomas Teffri-Chambelland, créateur et directeur de l’École Internationale de Boulangerie.
Le levain, une école de patience (et d’humilité)
Faire du pain au levain, ce n’est pas suivre une recette minute : c’est dialoguer avec un organisme vivant. On le nourrit, on l’attend, on le sent. On apprend que la météo, la farine, l’heure du jour et l’humeur du boulanger influencent le résultat. Et parfois, malgré tout, il se rebelle. Cette lenteur, cette incertitude, ce refus du contrôle total sont un rappel : l’humilité n’est pas optionnelle. Un bon levain vous ramène à votre place dans la nature — derrière les bactéries et les levures, pas au-dessus.
Et si c’était au travers de tels apprentissages que nous habituions les futurs adultes à la démarche scientifique ? Car à force d’essais et d’échecs, chacun apprend pas à pas et découvre l’importante de la science et de l’expérience, quelque chose qui manque cruellement dans notre société.
Pain et société : un lien vital
Au Moyen Âge, le pain est la base calorique de l’Europe : 1 à 2 kg par jour par personne, surtout chez les paysans. Au XVIIIe siècle, le pain blanc devient un symbole de prestige. Après la Révolution française et jusqu’au XIXe, on descend à environ 400-500 g/jour, puis à 200-300 g après la Seconde Guerre mondiale, et aujourd’hui à 150-200 g (soit 55-73 kg/an).
Dans les cultures méditerranéennes ou moyen-orientales, la consommation reste élevée ; ailleurs, elle cède la place à d’autres céréales (riz, maïs, mil). L’industrialisation a permis l’abondance, mais a aussi standardisé les goûts, uniformisé les textures, et écarté les fermentations lentes.

Les fours banaux
Un retour à l’essentiel
Depuis les années 1980-1990, le levain naturel revient. Les raisons sont multiples : quête d’authenticité, retour au goût, meilleure digestibilité, intérêt pour les fermentations artisanales. Et peut-être aussi, besoin de se reconnecter à un rythme plus lent, moins « chronométré » que celui imposé par la levure industrielle. Le pain au levain est un aliment vivant, à la croisée des savoir-faire, de la science et du lien social.
Depuis le confinement lié au COVID, en 2020, on assiste à une explosion de boulangeries au levain. Et pour cause, ces mois particuliers ont aussi été mis à profit pour découvrir ou approfondir cette méthode de panification. Le groupe Facebook Je fais mon pain au levain, monté par Julien Blanquart, compte aujourd’hui 100 000 membres, répartis dans le monde entier.
Et maintenant ?
Si nous voulons préserver ce patrimoine, il faut identifier, soutenir et relier ceux qui font vivre la tradition du levain naturel : boulangers, meuniers, agriculteurs, amateurs passionnés. C’est pourquoi nous lançons un grand recensement des acteurs de la filière du pain au levain. Chacun peut y participer : que vous pétrissiez à la main dans votre cuisine ou produisiez des miches pour tout un quartier, votre savoir-faire et votre expérience comptent.
Ce projet n’est pas seulement un annuaire : c’est une cartographie vivante d’un héritage à protéger, pour que l’avenir du pain ait encore le goût du levain… et un parfum d’humilité. Pour le moment, nous avons recensé 52 boulangeries travaillant avec du levain naturel, 14 paysans boulanger, 7 minoteries et 9 fours banaux. La carte est à découvrir ici.
Pour saisir une boulangerie au levain naturel, un paysan-boulanger, une minoterie, ou un four banal, merci de suivre ce lien.
-
Sébastien Tertrais: AuteurVoir toutes les publications Fondateur et rédacteur en chef à OHERIC-Média




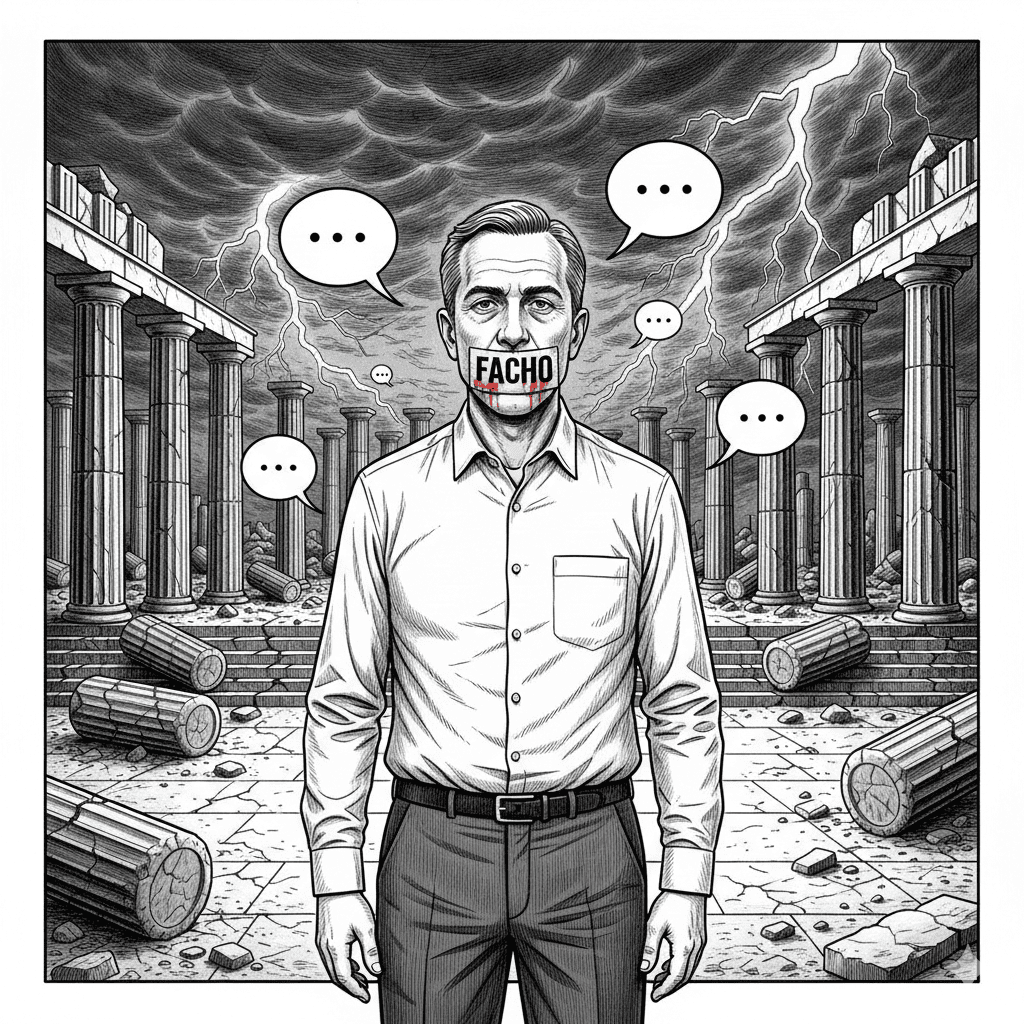
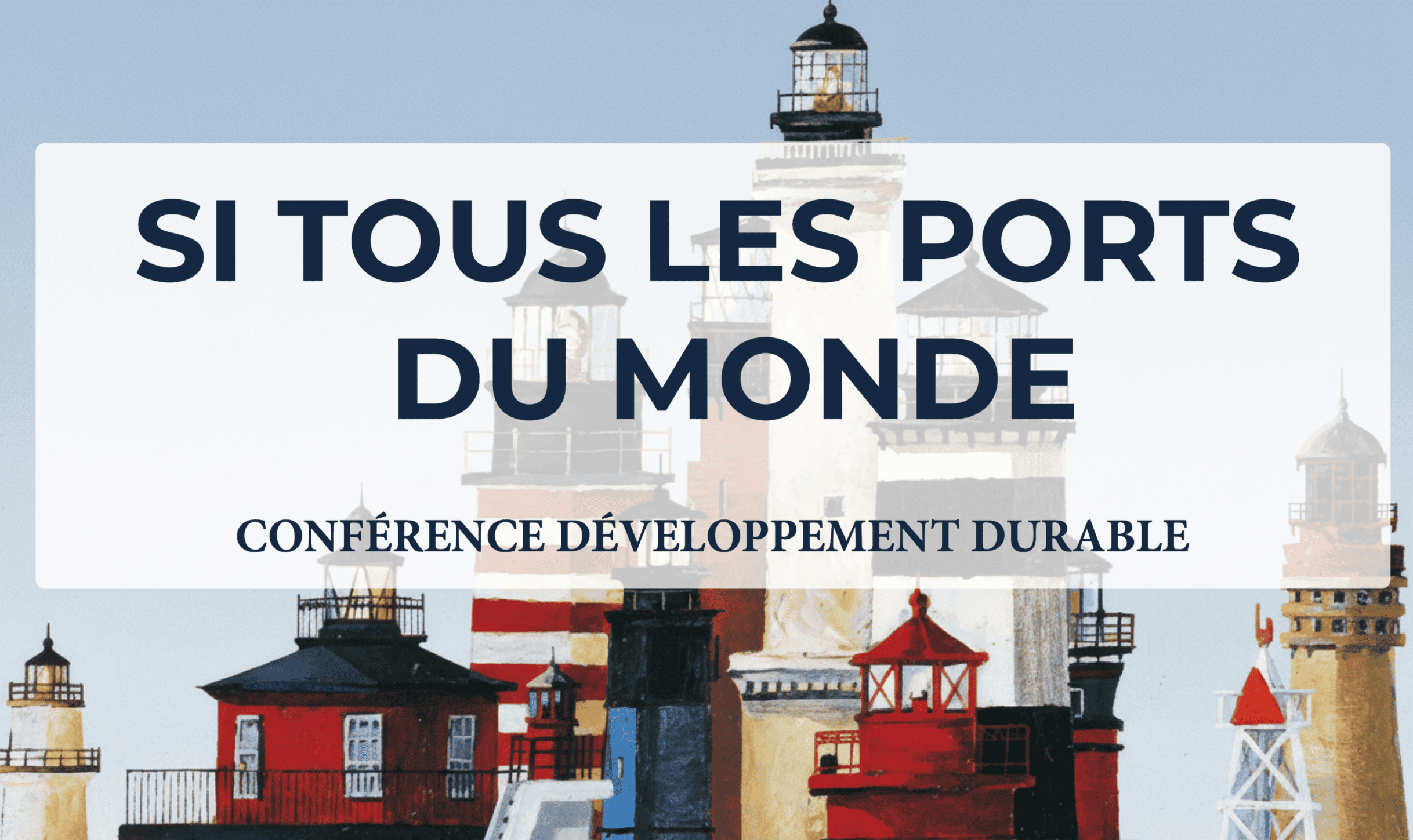
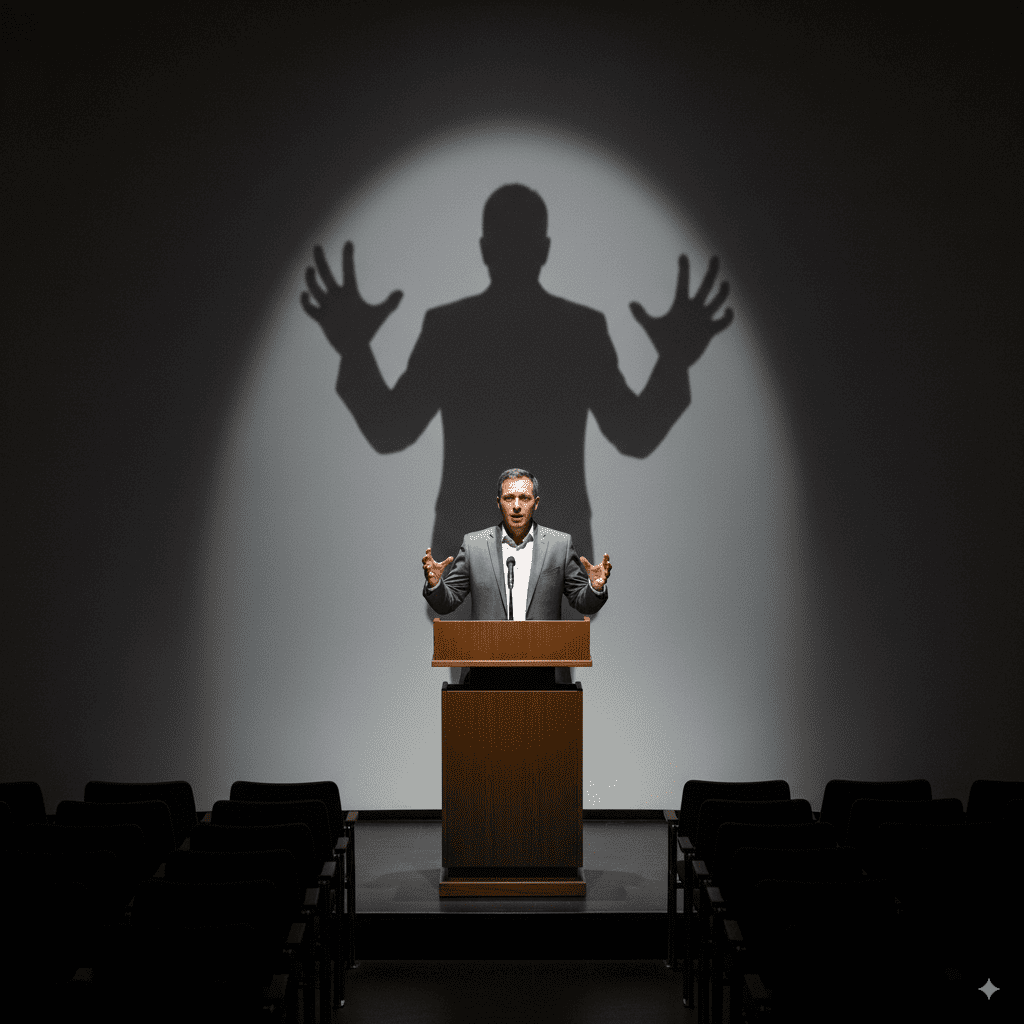
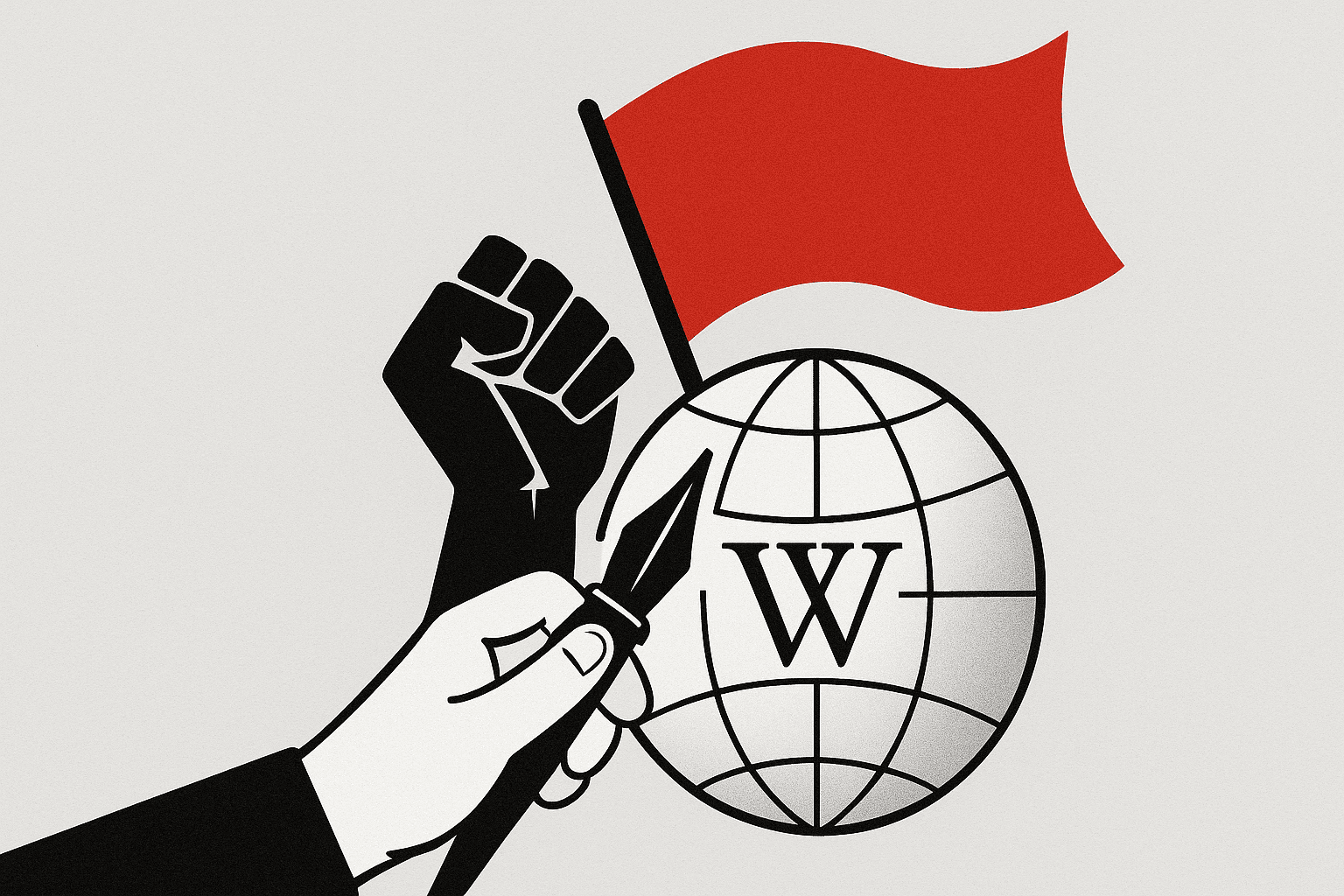


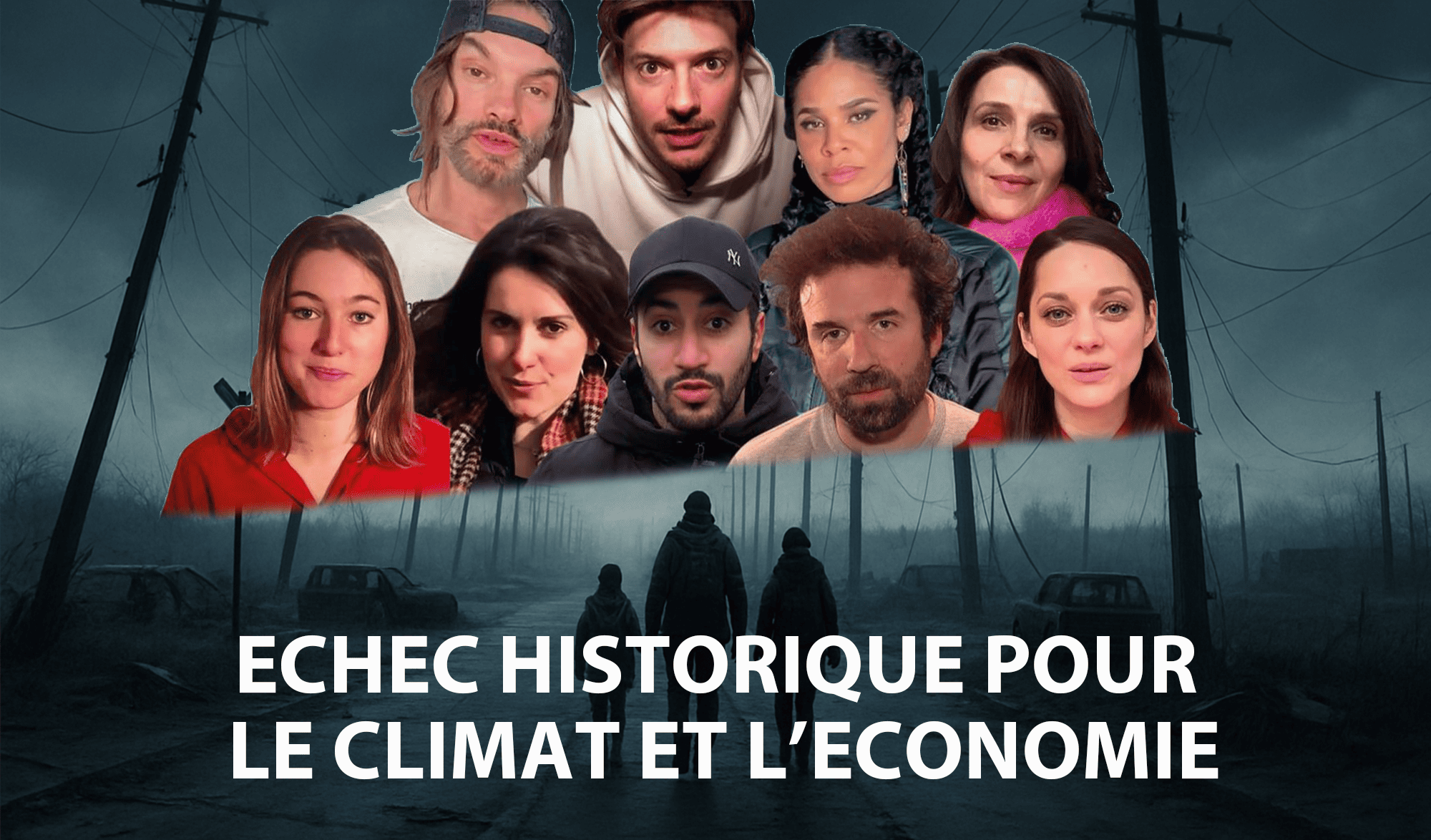

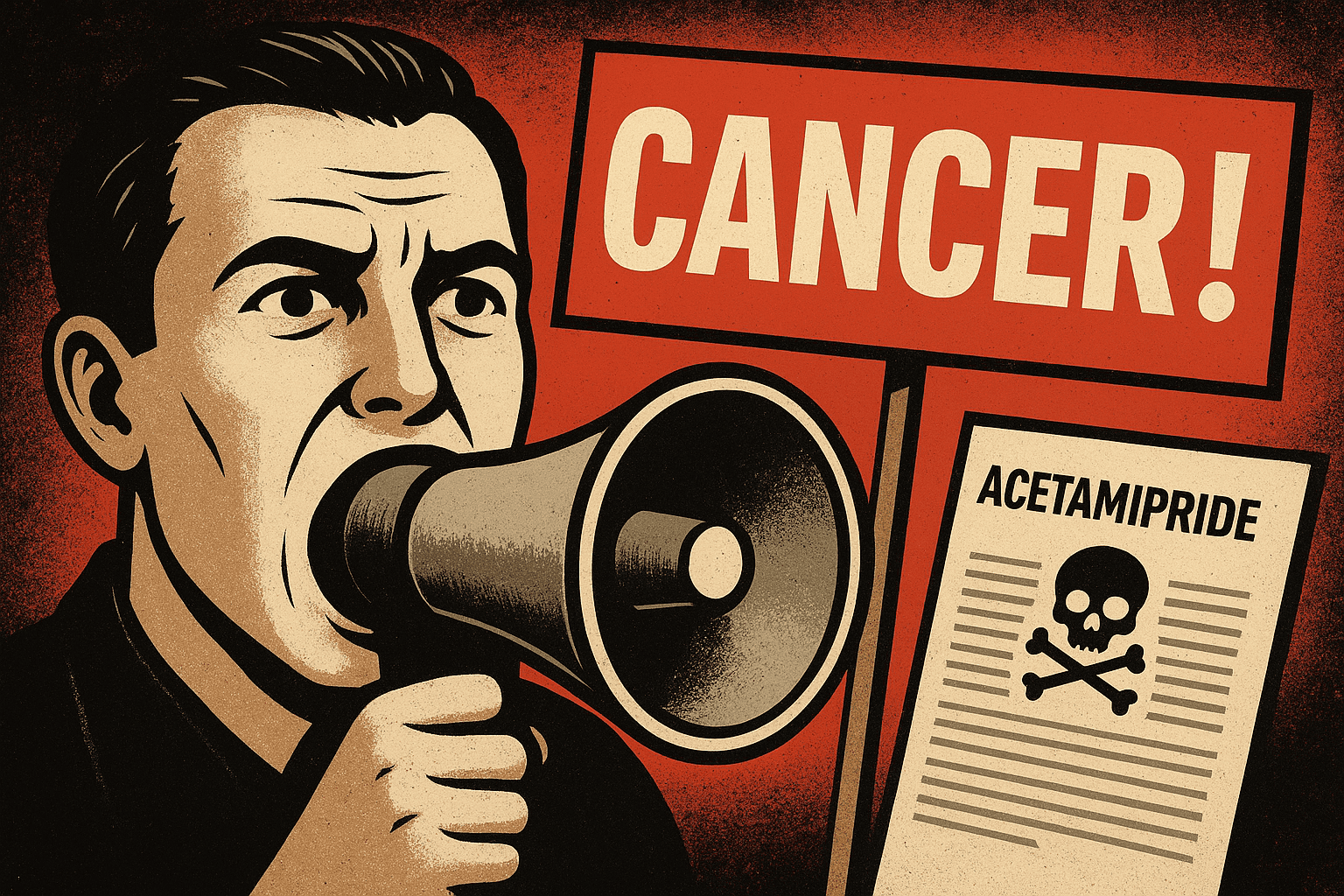

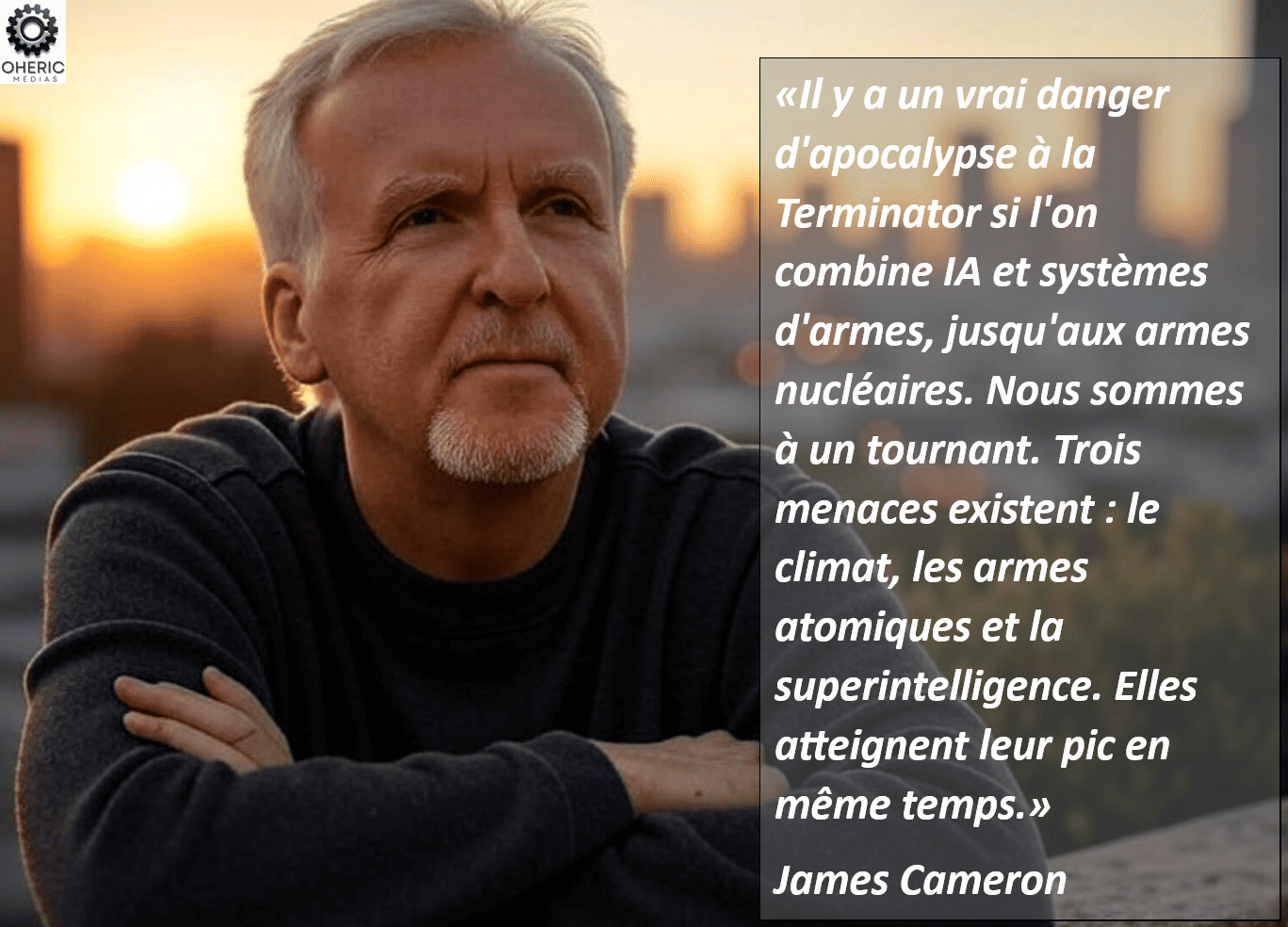
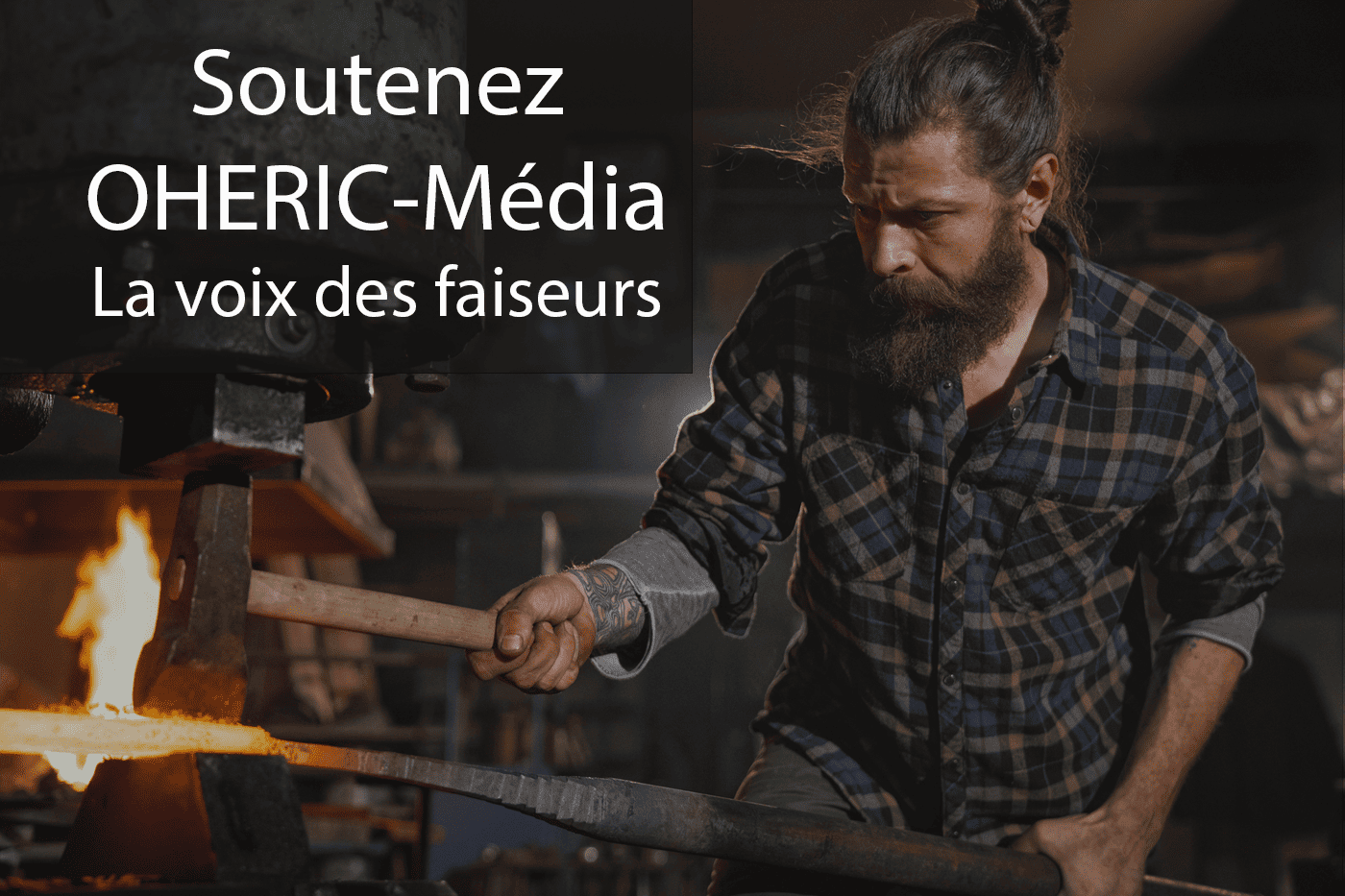
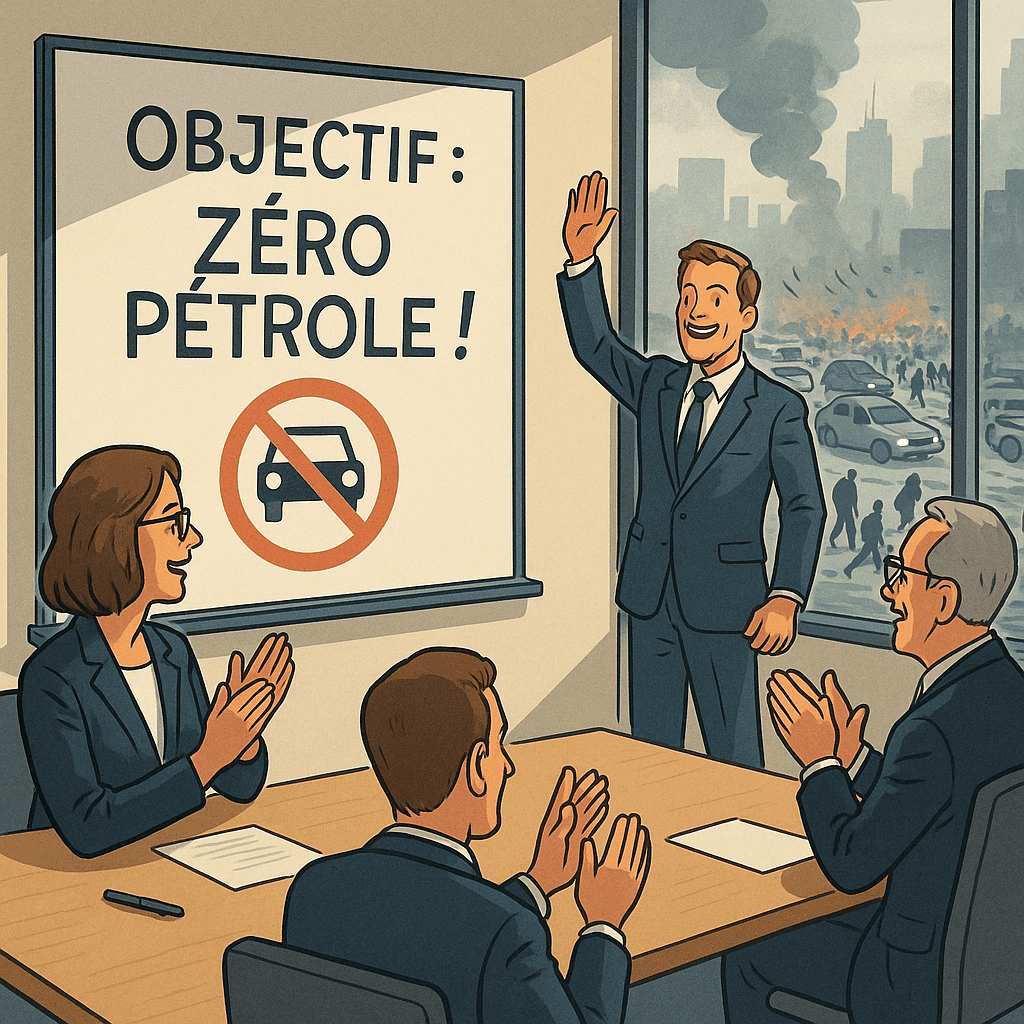

Une réponse
Passionnant ! Cela donne envie de s’y mettre !