Une image troublante
 Une photographie d’époque montre une structure de jeu en acier, haute de plusieurs mètres, où une quinzaine d’enfants grimpent, se suspendent, sautent et prennent des risques visibles. Aucun casque, aucun harnais, aucun sol amortissant. Des adultes, à proximité, observent sans intervenir.
Une photographie d’époque montre une structure de jeu en acier, haute de plusieurs mètres, où une quinzaine d’enfants grimpent, se suspendent, sautent et prennent des risques visibles. Aucun casque, aucun harnais, aucun sol amortissant. Des adultes, à proximité, observent sans intervenir.
Cette scène, banale au début du XXe siècle, nous paraît aujourd’hui inconcevable, presque choquante. Et pour cause : la société contemporaine a changé de paradigme. Ce qui était perçu comme une expérience normale d’apprentissage est devenu, dans l’imaginaire collectif, un terrain de dangers, de litiges, de négligences, voire de scandales publics.
Derrière ce glissement culturel se cache une mutation profonde de notre rapport au risque, à l’autonomie et à la responsabilité individuelle.
Le risque comme facteur de développement
Tim Gill, chercheur britannique spécialisé dans l’enfance, a documenté dans son essai No Fear: Growing Up in a Risk Averse Society (2007) les effets néfastes de l’élimination du risque dans les jeux d’enfants. Il démontre que les enfants ayant grandi dans des environnements extrêmement sécurisés (sols en caoutchouc, jeux bas, obstacles absents) développent moins de compétences d’adaptation, de jugement, de prise de décision et de confiance en soi.
Une recherche relayée par Play England1 en 20082 déplore qu’on interdit aux enfants des activités comme grimper aux arbres, jouer à la tague (au chat et à la souris) ou aux châtaignes. L’étude montre que de telles restrictions conduisent les adultes, une fois grands, à fuir toute situation comportant un minimum de risque, car ils n’ont pas expérimenté la gestion d’un danger contrôlé. Les enfants surprotégés deviennent des adultes plus anxieux, moins enclins à prendre des initiatives ou à gérer l’imprévu. Cette absence d’exposition graduelle au risque conduit à une fragilité psychologique que l’on retrouve ensuite dans le monde professionnel, social ou familial.
L’adaptation au risque et la compensation comportementale
Un phénomène connexe, appelé « compensation comportementale », est bien connu des chercheurs en psychologie sociale et en ergonomie : plus on sécurise un environnement, plus l’humain adapte son comportement à la baisse du risque perçu. L’exemple classique est celui de la ceinture de sécurité en voiture : son usage accru peut inciter certains conducteurs à rouler plus vite, se sentant surprotégés (Théorie de Peltzman, 1975).
Cette même logique a été observée dans une étude britannique dans la ville de Slough dans les années 1950. Les enfants y traversaient les routes sous la protection d’agents de police. Résultat : une baisse des accidents graves par rapport à la moyenne nationale. Mais cette expérience montra aussi que les enfants n’étaient plus capables de traverser seuls de manière sûre en dehors de ce cadre protégé. Ils étaient devenus « dépendants de la sécurité contextuelle », une forme d’inaptitude à l’autonomie adaptative.
| Aspect | Observations principales |
|---|---|
| Enfance dans « cage à poule » caoutchoutée | Sol protégé, environnement sécurisé — mais absence de défis physiques (escalade, vitesse, imprévu). |
| Développement psychologique | Moins d’entraînement au jugement des risques, résilience et confiance. |
| Adulte | Tendance accrue à éviter les situations risquées, développer une anxiété sociale ou gérer moins bien l’imprévu (researchgate.net). |
Le glissement culturel vers la déresponsabilisation
Ce qui s’applique à l’enfant s’applique ensuite à l’adulte. Le philosophe Zygmunt Bauman, dans Liquid Modernity (2000)3, décrit une société moderne dans laquelle les repères fixes sont démontés, où la responsabilité personnelle se dissout dans une quête infinie de confort, de protection et de droits sans contrepartie. L’individu moderne attend que la société prévienne tous les risques à sa place.
Dans The Coddling of the American Mind (2018)4, Jonathan Haidt et Greg Lukianoff démontrent comment les universités, à force de vouloir protéger les étudiants de toute idée potentiellement « traumatisante », les empêchent de se forger une pensée critique robuste. Il en résulte une intolérance croissante à la contradiction, à la frustration, voire à la simple discussion contradictoire.
Cette même logique se retrouve dans l’approche contemporaine de la délinquance : à force de vouloir tout expliquer (origine sociale, contextes familiaux, troubles psychologiques), la ligne entre explication et justification devient floue. Le risque de dilution de la responsabilité devient réel.
Conclusion : Revaloriser l’expérience du réel
La société post-moderne n’est pas devenue plus sage en éradiquant le risque : elle est devenue plus fragile. En privant l’enfant de l’opportunité de tomber, on le prive d’apprendre à se relever. En surréglementant le comportement, on le rend dépendant d’un cadre artificiel. En expliquant tout, on finit par tout excuser.
Il est temps de redonner sa place à l’expérience directe, à la responsabilité personnelle, à la confrontation progressive au réel. Non pour revenir à un monde insécurisé, mais pour retrouver une société d’adultes debout, confiants et responsables, parce qu’ils auront eu le droit de tomber, de se blesser, et surtout, de grandir.
Pour aller plus loin, voici des exemples de structures de jeu qui incluent la notion de prise de risque.
The Land, Wrexham, Pays de Galles
- Une aire de jeu anarchique où les enfants jouent avec des objets bruts : palettes, pneus, tonneaux, bâches, cordes, clous…
- Objectif : Laisser les enfants explorer, construire, grimper, brûler, tester.
- Encadrement : Présence d’« animateurs du jeu » formés pour observer sans intervenir, sauf en cas de réel danger.
- Philosophie : Le jeu risqué développe l’autonomie, la créativité, la résilience et la régulation sociale.
Skrammellegepladsen (Copenhague, Danemark) (depuis les années 1940)
- Traduction : “Terrain de jeu de bric-à-brac”
- Caractéristiques : Lieu semi-sauvage avec outils réels (scies, marteaux, clous) où les enfants construisent eux-mêmes des cabanes.
- Particularité : Inspiré des idées de l’architecte Carl Theodor Sørensen, qui pensait que les enfants avaient besoin de matériaux inutiles pour des usages imprévus.
- Encouragement au risque : Oui, car les enfants y apprennent par eux-mêmes la sécurité, via l’expérimentation directe.
Risky Playgrounds (Norvège / Suède)
- Modèle nordique : De nombreuses crèches et écoles en Norvège, Suède et Finlande intègrent dans leur pédagogie le jeu en forêt, les jeux de couteau, le feu de camp, l’escalade libre sur troncs, et les outils tranchants.
- But : Renforcer la motricité, le sens du danger, le raisonnement stratégique, et la solidarité entre enfants.
- Études associées : llen Beate Hansen Sandseter, chercheuse norvégienne, identifie 6 types de “jeux risqués” bénéfiques pour l’enfant : hauteur, vitesse, outils, éléments naturels, disparition momentanée, confrontation.
Rewilding Playgrounds (États-Unis, Australie)
- Exemples : “Anarchy Zone” à Ithaca (État de New York), ou “Stomping Ground” en Australie.
- Philosophie : Reconnecter les enfants avec les risques naturels et sociaux : tomber, être mouillé, perdre un pari, devoir négocier un conflit sans adulte.
- Encadrement : Présence d’adultes silencieux, posture “non-interventionniste sauf urgence”.
- Feedback : Les enfants montrent une meilleure gestion de leurs émotions, une baisse des conflits, et un regain d’enthousiasme.
Reportage : The Land, Erin Davis.
-
Sébastien Tertrais: Auteur/AutriceVoir toutes les publications Fondateur et rédacteur en chef à OHERIC-Média
- partie de la National Children’s Bureau[↩]
- Kids need the adventure of ‘risky’ play[↩]
- Liquid Modernity, Zygmunt Bauman [↩]
- The Coddling of the American Mind : How Good Intentions and Bad Ideas Are Setting Up a Generation for Failure[↩]




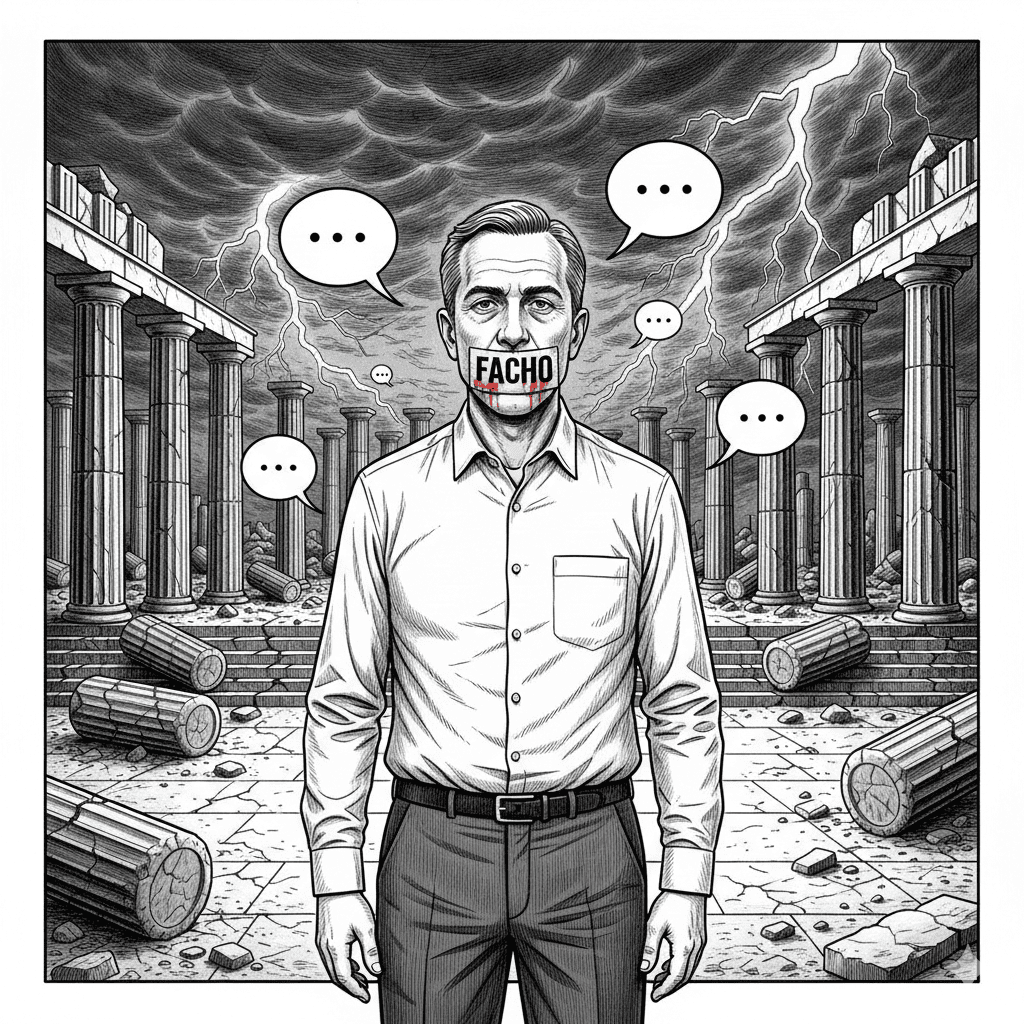
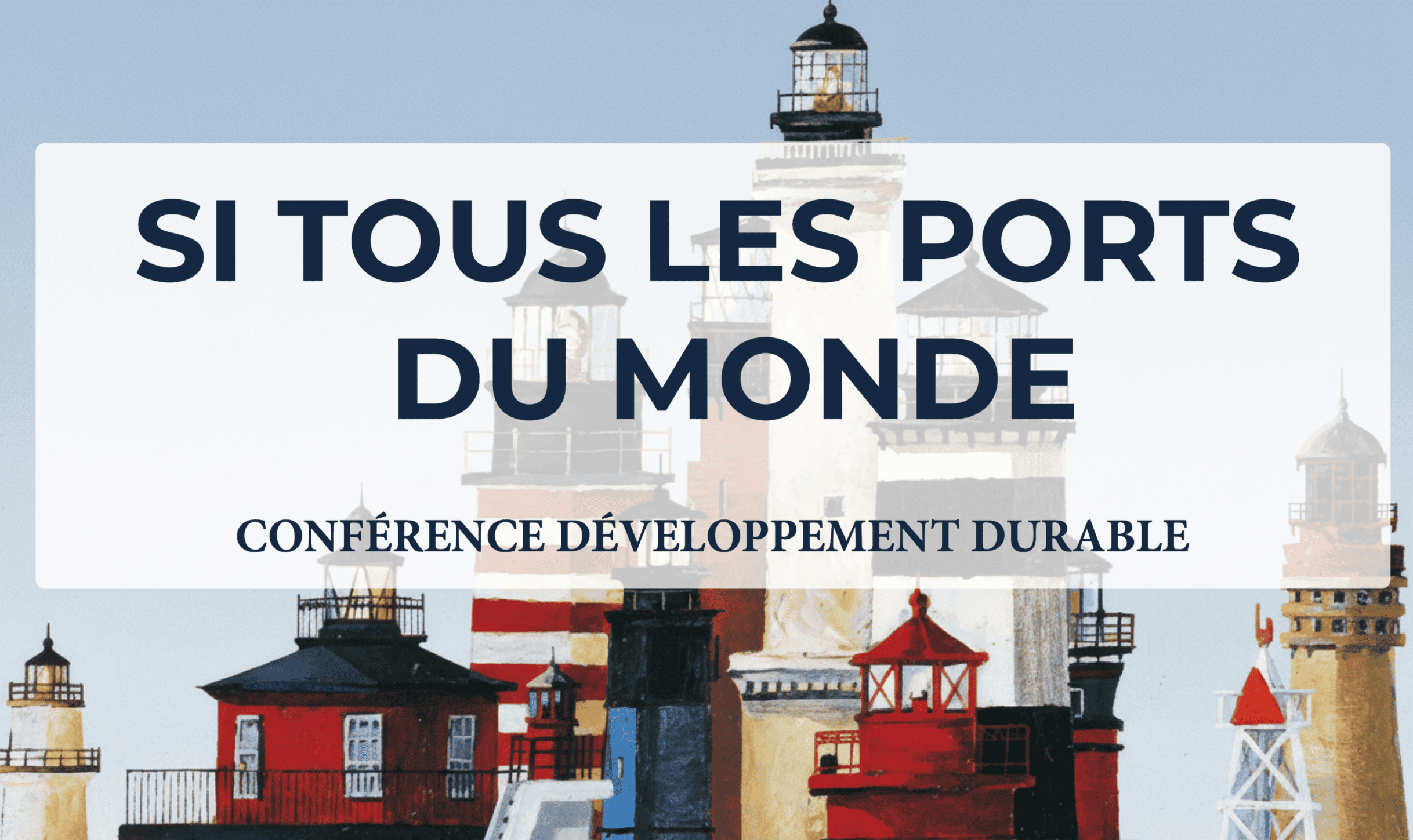
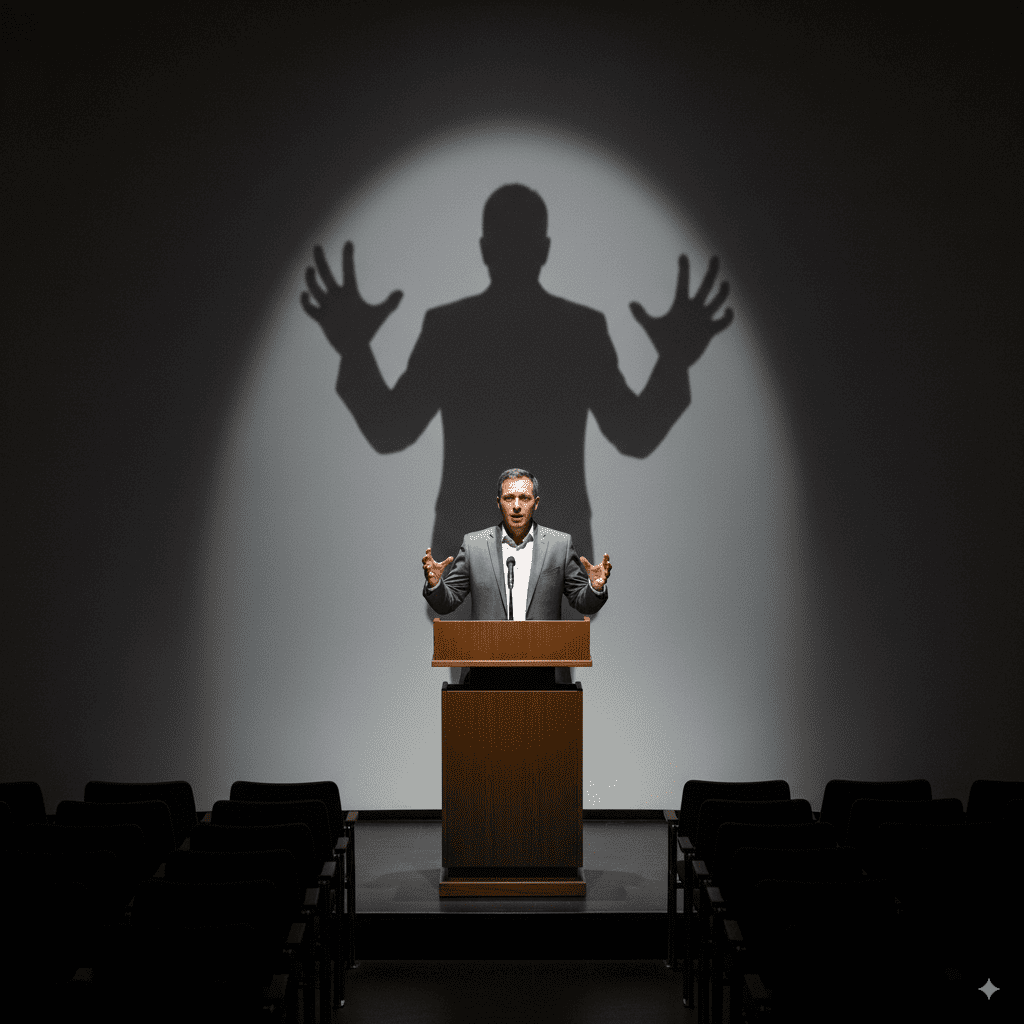
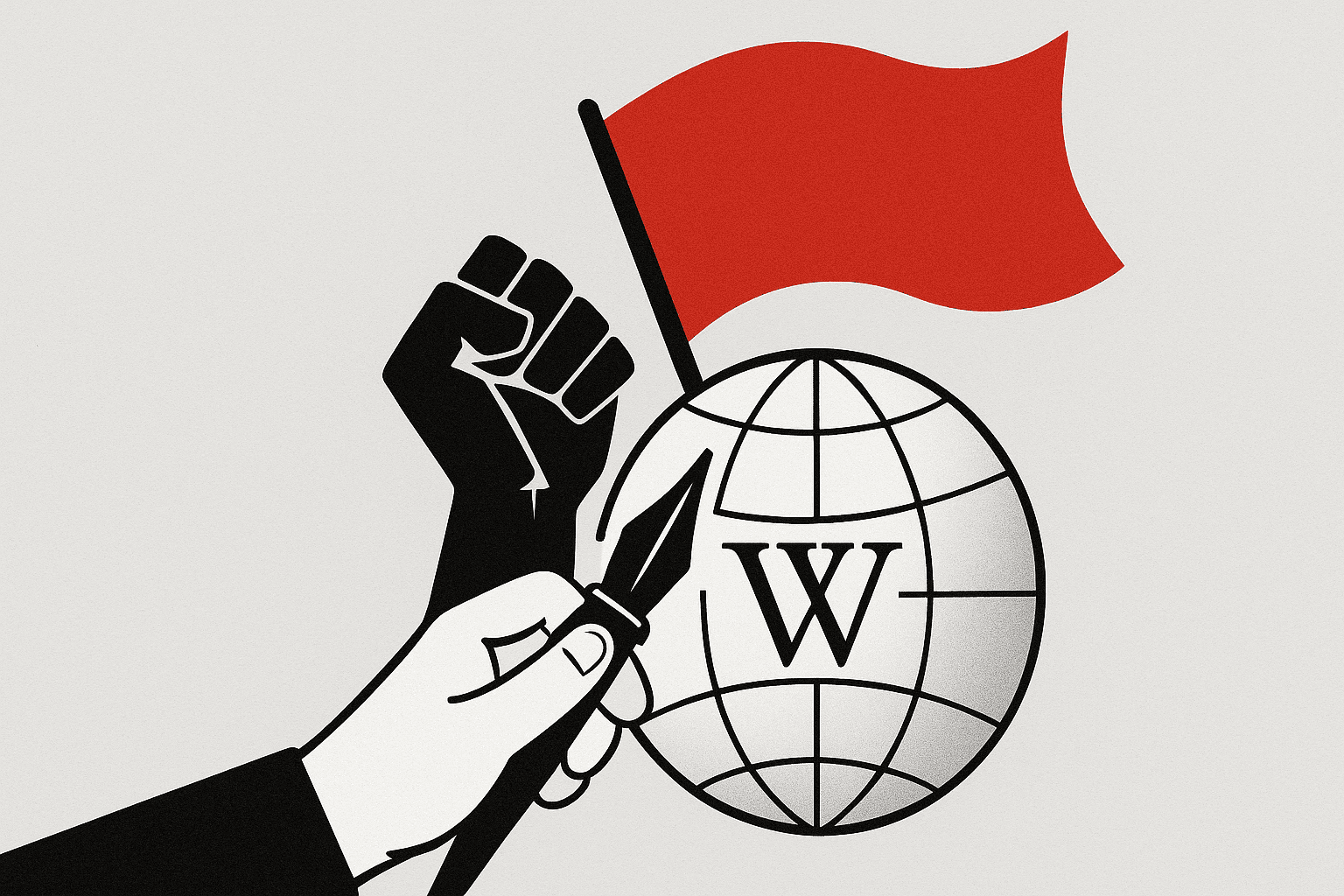


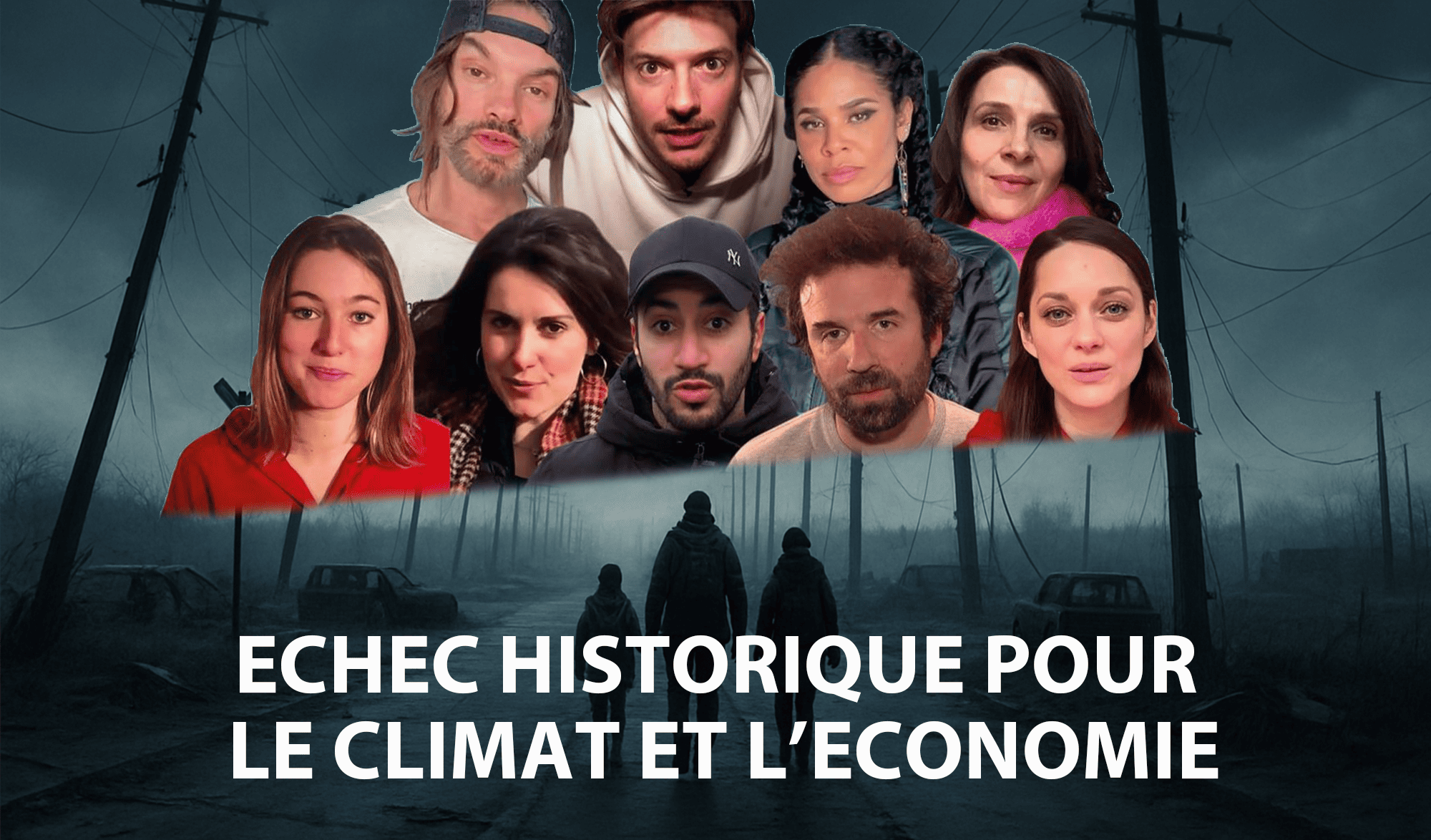


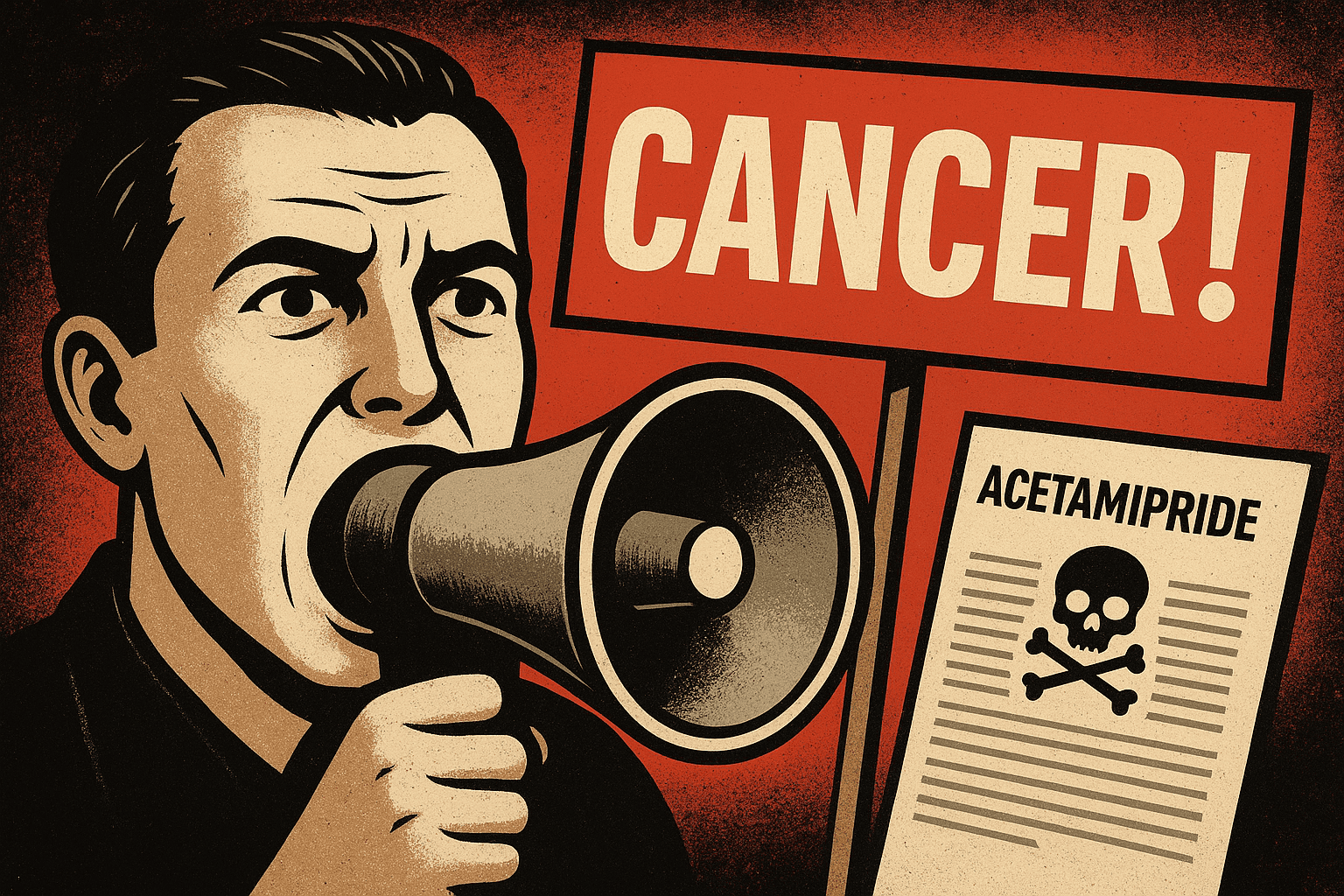

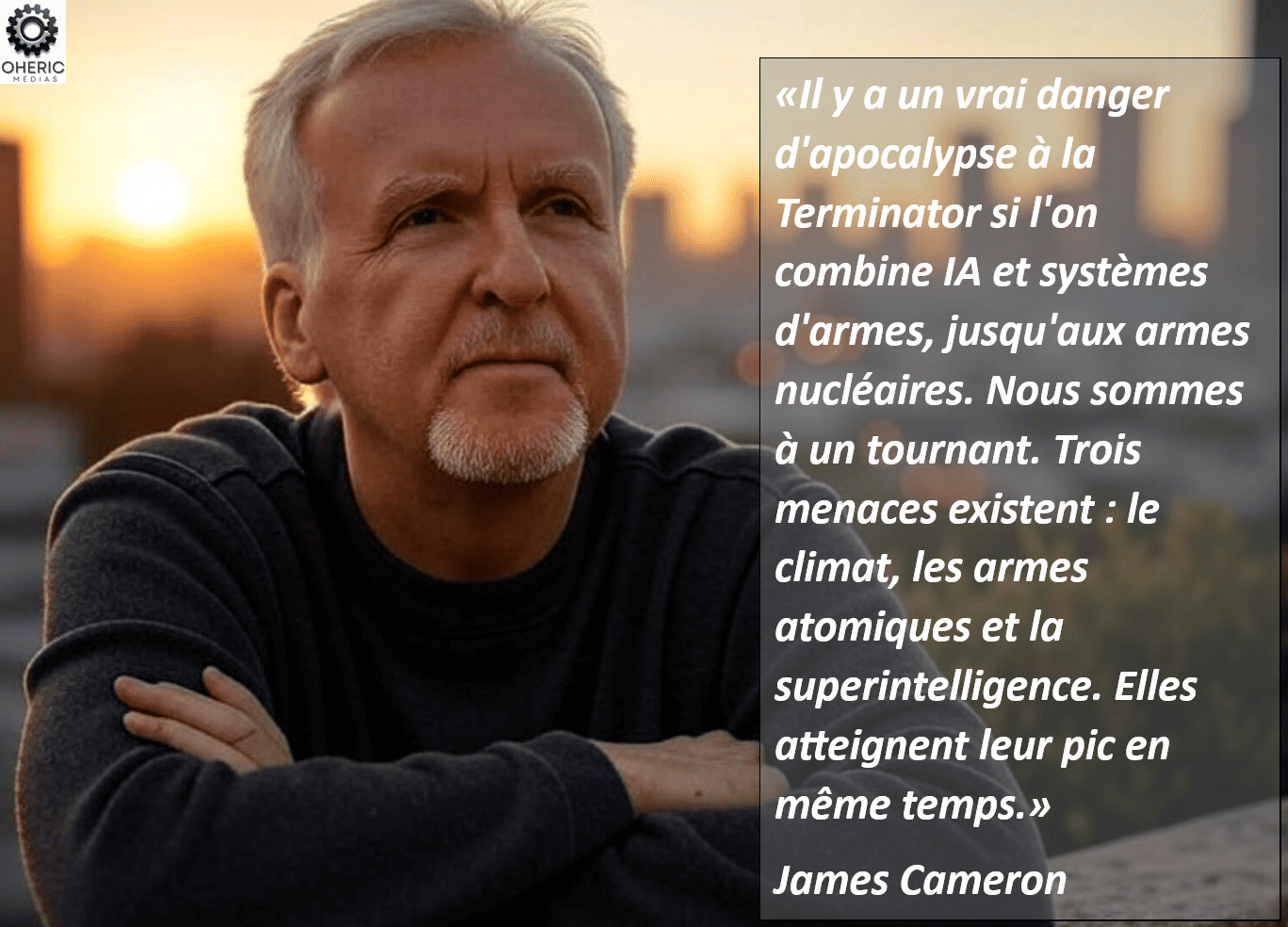
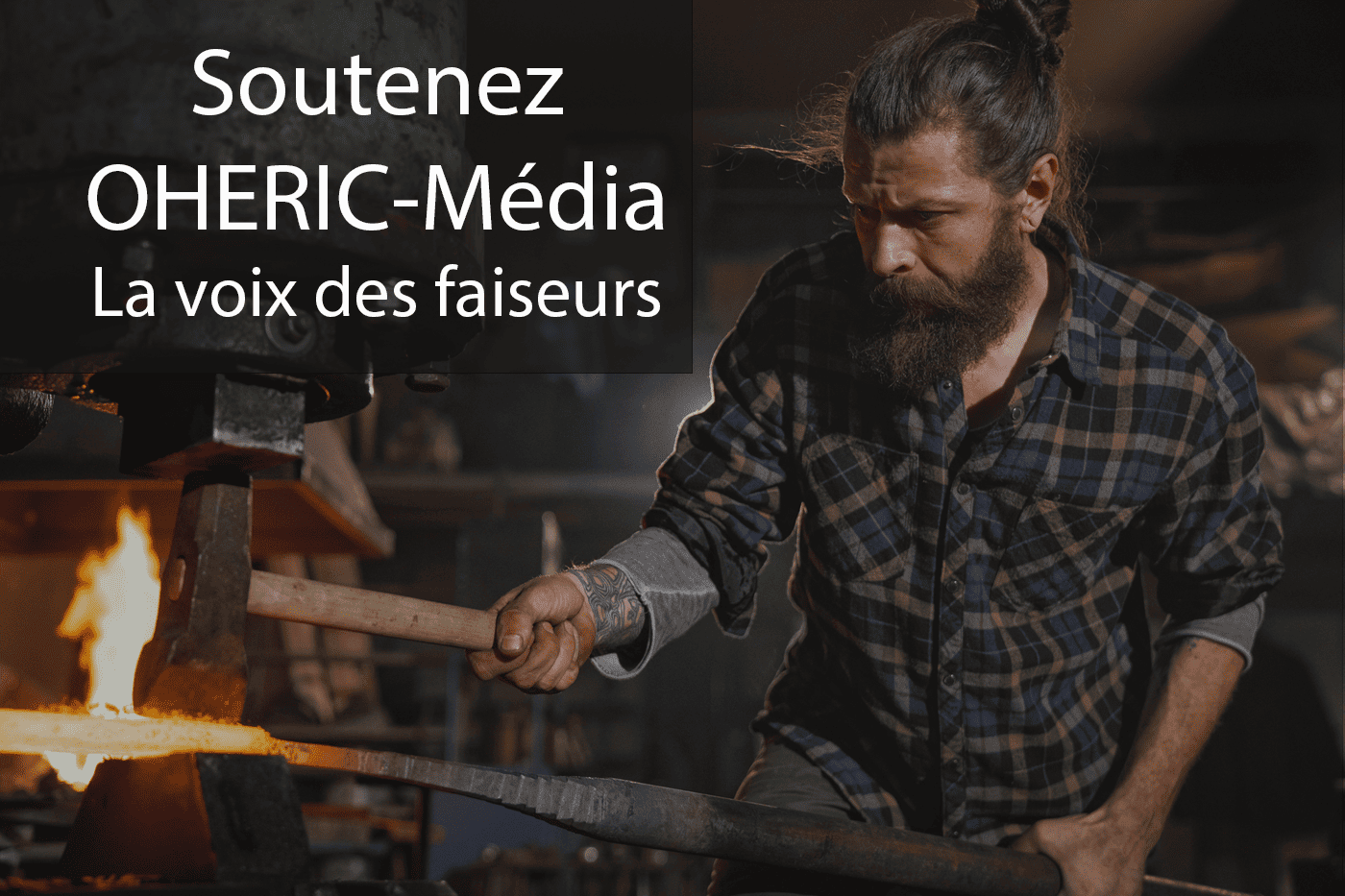
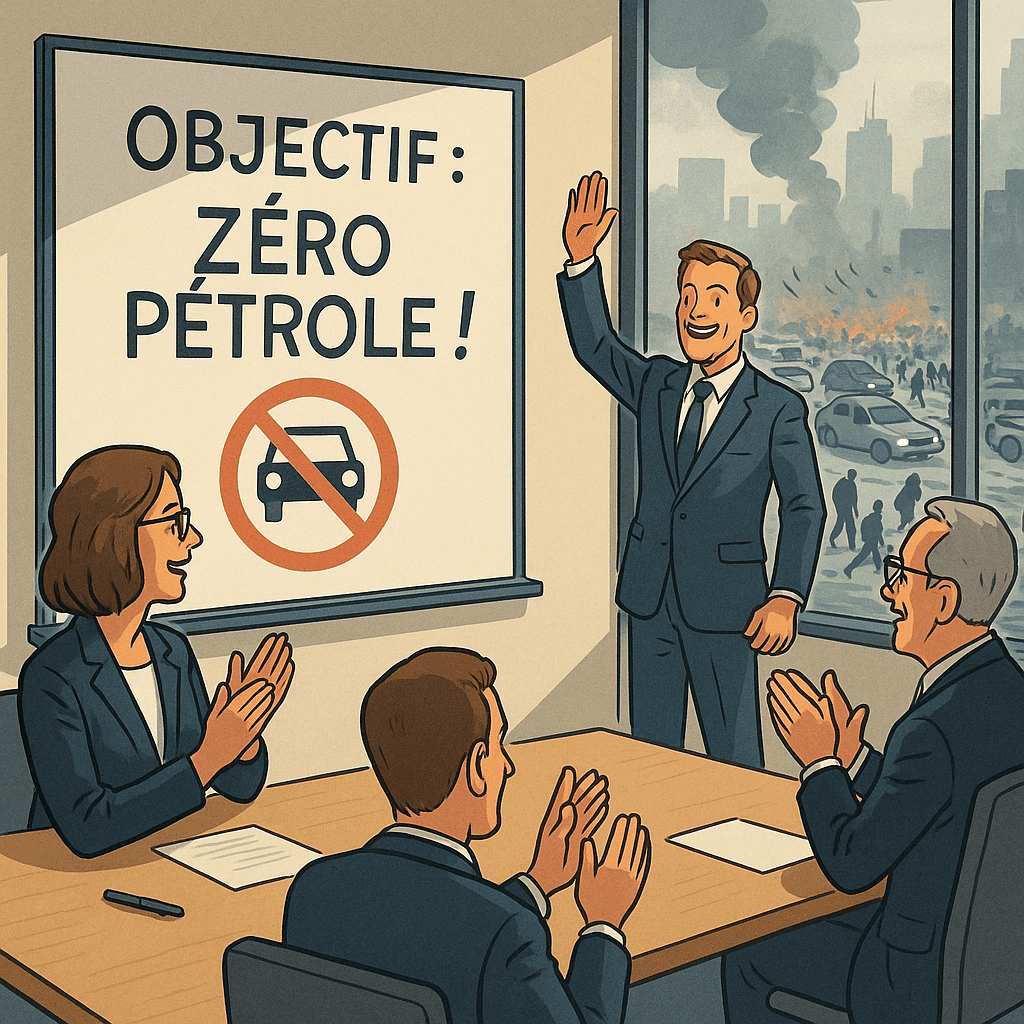

4 Responses
Très juste.
Je pense que chacun de nous a pu observer les comportements de son entourage privé ou professionnel et leurs relations avec l’enfance, le goût de l’aventure, la pratique de sports plus ou moins physiques, etc.
J’ajouterais que l’appétence ou le rejet du risque par les parents a également une influence sur le comportement futur des enfants. Par exemple , les filles ou fis d’entrepreneurs ne voient pas la création d’entreprise comme une mission trop risquée menant droit à la faillite… Le franchissement sera plus difficile pour un fils ou une fille de fonctionnaire, élevé dans la culture de la sécurité de l’emploi. Je sais de quoi je parle : je suis fils d’enseignants 🙂
Votre analyse est très juste et effectivement observable en de multiples situations. Merci pour votre apport.
Dans la même veine, je suggère la lecture de « Le goût du risque » par le trio À Marcolongo , P Franceschi et L Finaz.
Célébrer la liberté , ne pas craindre l’incorrect, chercher la bagarre, ne pas g-fuir la mort , danser après l’échec, refuser l’abus des normes , tuer le principe de précaution, aimer la solitude, oser croire, chérir l’inutile , aventurer la vie sans cesse:voilà ce que proposent les auteurs de cet ouvrage pour affronter notre époque de doute et de désarroi …
Merci pour ces compléments utiles.