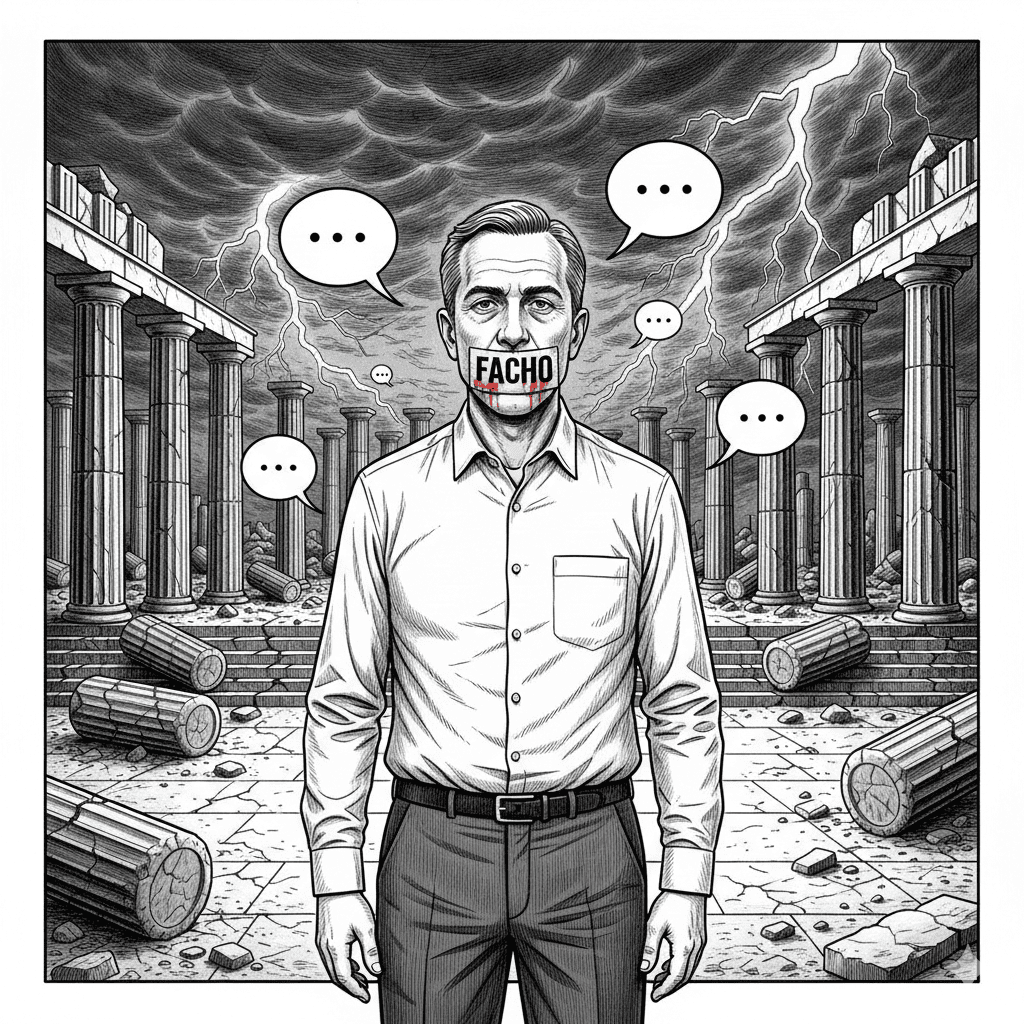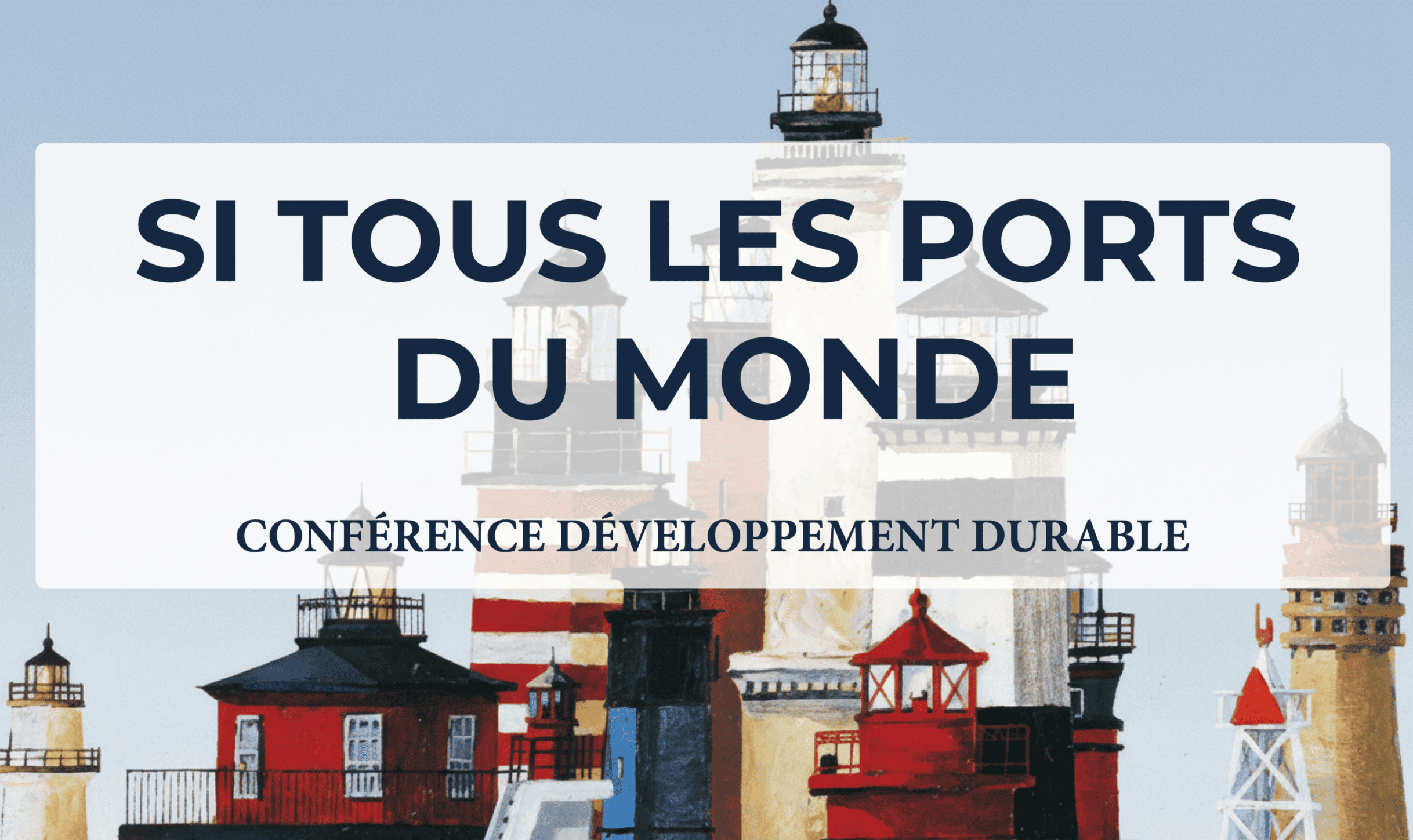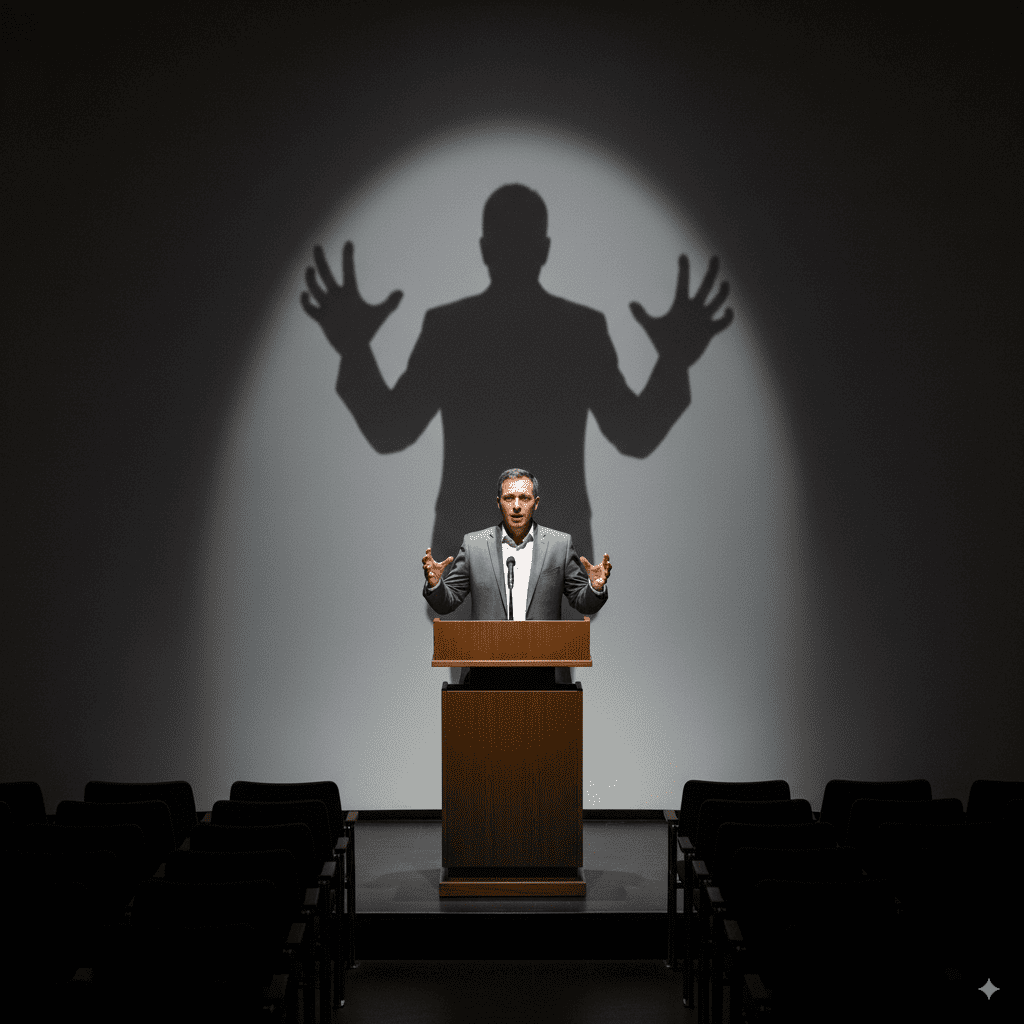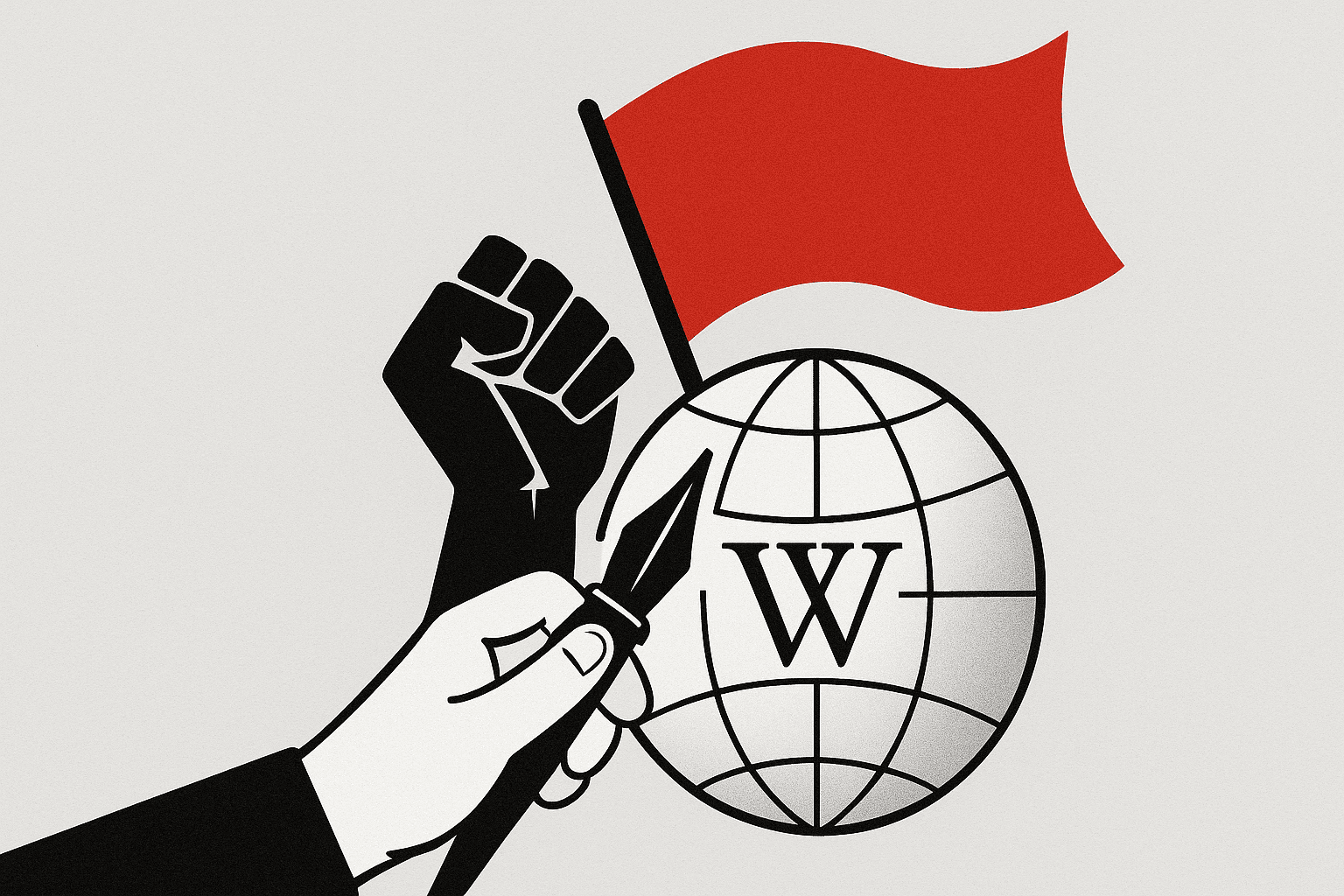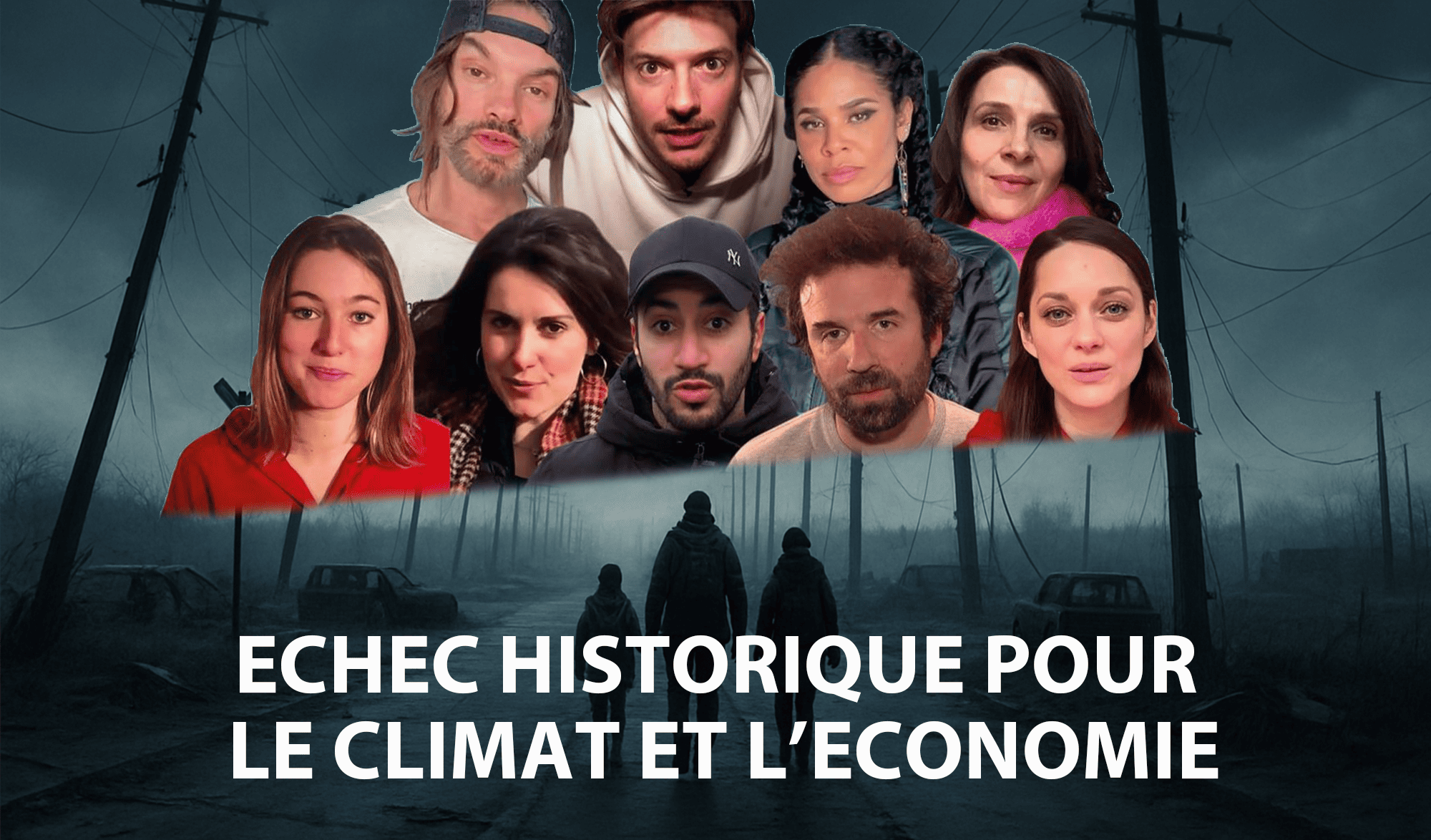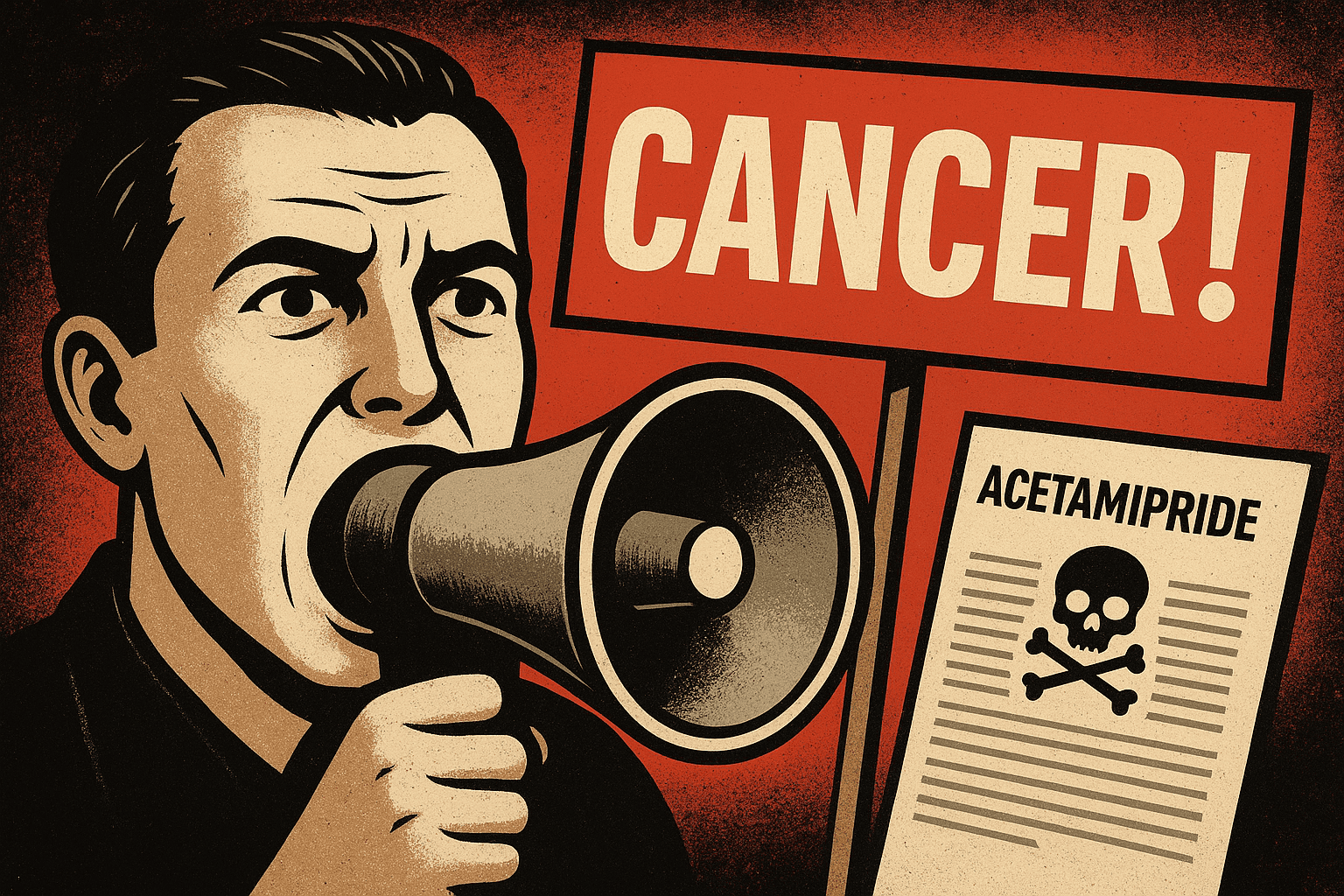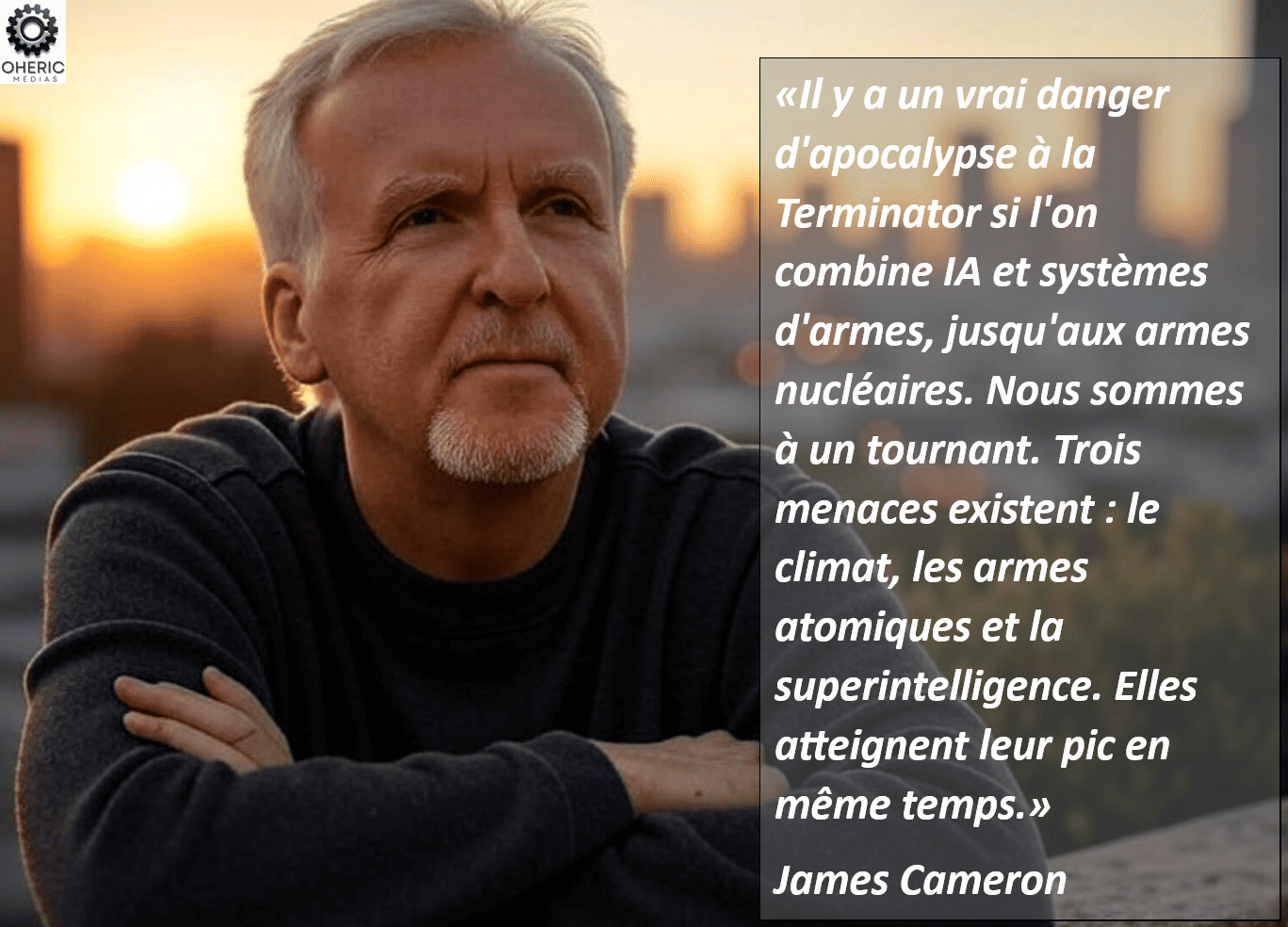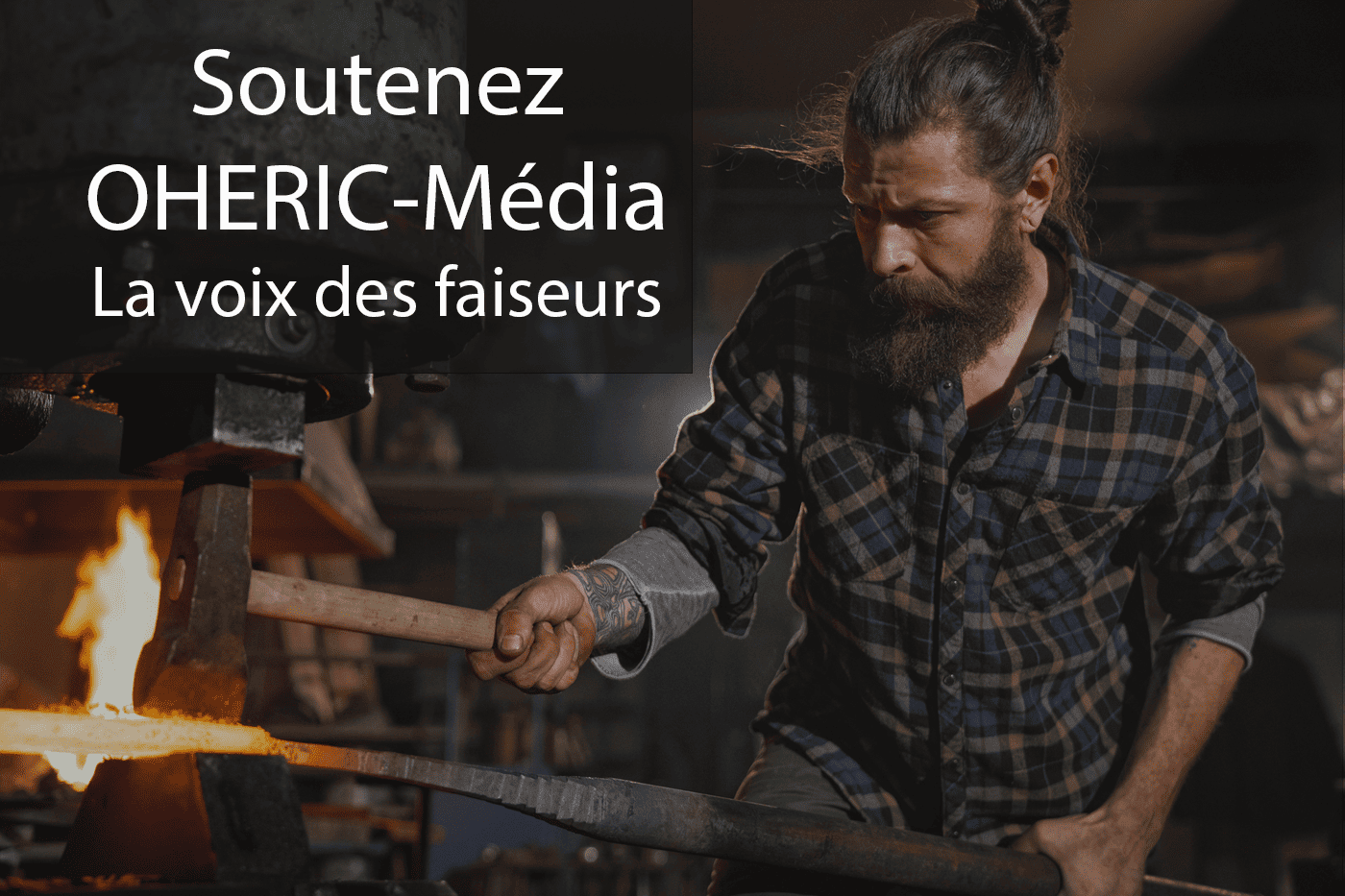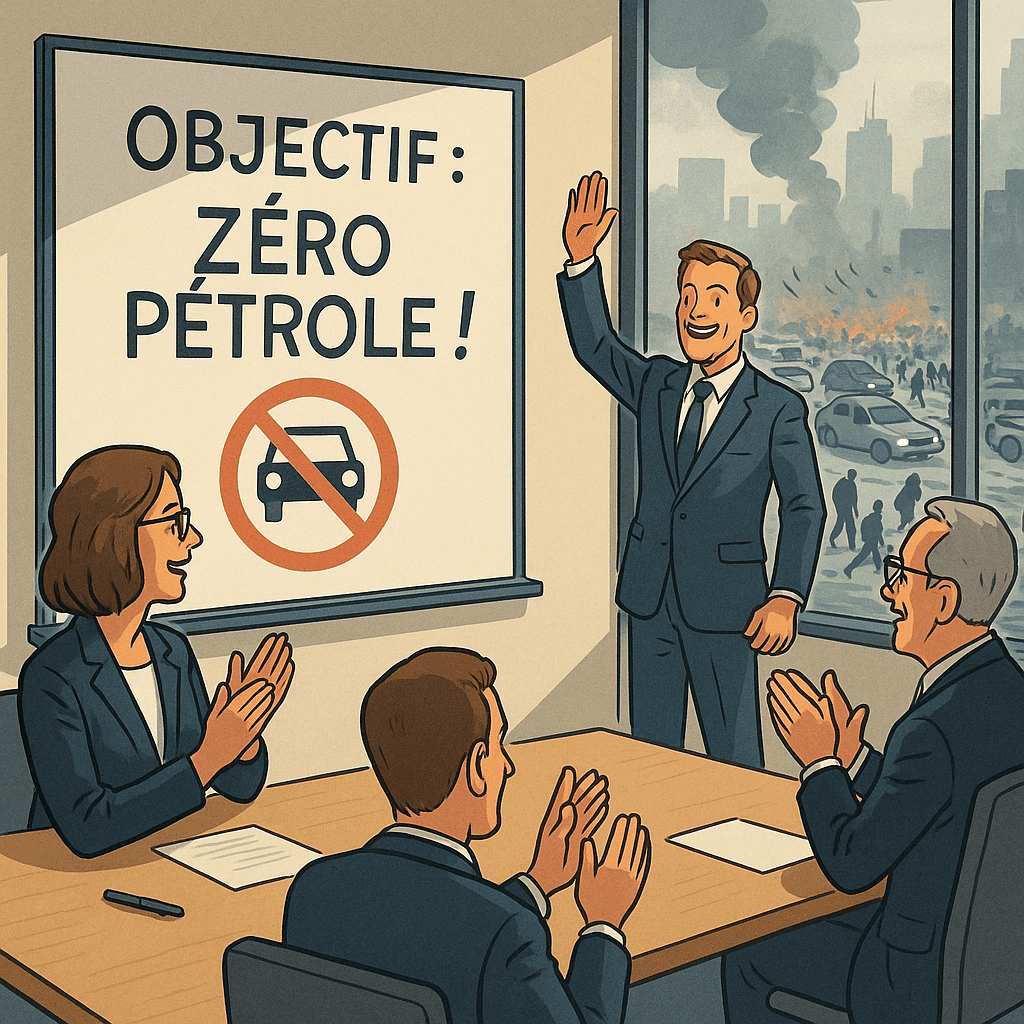Bruno Tertrais
Directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique
|
Dans un monde en proie aux crises et à la désinformation, nous devons veiller à nous concentrer sur des analyses mesurées et ancrées dans l’histoire. De l’Ukraine au Moyen-Orient, en passant par les bouleversements aux États-Unis, OHERIC-Média a souhaité vous apporter une vision lucide et apaisante des défis stratégiques à venir. Pour ce faire nous nous sommes rapprochés de Bruno Tertrais, un politologue français de premier plan, spécialiste de la géopolitique et de la stratégie internationale.
Directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS) depuis 2001, il a forgé son expertise à travers une carrière riche, incluant des postes à l’Assemblée Parlementaire de l’OTAN, au Ministère de la Défense français, et un passage comme visiting fellow à la RAND Corporation. Diplômé de Sciences Po Paris et docteur en science politique avec une thèse sur la stratégie nucléaire de l’OTAN, il est l’auteur de nombreux ouvrages influents, tels que La Revanche de l’histoire (2018), La Guerre des mondes (2023) ou encore La Question israélienne (2025). Récompensé par le Prix Vauban et nommé Chevalier de la Légion d’Honneur en 2016, il est aussi une voix médiatique active, notamment sur X (@BrunoTertrais), où il décrypte les tensions globales avec rigueur et perspective historique. Pour Oheric Média, il partage son analyse lucide des enjeux géopolitiques de 2025, entre crises, désinformation et impératifs stratégiques. |
Dans un monde saturé d’informations et de réactions immédiates, vous insistez souvent sur la nécessité d’une approche mesurée et d’un recul historique. Comment ces qualités permettent-elles de mieux comprendre les enjeux géopolitiques actuels, comme les tensions en Ukraine ou au Moyen-Orient, notamment depuis les évolutions politiques américaines, et d’éviter les pièges de l’alarmisme ou de la désinformation ?
La mesure, c’est tout simplement le reflet de la complexité du monde. Le recul historique, c’est ce qui permet de relativiser les tournants de l’actualité. Même s’il y a parfois des sauts qualitatifs dans l’histoire…
Appliquons cette grille de lecture aux trois régions que vous mentionnez.
L’Ukraine était la jambe européenne de l’empire russe : son départ vers l’Ouest est insupportable pour une grande partie de l’élite du pays. La guerre d’Ukraine est novatrice en ce qu’elle signale le retour de la grande guerre meurtrière classique sur le continent. Mais j’imagine mal que Poutine puisse appliquer cette méthode à d’autres pays. Car l’Ukraine est unique pour les Russes.
Au Moyen-Orient, plusieurs seuils ont été franchis le 7 octobre : celui du viol du sanctuaire par le Hamas, et celui de la guerre ouverte avec l’Iran. Comme après le 11 septembre, les ennemis du pays n’avaient sans doute pas imaginé la brutalité de la réaction du pays. C’est donc une transformation majeure de la scène stratégique moyen-orientale qui est en cours. Et on assiste sans doute en parallèle à l’enterrement de la « solution à deux États ».
Aux Etats-Unis, une démarche inédite à l’époque moderne est entreprise par l’administration Trump, tant sur le plan extérieur qu’intérieur. On sentait venir le besoin de « contre-révolution ». Mais j’ai tout de même été surpris par la tentation néo-impérialiste de cette équipe…
S’improviser analyste géopolitique sans expertise peut générer de l’angoisse et des erreurs d’interprétation, surtout face à la prolifération des fake news. En tant qu’expert, comment jugez-vous l’impact de cette improvisation sur le public et les décideurs, et quelles clés proposez-vous pour cultiver une connaissance solide et apaisante ?
Parce que la géopolitique est une discipline plutôt qu’une science, elle se prête assez bien aux improvisations de tout un chacun même en l’absence de tout savoir empirique et théorique. Et parce qu’elle est englobante – on y trouve volontiers de prétendues grandes explications à la marche du monde – elle permet d’impressionner facilement… et se prête particulièrement bien aux théories du complot. Dans les faits, le questionnement géopolitique doit s’appuyer sur une multitude de savoirs, géographique, historique, culturel, politique, économique, technologique, militaire. On ne devrait pas s’improviser « géo-politologue ». Cela demande une expérience solide, ainsi qu’une capacité à synthétiser des informations de plus en plus nombreuses, mais aussi à trier les tendances de fond du bruit ambiant.
Vous avez évoqué récemment un possible désengagement américain, notamment dans votre interview au Point sur le parapluie nucléaire. Quelles évolutions – politiques, stratégiques ou internes – anticipez-vous pour les États-Unis dans les prochaines années, et comment pourraient-elles redéfinir leur rôle dans les alliances transatlantiques ?
Nous sommes encore dans ce que j’appellerai la phase de « destruction créatrice ». L’administration Trump n’a pas encore trouvé sa vitesse de croisière. Pour moi, la question est double. D’abord, cette administration peut-elle tenir à ce rythme pendant deux ans, jusqu’aux élections de mi-mandat ? Ce n’est pas certain, car le retour de bâton, notamment de la part des milieux économiques, va nécessairement se produire. Ensuite, peut-elle franchir ce que j’appelle des « points de non-retour » ? Sur le plan intérieur, cela pourrait être un défi au système judiciaire, en s’asseyant par exemple sur des jugements de la Cour suprême. Sur le plan extérieur, on peut penser à un retrait formel de l’OTAN voire de l’ONU. Ou à l’agression militaire d’un allié…
Face à un contexte de crises multiples – guerre en Ukraine, rivalité avec la Chine, instabilité énergétique –, quelle stratégie recommanderiez-vous à l’Europe, à moyen terme (5-10 ans), pour renforcer son autonomie stratégique, notamment en matière de défense et de coopération ?
L’autonomie stratégique est une démarche plus qu’un paradigme : il s’agit de réduire nos dépendances aux grandes puissances – Etats-Unis, Chine, Russie – dans les domaines militaire, énergétique et technologique. Cela se fait à la fois par la protection de nos entreprises, de nos normes et de nos données, par la diversification de nos partenariats, et par le développement de nos capacités propres. Le double choc de l’invasion de l’Ukraine et de l’élection de Trump pour un second mandat a constitué un tournant, et la direction prise est désormais assez consensuelle en Europe. L’accroissement de nos budgets de défense est une stratégie « gagnant-gagnant » : soit Trump finit par refermer complètement le parapluie de défense américain et nous serons mieux préparés à prendre totalement en charge notre défense ; soit il reprend sa démarche transactionnelle et nous aborderons le débat avec lui en meilleure posture.

La France, avec son statut de puissance nucléaire et sa tradition diplomatique, a-t-elle un rôle spécifique à jouer dans la géopolitique à long terme (10-20 ans) ? Voyez-vous, par exemple, une extension réaliste de son parapluie nucléaire à d’autres pays européens comme une réponse au désengagement américain ?
La France reste tiraillée entre deux pôles d’action diplomatique. D’un côté, son rôle mondial, assis sur une géographie particulière – les outremer – son statut de membre permanent du Conseil de sécurité, et celui de puissance nucléaire. De l’autre, son engagement européen, qui est sincère et imprègne en permanence son action extérieure. Aujourd’hui, son destin me semble être celui d’une « grande puissance européenne » aux côtés du Royaume-Uni et de l’Allemagne, avec un rôle particulier pour l’Italie et la Pologne. Elle pourra en effet, avec Londres, affirmer un rôle européen plus important pour sa force de dissuasion. Mais nous restons handicapés par une situation financière désastreuse.
Les réseaux sociaux amplifient les narratifs simplistes ou mensongers, brouillant la perception des enjeux réels. Comment un expert comme vous fait-il pour distinguer le signal du bruit, et que conseilleriez-vous au grand public pour rester vigilant sans céder à la panique ou au complotisme ?
Les réseaux peuvent être précieux comme antichambre de la scène informationnelle, mais ne devraient jamais être la seule, ni même la principale source d’information. Il se trouve que les médias dits « mainstream » ou « legacy » sont encore aujourd’hui les meilleurs vecteurs d’information et d’analyse. Parce que c’est là qu’on trouve le plus grand nombre de journalistes professionnels… Donc la consultation quotidienne de plusieurs médias d’obédience différente reste la meilleure manière de se forger un jugement informé. En ayant toujours à l’esprit qu’il reste nécessaire, sur les questions complexes ou très débattues, d’aller « à la source » : consulter soi-même les textes ou les déclarations, et non pas leurs résumés, qui sont parfois travestis…
Votre travail vise à la fois l’analyse rigoureuse et une forme d’apaisement face à l’incertitude globale. En quoi l’expertise géopolitique peut-elle rassurer face aux discours anxiogènes, et comment les médias comme Oheric Média peuvent-ils amplifier ce rôle dans un climat saturé de tensions ?
Parce que le catastrophisme, encore amplifié par les nouveaux médias, est la pente naturelle de l’information, il y a une place pour un discours mesuré, qui prend du recul. Raymond Aron disait d’ailleurs que chaque génération avait le sentiment de vivre dans un monde plus instable que celle qui l’a précédé… J’essaye, comme le dit une amie journaliste, de « traiter froidement les sujets brûlants ». Par ailleurs, je suis un optimiste de nature, et j’essaye toujours de cerner le bon côté des choses, quand il existe…
Dans La Revanche de l’histoire, vous montrez comment le passé façonne le présent. À la lumière des dynamiques actuelles – retour des rivalités de puissance, crises démographiques –, quelle leçon historique jugez-vous essentielle pour que l’Europe et la France anticipent les défis de demain avec sérénité ?
Trois leçons simples. Premièrement, le projet européen, incarné aujourd’hui dans l’Union, est une formidable réussite à l’aune de ce que furent les rivalités de puissance au cours des siècles précédents. Deuxièmement, l’Europe déjoue constamment les pronostics les plus sombres, celle de l’échec de l’euro ou de l’éclatement. Troisièmement, elle avance dans les crises : la construction européenne, c’est toujours un pas en arrière et deux pas en avant. En revanche, que l’on s’en félicite ou qu’on le déplore, le paradigme fédéral ne me semble plus d’actualité. Les Etats-Nations demeurent les éléments constitutifs fondamentaux de la scène internationale.
-
Sébastien Tertrais: Auteur/AutriceVoir toutes les publications Fondateur et rédacteur en chef à OHERIC-Média