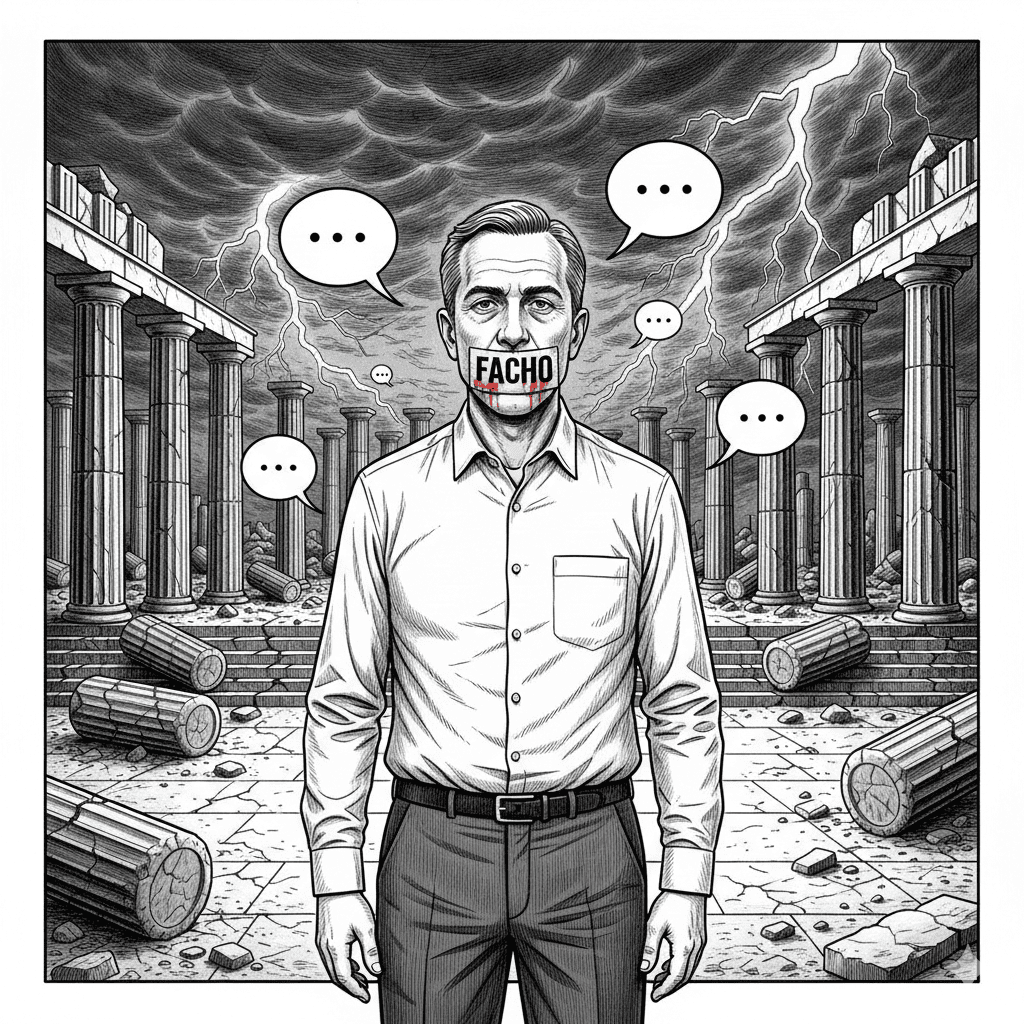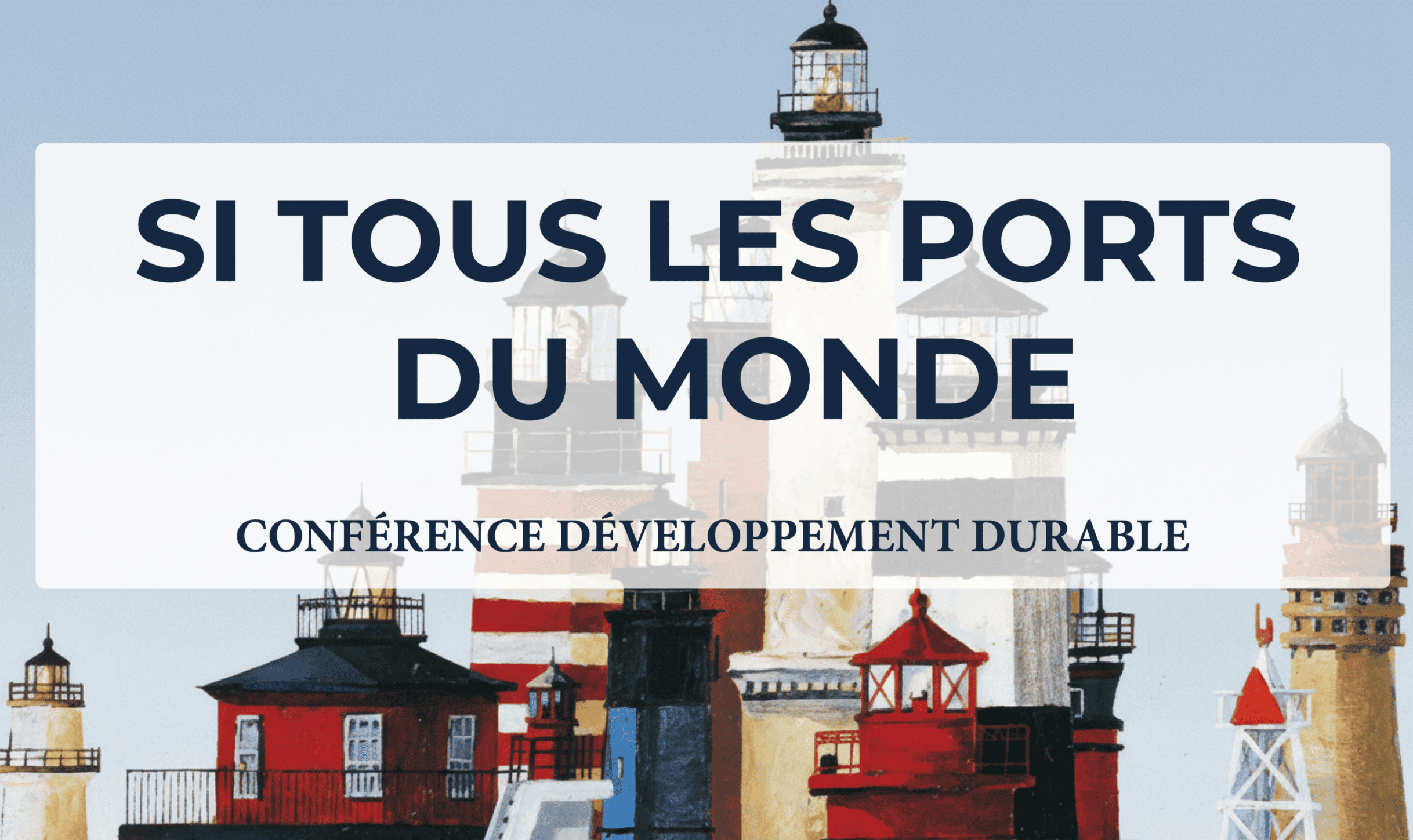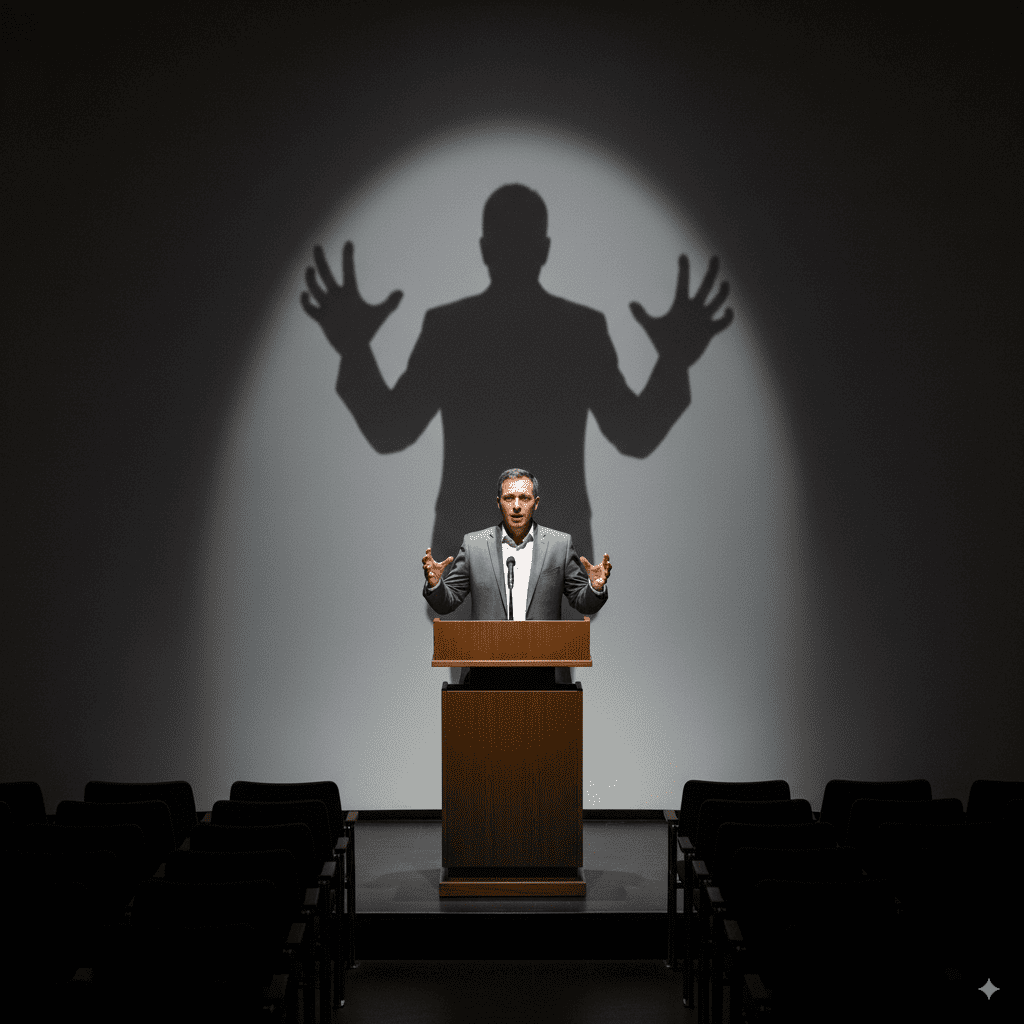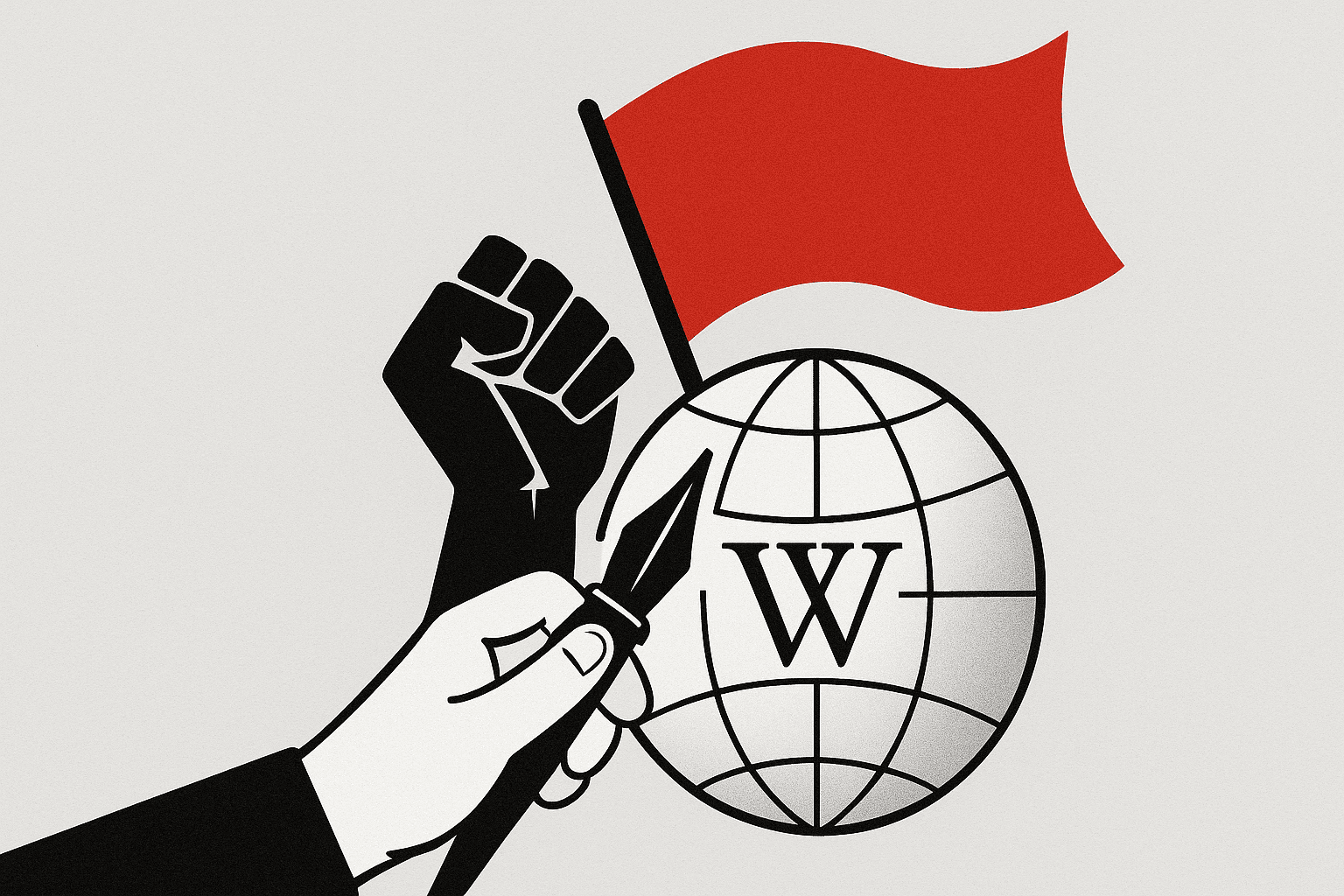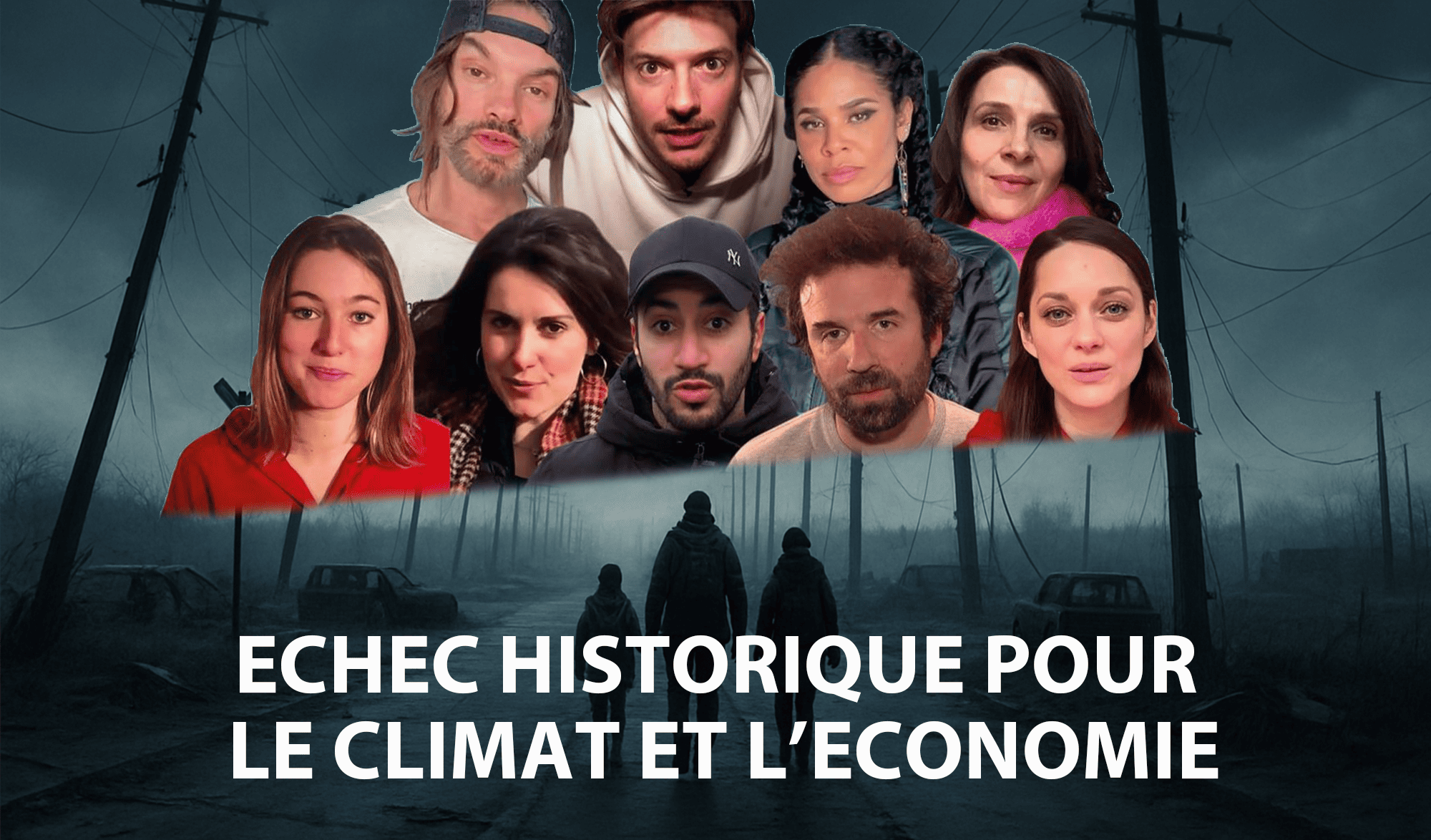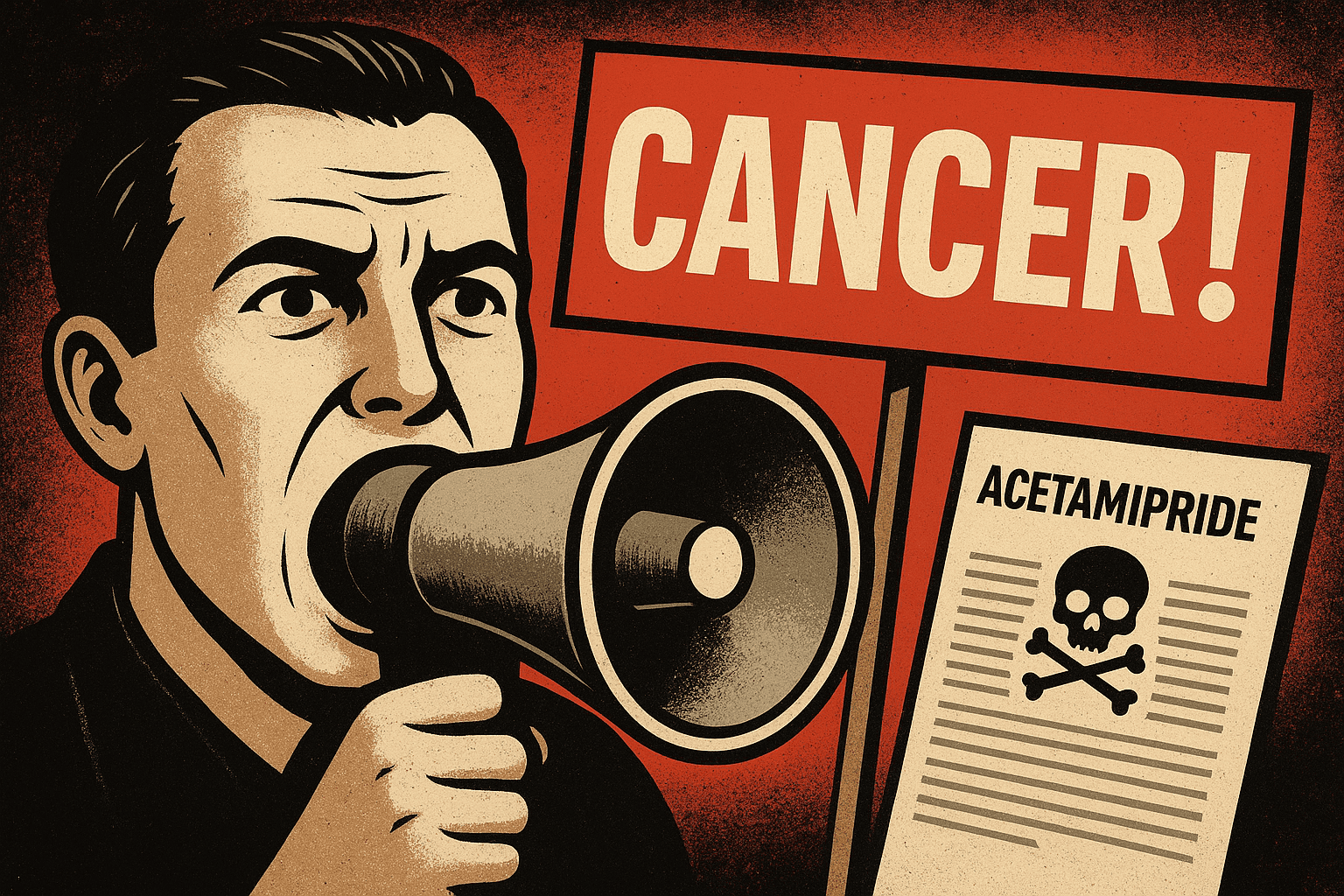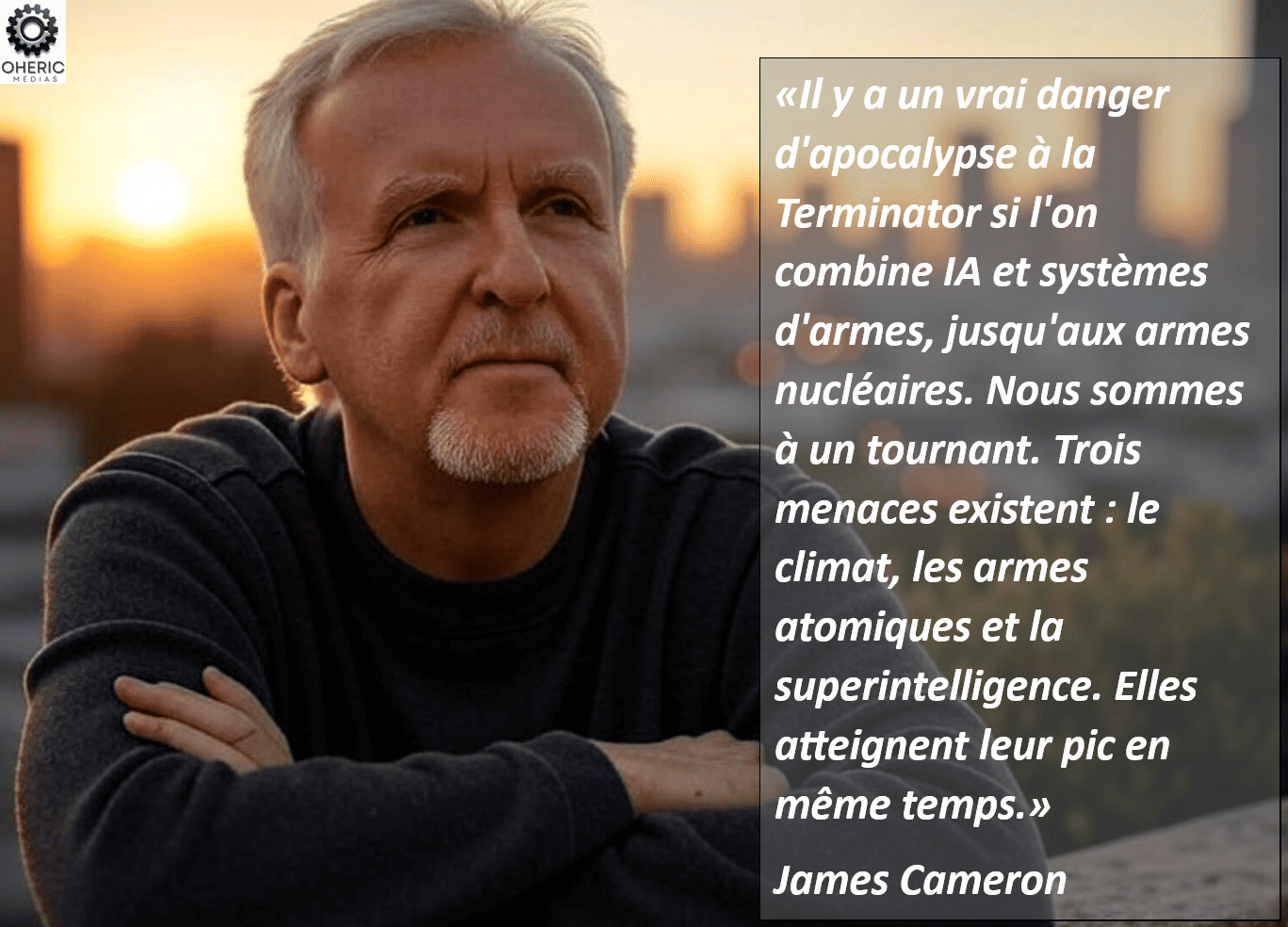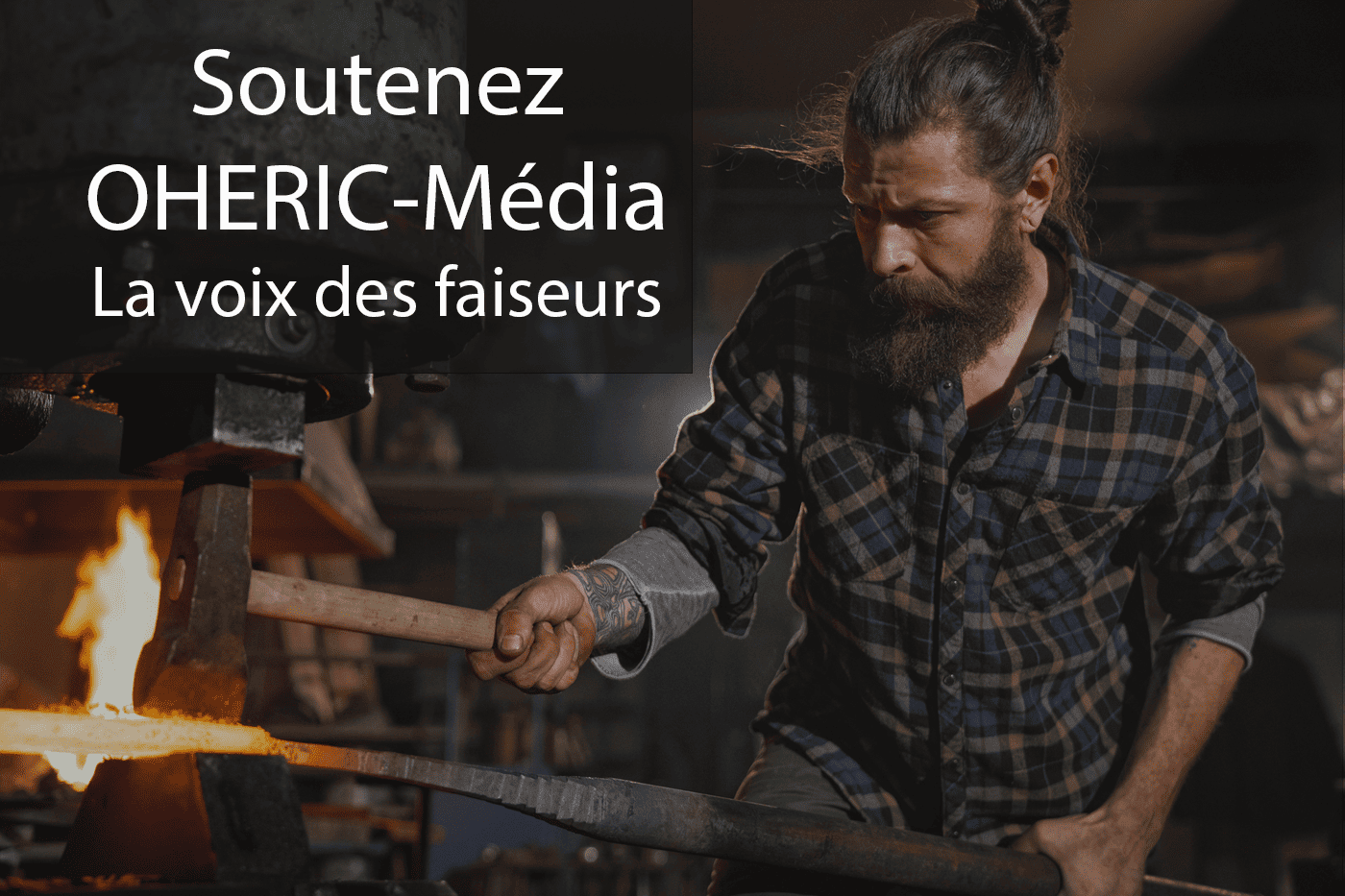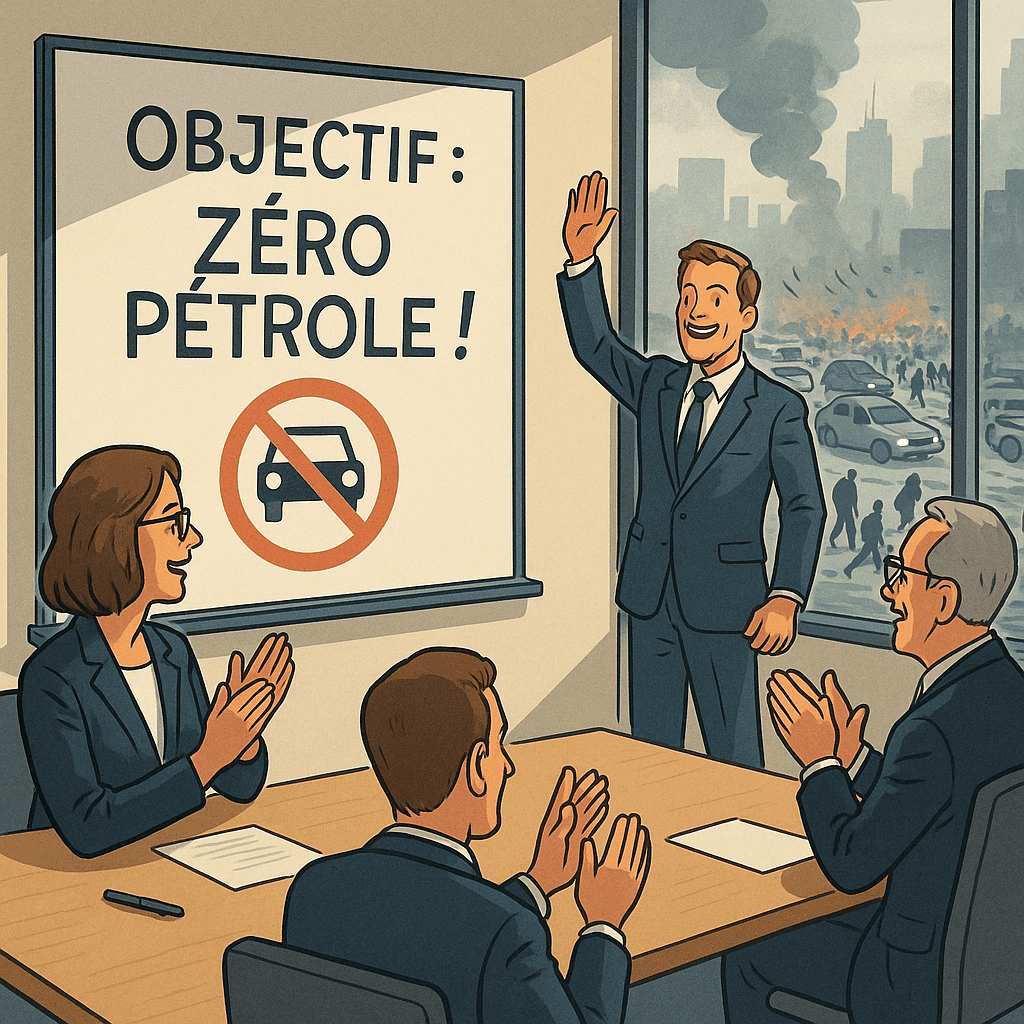Deux trajectoires d’émancipation qui se croisent
L’histoire des relations internationales est souvent une histoire de filiation et de rupture. Deux cas contemporains illustrent un phénomène intrigant : la volonté d’un enfant devenu puissance de reprendre le contrôle sur ceux qui l’ont façonné.
- Les États-Unis sont nés de l’Europe et se sont progressivement affirmés comme la superpuissance dominante du monde occidental. Aujourd’hui, leur position s’est durcie vis-à-vis du Vieux Continent, illustrant un leadership contesté et parfois perçu comme condescendant.
- La Russie, quant à elle, s’est historiquement développée autour de la Rus’ de Kyiv, considérée comme son berceau. Pourtant, aujourd’hui, Moscou ne reconnaît plus l’Ukraine comme une entité distincte, cherchant par la force à la ramener dans son giron.
Ce parallèle historique et géopolitique se complexifie dans le contexte actuel du rapprochement entre Donald Trump et Vladimir Poutine, où la dynamique de contrôle et d’émancipation prend une nouvelle tournure.
L’Europe et l’Ukraine : des berceaux devenus des rivaux
L’Europe, mère des États-Unis, reléguée au second plan
Les États-Unis sont issus de la colonisation européenne et ont, dès leur indépendance en 1776, cherché à s’émanciper de la tutelle britannique et européenne. Devenus au fil des siècles une superpuissance militaire, économique et culturelle, ils ont pris le leadership de l’Occident au point d’imposer leurs règles aux anciens empires coloniaux.
- Pendant la Guerre froide, l’Europe est restée un allié stratégique, mais sous une tutelle militaire américaine via l’OTAN.
- Avec la montée de la Chine et la perte de centralité du Vieux Continent, les États-Unis tendent à marginaliser leurs partenaires européens, notamment en matière de politique étrangère et militaire.
Aujourd’hui, cette relation est mise à rude épreuve, notamment avec la montée de l’euroscepticisme aux États-Unis et un Trump qui voit l’Europe comme un concurrent économique plus qu’un allié naturel.
L’Ukraine, berceau de la Russie, mais considérée comme une province rebelle
L’histoire russe trouve son origine dans la Rus’ de Kyiv, une entité proto-étatique qui a posé les bases de la culture et de la religion russes. Pourtant, au fil des siècles, l’Ukraine a subi une russification forcée et une négation de son identité nationale.
- En 1991, l’indépendance de l’Ukraine met fin à des siècles de domination russe et soviétique.
- En 2014, l’annexion de la Crimée par la Russie, suivie de la guerre dans le Donbass, marque une volonté explicite de Moscou de ne pas lâcher son ancienne dépendance.
Aujourd’hui, Vladimir Poutine justifie l’invasion de l’Ukraine par une rhétorique historique selon laquelle celle-ci ne serait qu’une excroissance de la Russie, niant son droit à l’indépendance.
Une dynamique de contrôle inversé : quand l’enfant veut gouverner son parent
Les États-Unis face à l’Europe : un leadership qui se durcit
Au fil des décennies, les États-Unis ont imposé leur vision du monde à l’Europe :
- Politique de défense : en poussant les Européens à dépendre de l’OTAN.
- Politique économique : via le dollar et les sanctions économiques qui impactent les alliés autant que les adversaires.
- Politique énergétique : en favorisant l’exportation du gaz de schiste américain au détriment des énergies russes et européennes.
Avec Trump, cette dynamique s’accélère : le président voit l’Europe comme un « profiteur », un continent qui se repose sur l’armée américaine sans payer sa part. Il menace même un retrait des États-Unis de l’OTAN, fragilisant encore plus l’indépendance stratégique de l’Europe.
La Russie face à l’Ukraine : de la tutelle impériale à l’agression militaire
Si les États-Unis cherchent à contrôler l’Europe par le levier économique et militaire, la Russie, elle, emploie la force brutale pour empêcher l’Ukraine de s’éloigner.
- Depuis 2022, l’invasion totale de l’Ukraine montre une volonté de reconquête directe, au mépris du droit international.
- La justification de Poutine repose sur un discours impérialiste selon lequel l’Ukraine n’existe pas sans la Russie.
- En bombardant les infrastructures ukrainiennes, Moscou espère affaiblir Kyiv pour l’obliger à négocier sous contrainte.
Cette dynamique rappelle les logiques impériales du XIXe siècle, où l’émancipation d’un territoire était perçue comme une rébellion inacceptable.
Trump et Poutine : une alliance paradoxale contre leurs « parents » respectifs
Un rapprochement idéologique et stratégique
Donald Trump et Vladimir Poutine partagent un mépris pour leurs anciens tuteurs :
- Trump critique l’Europe, refuse de la voir comme une alliée stratégique et privilégie des relations bilatérales où les États-Unis dominent.
- Poutine rejette l’indépendance de l’Ukraine et voit le monde sous le prisme des sphères d’influence impériales.
Ce rapprochement se manifeste dans leur rhétorique : Trump minimise l’importance de l’Ukraine, critique l’OTAN et laisse entendre qu’il ne s’opposera pas à Poutine en cas de nouvelle offensive russe en allant même jusqu’à criminaliser l’Ukraine comme déclencheur de cette guerre.
Vers une remise en cause de l’ordre international ?
Avec Trump au pouvoir en 2025, le rapport de force mondial pourrait radicalement changer :
- Un affaiblissement de l’Europe, contrainte de se défendre seule contre les menaces sécuritaires et économiques.
- Un blanc-seing à la Russie, qui pourrait pousser son avantage contre l’Ukraine sans craindre de riposte américaine.
- Un retour à un monde multipolaire, où les alliances fondées sur des valeurs communes sont remplacées par des logiques de force et d’intérêts immédiats.
Ce scénario serait un tournant, où les États-Unis et la Russie ne chercheraient plus seulement à dominer leurs anciens tuteurs, mais à les remodeler à leur image.
Une lutte sans fin entre héritage et émancipation
L’Europe et l’Ukraine sont toutes deux confrontées à un même défi : résister à la volonté de domination de leurs anciens protégés.
- L’Europe doit s’affranchir de la tutelle américaine en renforçant sa souveraineté stratégique et économique.
- L’Ukraine doit survivre face à la Russie, tout en affirmant une identité distincte qui rompt avec des siècles de domination.
L’histoire montre que l’émancipation des nations est un processus complexe, souvent cyclique. Aujourd’hui, les nations-enfants devenues puissances tentent de reprendre le contrôle sur leurs anciennes matrices. Reste à savoir si ces dernières sauront leur opposer une résistance durable, ou si elles seront réduites à des rôles subalternes dans un monde redessiné par ceux qu’elles ont contribué à façonner.
-
Yann Hascoët: Auteur/Autrice
Voir toutes les publications Auteur à OHERIC-MédiaÉconomie, tourisme, société, Tech