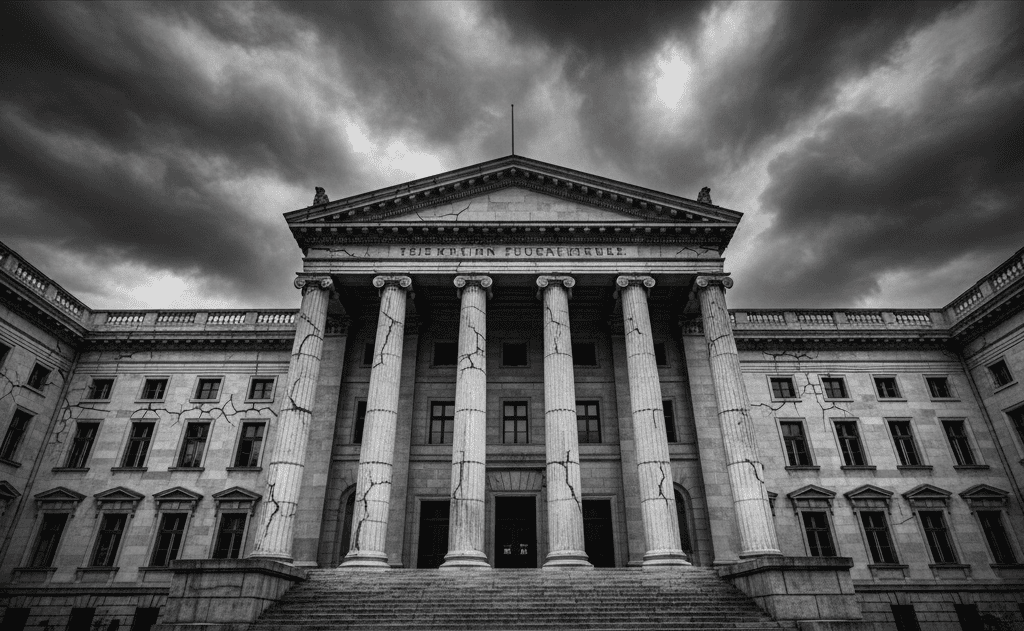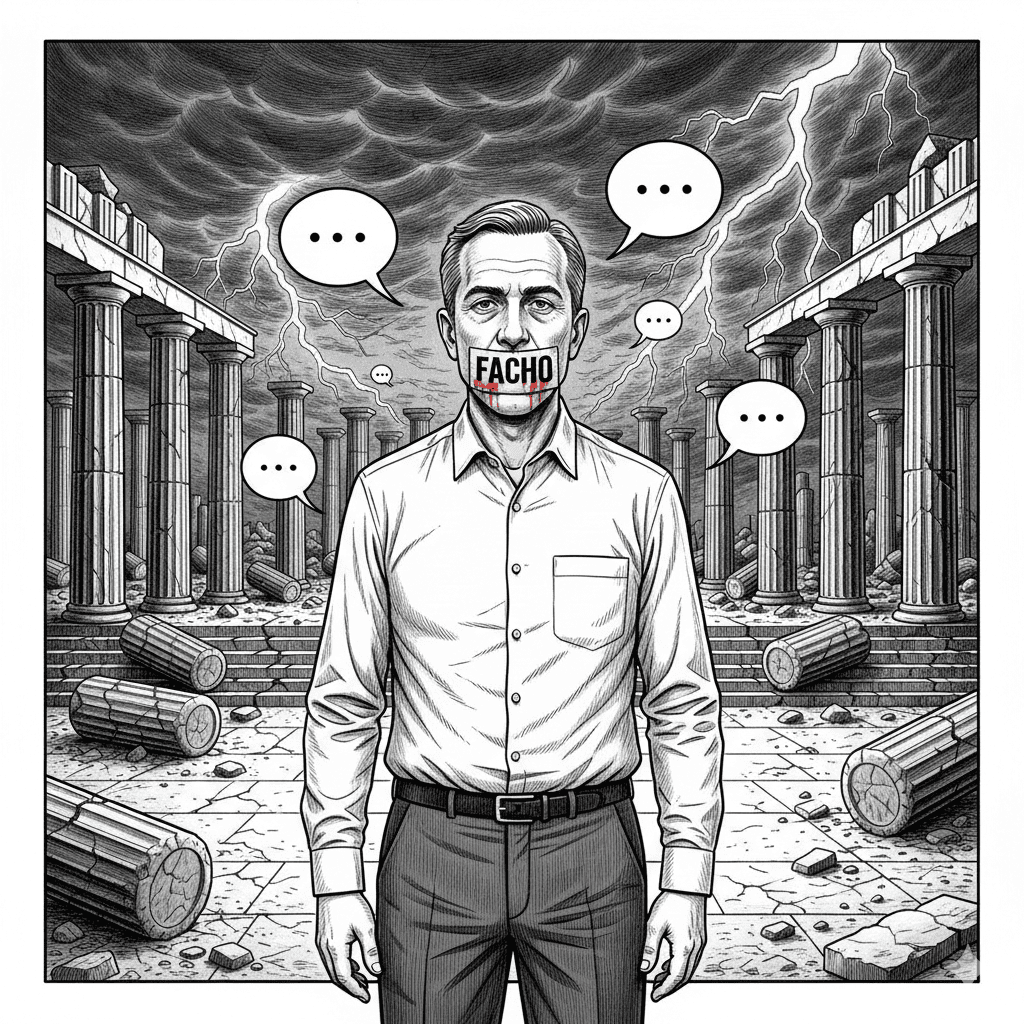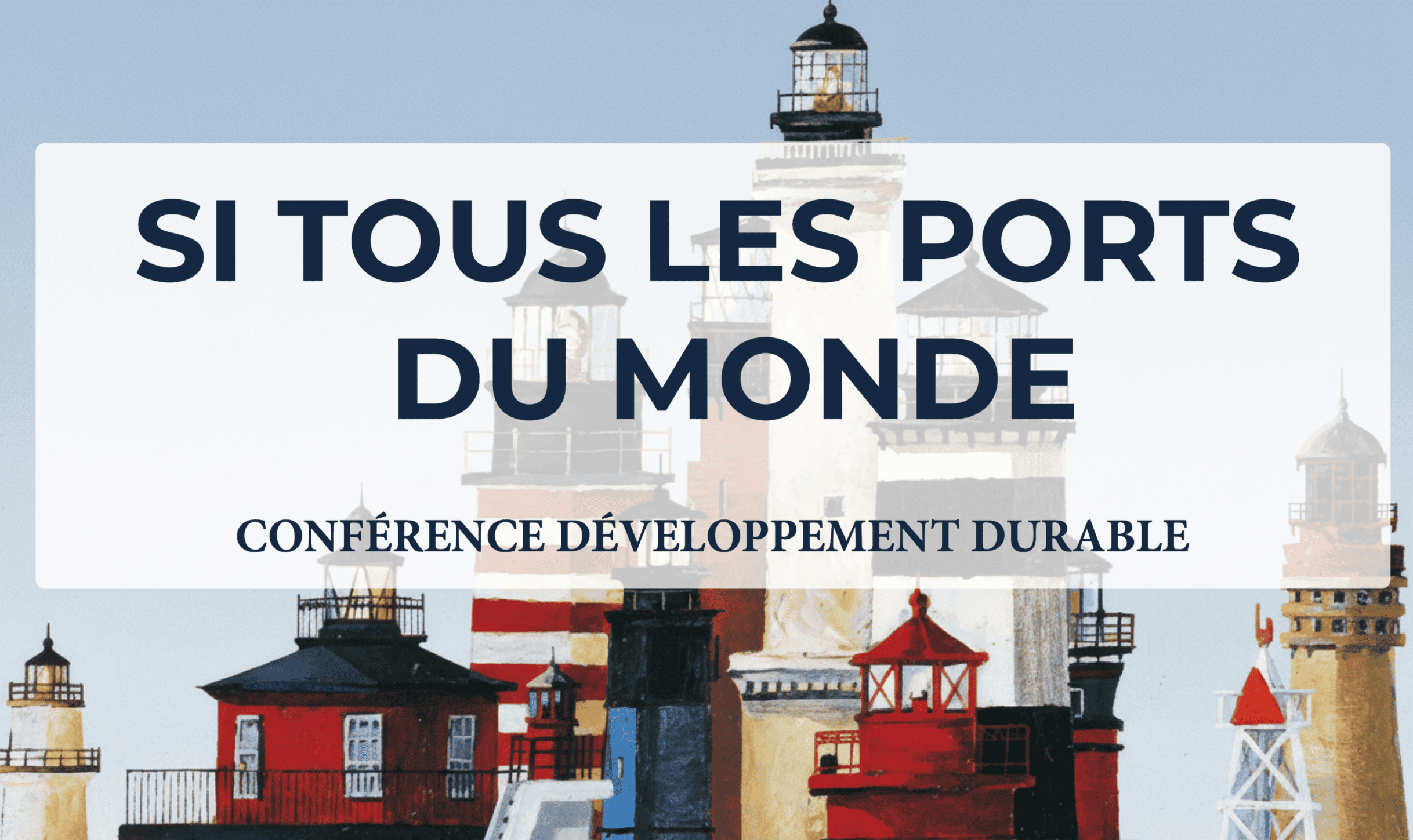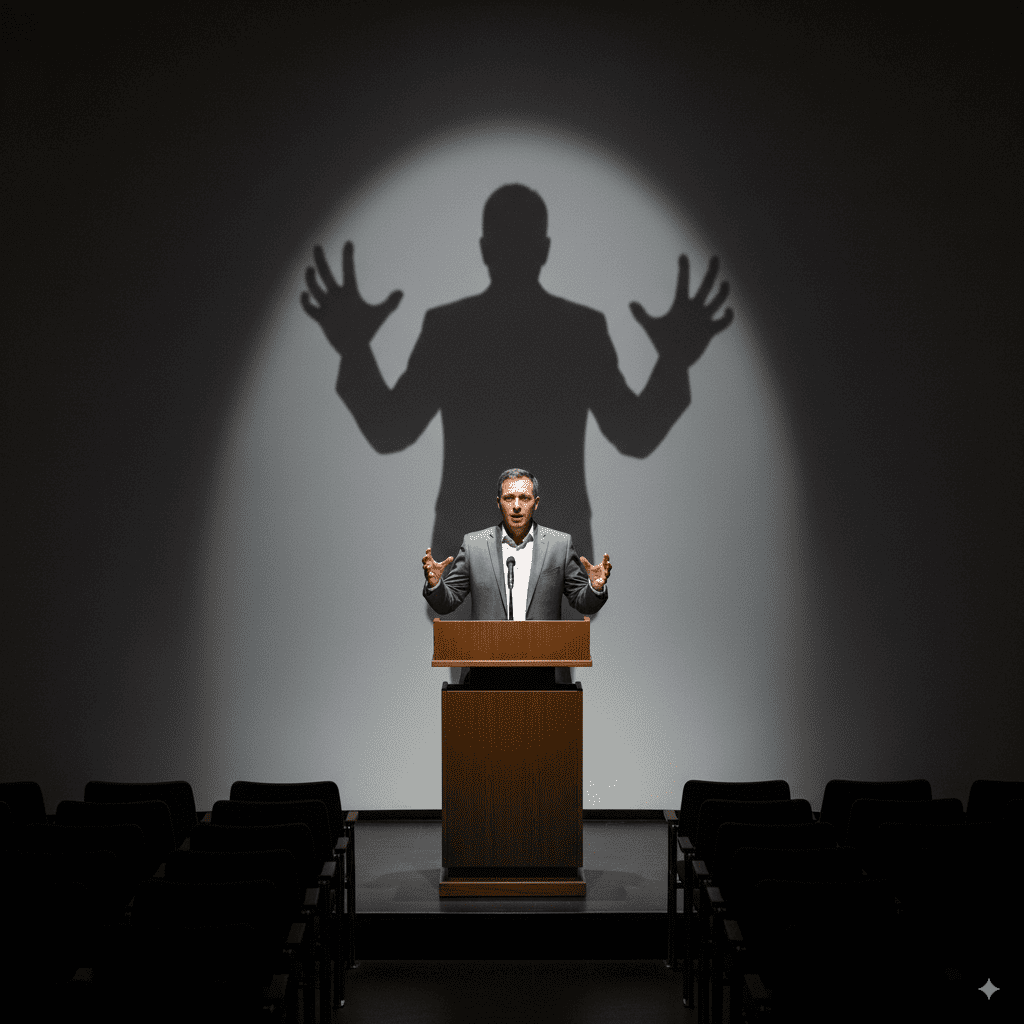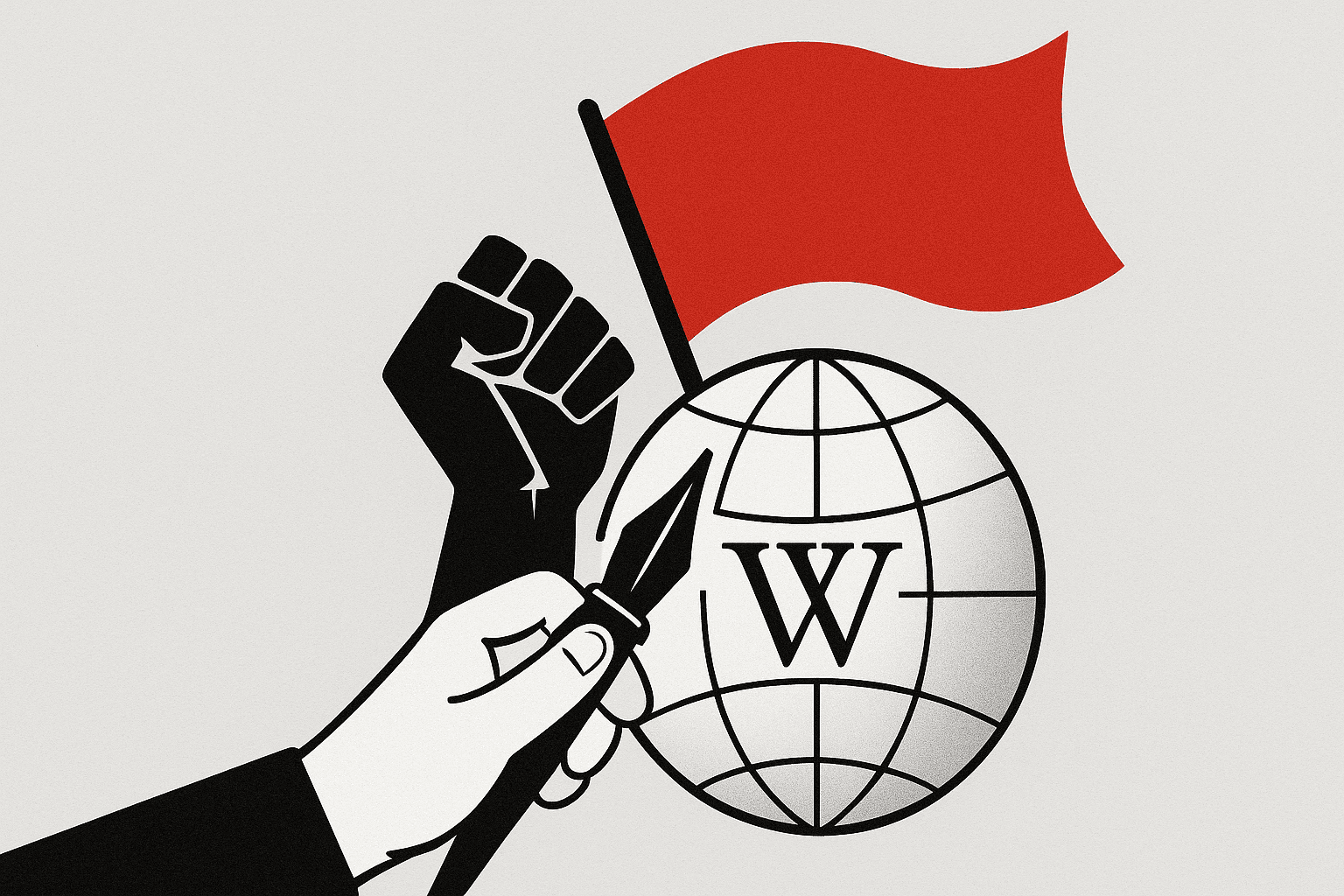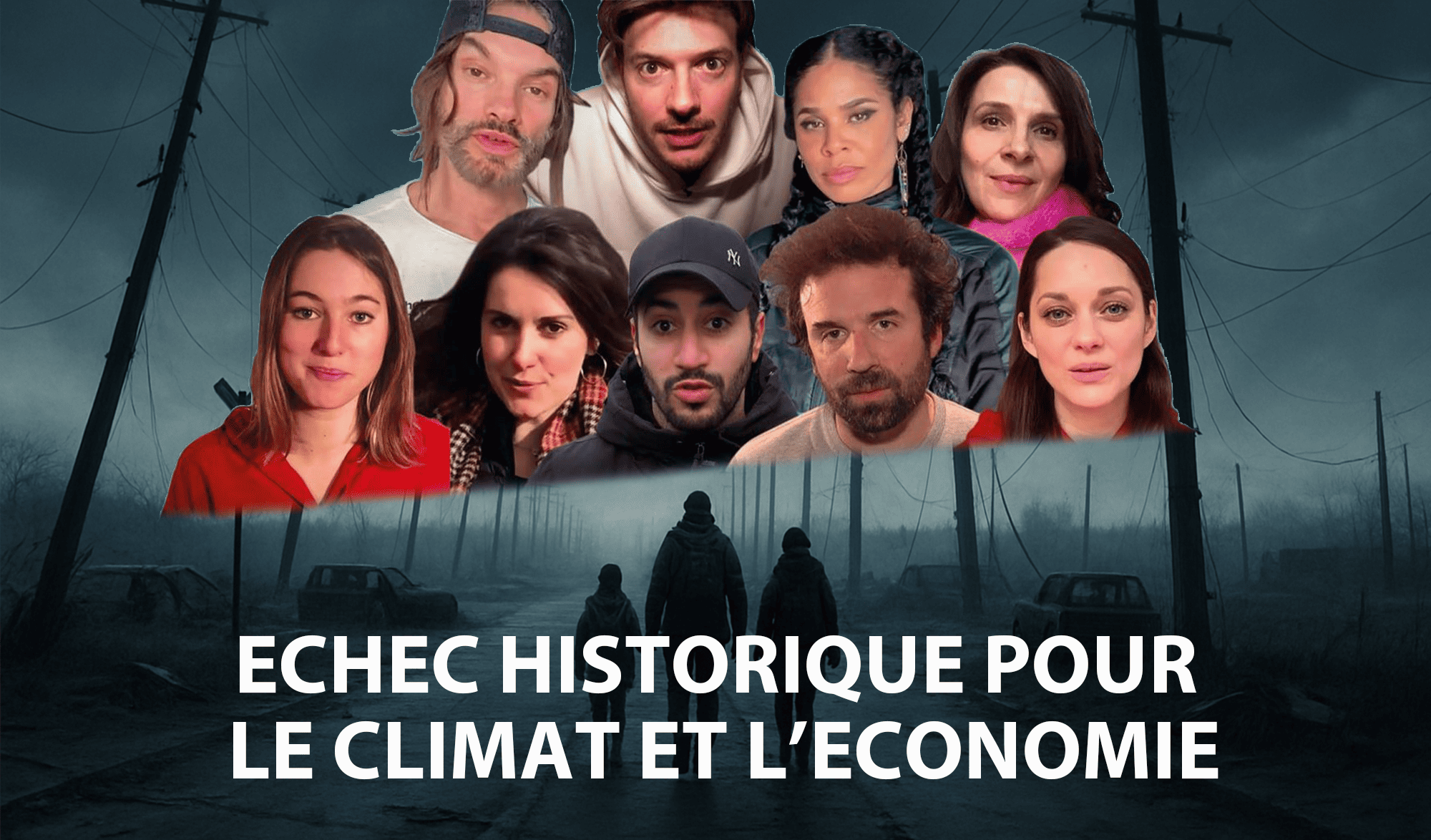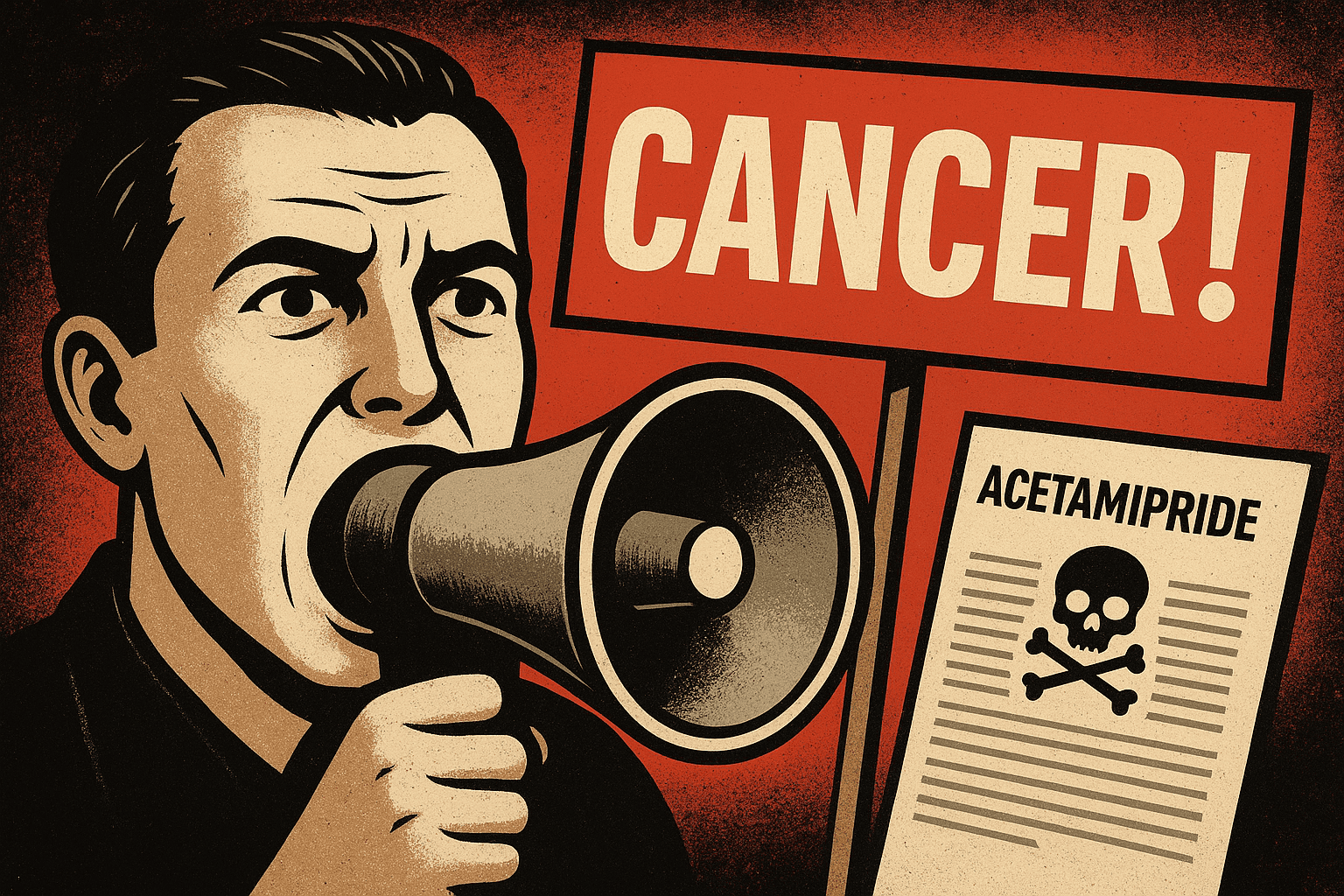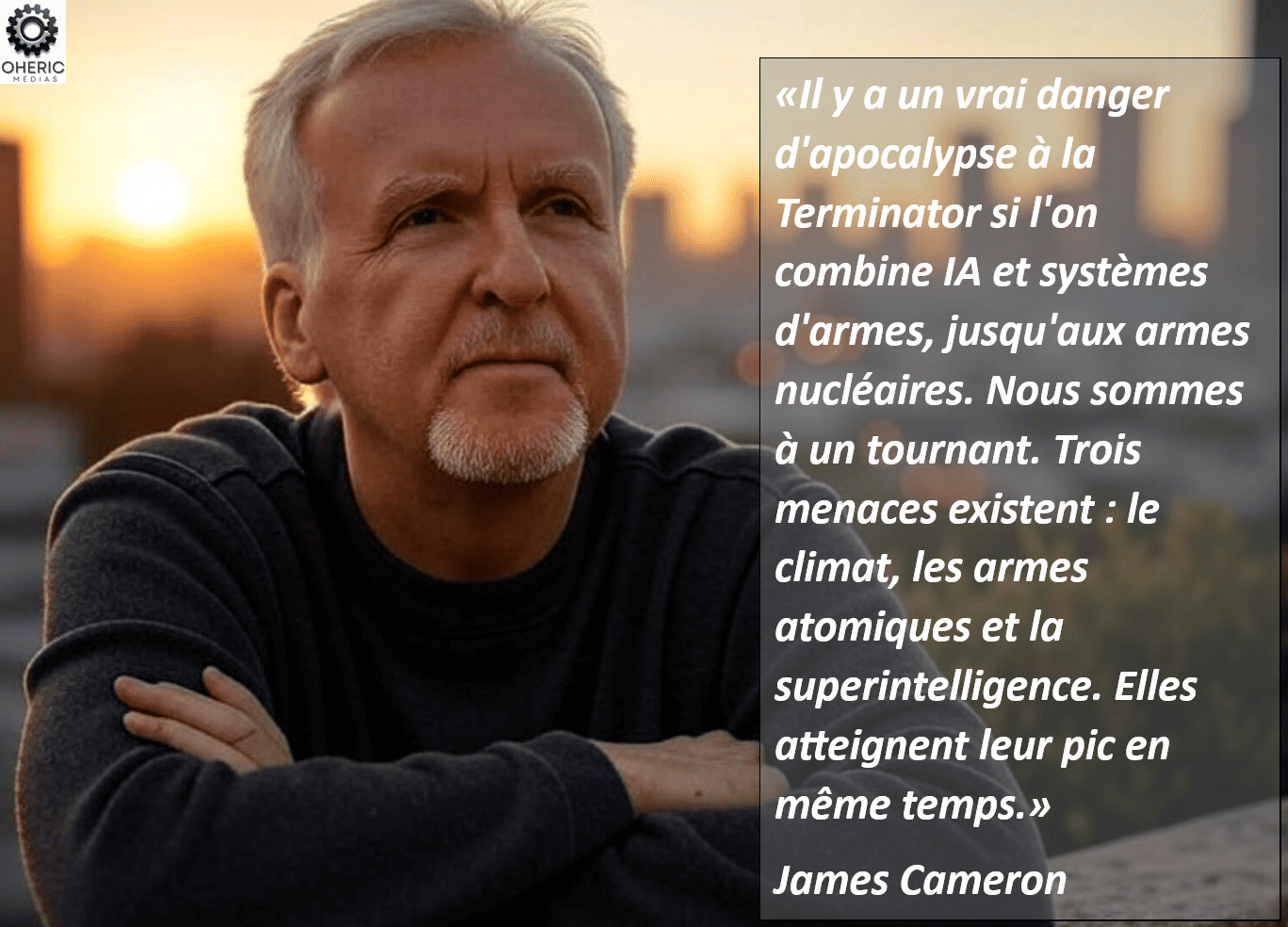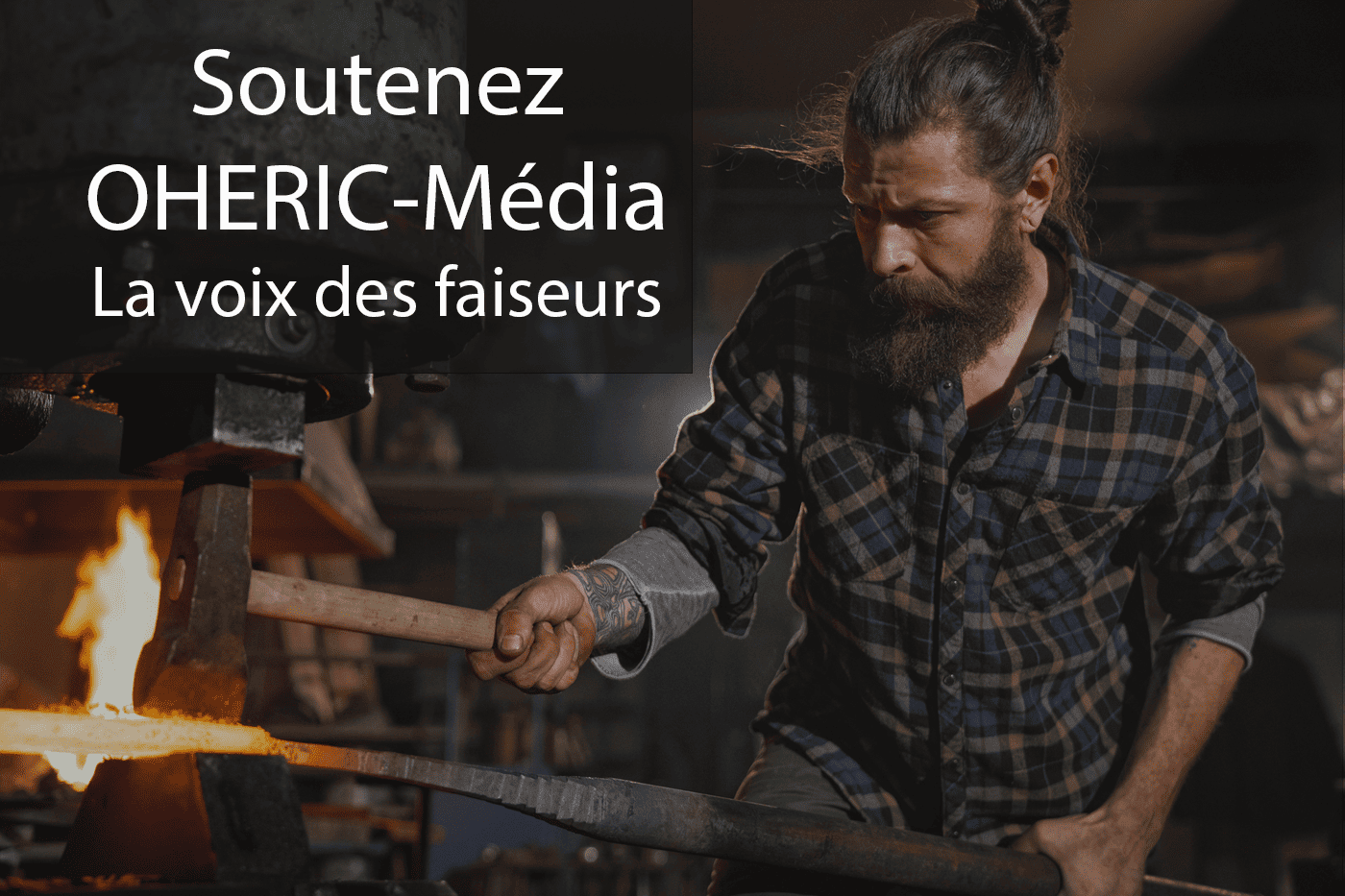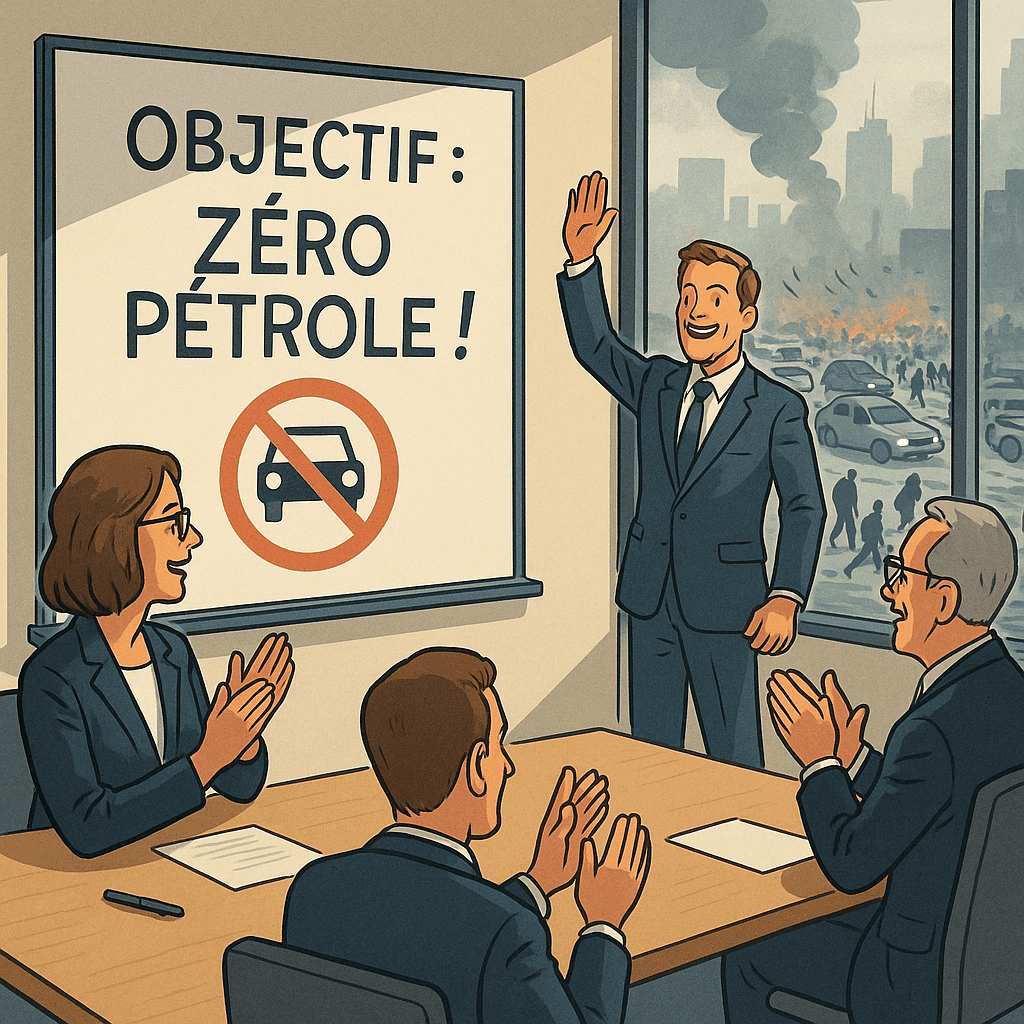Au fil de plusieurs décennies d’engagement au sein du secteur associatif et socio-culturel, j’ai observé les signes d’un délitement progressif, alimenté par des compromissions et des tabous qui paralysent nos institutions. À travers des exemples concrets, cet article révèle les mécanismes subtils qui, sous couvert de bienveillance et d’idéalisme, ont favorisé l’impunité et la montée de l’insécurité dans notre société.
Alors que notre pays est confronté à de graves crises, la question de l’insécurité prend une place prépondérante. Encore aujourd’hui, à Rennes, capitale bretonne, en plein après-midi, un homme de 49 ans a été tué à coups de couteau dans le centre-ville. Ce crime fait suite aux graves blessures par balle d’un enfant de cinq ans à l’arrière de la voiture de son père, lors d’une course-poursuite. Le 2 novembre, un jeune homme a été tué de plusieurs coups de couteau à Rennes, quelques heures avant une seconde agression qui a fait un blessé grave.
Comment Rennes, une ville étudiante où il fait bon vivre, peut-elle être confrontée à de tels drames ? Pour les observateurs avisés de la vie et de la politique locale, l’étonnement n’est guère de mise. La police signale depuis des années l’augmentation des incivilités, mais le déni est solidement ancré.

Le moment est venu d’entrer dans le vif du sujet, car bien que les Français aient conscience du délabrement de leur pays, il leur manque encore des éléments précis pour comprendre pleinement où nous en sommes. Et puisque chaque événement ou presque me renvoie aux causes que je connais bien, il m’appartient d’en parler. Si je ne le fais pas, il est à craindre que personne ne le fasse et que nos difficultés ne s’aggravent.
De la même manière que je considère LFI comme un symptôme du délitement de notre société, qui méprise trop souvent la science, la connaissance et l’expérience, je sais que les difficultés que traverse Rennes, comme tant d’autres villes françaises, ne relèvent pas de la faute d’un seul responsable, ni de seulement quelques-uns. Les responsabilités sont collectives, comme bien généralement.
J’évoque fréquemment la responsabilité abyssale des milieux socioculturels, universitaires (sciences dites molles) et politiques. Il est essentiel d’illustrer cela par des exemples concrets et vécus pour apporter du poids et du crédit à mes propos. Je connais cet univers en profondeur, y ayant travaillé de 1995 à 2006, puis en l’ayant étudié et observé par la suite.
En 2006, j’ai quitté le secteur associatif, où j’avais exercé différentes fonctions. J’en parle en détail dans mon livre Tsundoku, donc je me contenterai ici d’un résumé. J’ai commencé à œuvrer dans le secteur socioculturel dès 1993, auprès des gens du voyage. Les associations travaillant avec des populations marginalisées servent d’interface entre les publics accueillis et les pouvoirs publics. Nos structures, à l’époque, assuraient aussi la gestion, l’entretien et la maintenance des aires d’accueil. Il est important de savoir que les voyageurs payent des nuitées ainsi que leurs consommations d’eau et d’électricité. Très vite, j’ai constaté qu’une gestion défaillante générait systématiquement des troubles et, particularité du monde du voyage, un changement rapide de la typologie des familles accueillies. Les familles aspirant à vivre en paix quittent une aire d’accueil lorsqu’elle est perturbée par des individus déviants. J’ai compris ce phénomène très tôt et j’ai attaché une grande importance au règlement intérieur, garant d’une vie paisible sur ces aires, dont les plus grandes pouvaient accueillir une cinquantaine de ménages.
Dès 1998, j’ai constaté combien il était difficile, dans le secteur associatif, de faire respecter les règles, notamment lorsqu’il s’agissait d’expulser une famille perturbatrice, voire dangereuse. Depuis ma rencontre avec le jeune Steed, en 1994, j’avais compris combien il était difficile d’être membre d’une communauté méconnue. À l’époque, Steed, que j’interrogeais dans le cadre d’un reportage sur la scolarité des enfants voyageurs, m’avait confié que, parfois, lorsque quelqu’un de l’aire d’accueil commettait des « dégâts », ses parents préféraient partir plutôt que de subir la suspicion de la police, du maire ou des enseignants. Depuis, je suis convaincu que ce n’était pas aux voyageurs de faire la police entre eux, mais bien à ceux qui organisaient leur accueil de le faire.
Pour Steed et tous les autres enfants voyageurs, j’ai ancré dans mon action les principes du discernement et de la fermeté. C’était une question de justice, de vérité, d’équité. J’étais connu, apprécié et respecté pour cela par les familles, et pas toujours compris par mes collègues travailleurs sociaux.
Rapidement, j’ai décidé de me concentrer sur la gestion de l’habitat au sens large, car je connaissais son importance cruciale pour les familles et le reste de nos actions. En 2002, j’ai rejoint l’association Ulysse 35, à Rennes, qui gérait deux terrains d’accueil et coordonnait les autres aires du département. En tant que directeur adjoint, j’ai constaté l’état des dettes, déjà élevé, et les premières dégradations. Mon prédécesseur, éducateur spécialisé, estimait que ces questions relevaient de la compétence de la ville de Rennes ou de l’agglomération, voire de la police, et non de l’association. Pour moi, c’était une erreur de perspective.
Avec ma collègue comptable, nous avons mené un travail rigoureux de régularisation, en concertation avec nos collègues gestionnaires, les services juridiques et le procureur, auprès duquel je m’étais assuré que nos procédures étaient solides et seraient suivies au tribunal, si nécessaire. Évidemment, cela a généré des tensions, et j’ai moi-même dû couper des compteurs d’électricité pour rétablir l’ordre. Il était hors de question de laisser mon collègue gestionnaire le faire, il fallait reprendre la main et montrer que le « patron » savait le faire. C’est mon action et mon implication qui donneraient de la force et du crédit à notre rôle.
Dans le même temps, je traitais avec le meneur de ce mouvement, un homme que j’appréciais mais qui refusait de payer ses dettes. Nous lui avons donné un ultimatum pour mettre en place un plan de remboursement, faute de quoi je couperai les compteurs. « Alors on va se battre », m’a-t-il défié.
La tension a culminé le jour dit, mais lors d’une réunion avec Rennes Métropole, notre principal financeur, le président de la commission Habitat est venu me voir avec une demande inhabituelle.
— Sébastien, j’ai vu Philippe pour sa dette. Il m’a demandé pourquoi, quand il payait sa semaine, ça réglait d’abord la dette.
— Philippe a une dette. Le logiciel affecte d’abord le paiement aux plus anciennes factures, c’est normal.
— Ha non, il faudrait que ça règle la semaine en cours d’abord, et qu’on voit la dette à part.
— Je ne suis pas d’accord, il cherche à effacer la dette. On doit être cohérents.
— Oui, mais Philippe, tu sais, ce n’est pas n’importe qui. On fait des choses avec lui.
— Peu importe, la crédibilité de l’accueil est en jeu.
— C’est Rennes Métropole qui gère ce dossier. Il faut trouver une solution.
— Je ne suis pas d’accord, c’est une grosse erreur.
Nous n’en avons jamais reparlé, mais le mal était fait. Philippe n’a jamais réglé sa dette, et tout le monde l’a su. Cet exemple, parmi tant d’autres vécus au fil des années, montre combien les petits compromis, de prime abord anodins, font tous partie du continuum qui ont contribué à la situation actuelle. Je suis en train d’écrire un récit retraçant ces événements pour aider à mieux comprendre les défis auxquels nous sommes confrontés.
J’ai quitté le secteur associatif en avril 2006, conscient qu’il s’enfonçait dans des approches idéologisées. Dans ce milieu, des mots comme sanction, expulsion ou licenciement, sont tabous. Cela a permis aux comportements déviants de prospérer. De la même manière que les gens quittent les quartiers qui se dégradent, les salariés compétents fuient les associations et organismes parapublics lorsqu’ils constatent que la situation devient difficile. Petit à petit, il ne reste que ceux qui n’ont pas le choix, les acharnés convaincus, et ceux qui profitent des dérives. L’impunité se propage alors comme une traînée de poudre.
Je suis souvent en colère contre LFI et la gauche, qui ont contribué à ce délitement de notre société, mais je reste conscient de la complexité des choses. Les élus ont leur responsabilité, mais les citoyens aussi, car tous contribuent à l’élaboration de la conscience collective. Nous manquons de discernement, et les médias du service public ne remplissent plus leur mission. Eux aussi sont touchés par cette infiltration idéologique, au point qu’il est aujourd’hui urgent d’agir.